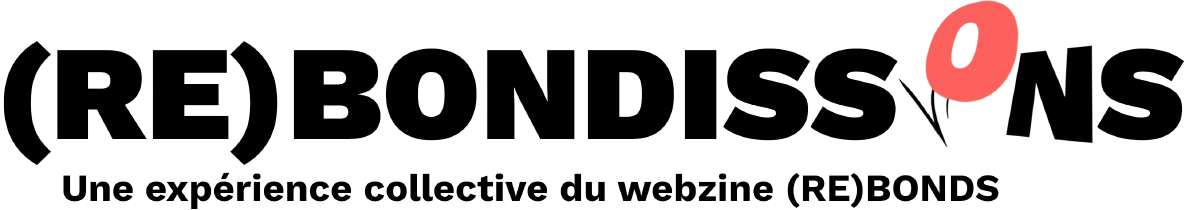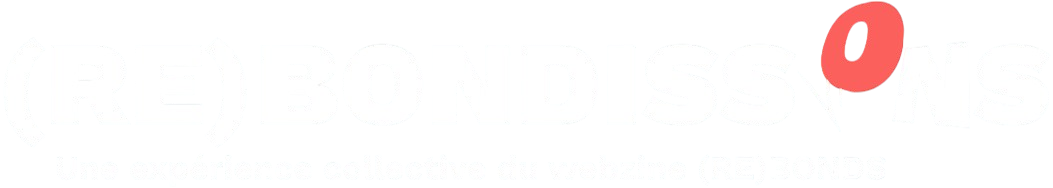« Légendes et chants de gestes canaques », Louise Michel
« Vous avez l’Edda, les Sagas, le Romancero, les Niebelungen ; nous avons ici les bardes noirs chantant l’épopée de l’âge de pierre. » C’est ainsi que Louise Michel débute sa lettre « Aux Amis d’Europe » écrite en juin 1875 depuis le bagne de la Presqu’île Ducos. Dans cette introduction à son recueil de textes, elle place le décor de ses récits et de sa vie : la situation géographique de l’archipel et l’atmosphère qui l’entoure. C’est que les Occidentaux et Occidentales de l’époque (comme d’aujourd’hui) méconnaissent totalement la Nouvelle-Calédonie et par là-même, le peuple qui y a toujours vécu.
Les textes de Louise Michel donnent d’abord à les entendre, dans ce « dialecte bizarre » nommé « Bichelamar » (biche de mer) : en égrenant les mots qu’elle apprend « autour du feu de bois de rose et de santal », elle dit la diversité des cultures qui se côtoient dans l’archipel, de gré ou de force. Elle dit aussi la beauté qui l’entoure, « avec l’adjectif le plus juste, en femme de la terre qui sait toucher, voir, humer, palper, goûter » comme le souligne Gérard Oberlé (1) dans sa préface de la réédition de 1988 (Editions 1900). « Louise, au contact de cette terre primitive, dans la tourmente des cyclones clamant leurs poèmes terribles, vibrait d’une exaltation quasi mystique, et ne pouvait pas ne pas être attirée très vite par ceux qui la concrétisaient humainement : la population canaque (2). » Elle raconte enfin les coutumes, le rapport aux aïeux, les guerres, les musiques et les danses…
Institutrice de métier, Louise Michel fonda une école dans une vieille cabane kanak. Le gouverneur la fit fermer : « Vous leur avez parlé d’humanité, de justice, d’émancipation, ce sont là des choses inutiles… Il ne faut pas parler d’émancipation à ces gens-là. Un jour ou l’autre, ça pourrait être dangereux... » Louise Michel continua de faire classe partout ou elle pouvait, en brousse ou dans des grottes…
Lors de l’insurrection de 1878 appelée aussi révolte Ataï - « un véritable soulèvement national qui mit en danger la présence française » écrit Gérard Oberlé – Louise Michel se rangea aux côtés des Kanak alors que « les ex-Communards, soudainement redevenus patriotes français, oublièrent leur propre condition et prêtèrent main forte à la marine, à l’armée de terre et à la gendarmerie pour rétablir la situation. » L’ordre des Blancs fut sauvé.
Après l’amnistie des Communard.es, Louise Michel rentra dans l’Hexagone en se promettant de revenir un jour en Nouvelle-Calédonie mais elle resta finalement lutter en Europe jusqu’à sa mort. Son ouvrage atteint aujourd’hui un double but : ajouter à la connaissance des habitant.es de l'Hexagone des éléments de la culture et de la poésie kanak ; et rappeler qui fut Louise Michel, et qu’elle se tint toujours aux côtés de celleux qui luttaient.
« Légendes et chants de gestes canaques » est téléchargeable gratuitement pour la version écrite ici : https://archive.org/details/LgendesEtChantsDeGestesCanaques/page/n75/mode/2up et pour la version audio ici : https://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/louise-michel-legendes-et-chansons-de-gestes-canaques.html
Notes
- (1) Gérard Oberlé : https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Oberl%C3%A9
- (2) A l’époque de Louise Michel, c’est ainsi que les Français écrivaient le mot décrivant ce peuple. Mais depuis une décision du gouvernement de Kanaky le 9 janvier 1985, on écrit « kanak », invariable en genre et en nombre quelle que soit la nature du mot : substantif, adjectif, adverbe.