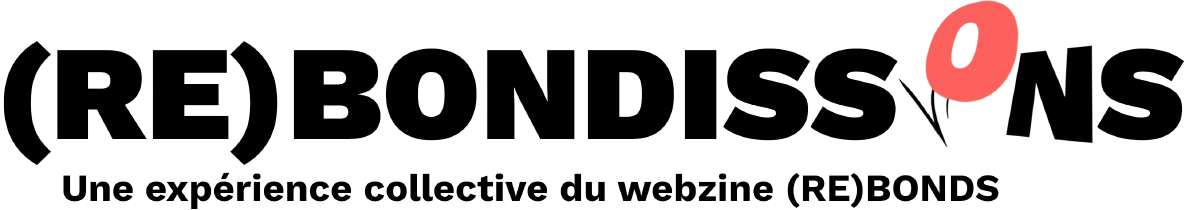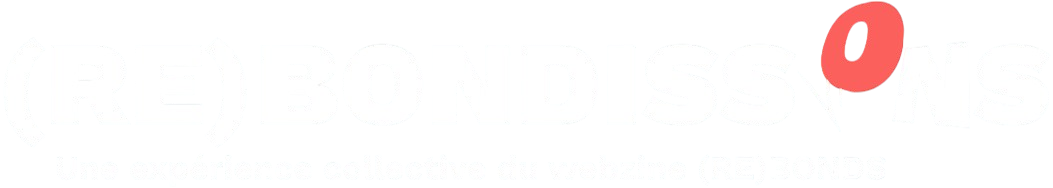Itinéraires d'une colonisation qui s'éternise
Les accords de Kanaky Nouvelle-Calédonie
Nainville-les-Roches (1983) - Matignon (1988) – Oudinot (1988) – Nouméa (1988)
Ce territoire n’était pas vide
Extrait de l’accord de Nouméa, 1998
Nainvilles-les Roches (1) - 12 juillet 1983
En 1981, c'est le retour historique de la gauche au pouvoir. En juillet 1983, Georges Lemoine, Secrétaire d'Etat aux DOM-TOM, convoque une table ronde, à Nainvilles-Les-Roches, pour discuter de l'évolution politique du territoire. Sont invités à débattre les parlementaires : Jean-Marie Tjibaou, vice-président du gouvernement calédonien ; le président de l’Assemblée Territoriale ; des grands-chefs-coutumiers et des représentants des principaux partis : les deux blocs opposés, le Front indépendantiste (FI) et le loyaliste Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR) fondé par Jacques Lafleur, et enfin, la Fédération pour une nouvelle société calédonienne (FNSC), autonomiste mais anti-indépendantiste, qui joue le rôle de médiateur entre les deux précédents.
Après cinq jours de débats, une déclaration (presque) commune est rédigée :
- Abolition du fait colonial par la reconnaissance à l’égalité de la civilisation mélanésienne et manifestation de la représentativité par la coutume dans les institutions à définir.
- Reconnaissance de la légitimité du peuple kanak, premier occupant du Territoire, qui se voit reconnaître un droit inné et actif à l’indépendance, dans le cadre de l’autodétermination prévue, ouverte également aux autres ethnies dont la légitimité est reconnue par les représentants du peuple kanak.
- Favoriser l’exercice de l’autodétermination est « une des vocations de la France » qui doit permettre d’aboutir à un choix, y compris celui de l’indépendance […] lorsque la population en ressentira la nécessité.
La déclaration sera signée par le FI et la FNSC, mais refusée par le RPCR, qui conteste le deuxième point, inquiète des conséquences de la reconnaissance des Kanak comme « premiers occupants ».
Les accords de Matignon - 26 juin 1988
Les accords de Matignon se sont tenus dans un contexte calédonien marqué par des affrontements violents entre indépendantistes et loyalistes, qui feront entre 70 et 80 morts. Le paroxysme est atteint avec l'épisode de la grotte d'Ouvéa qui entraînera un climat social proche de la guerre civile. Jean-Marie Tjibaou, indépendantiste, et Jacques Lafleur, loyaliste, acceptent, avec leurs délégations respectives, de dialoguer sous l'égide de Michel Rocard, nouveau Premier ministre de Mitterrand.
Les accords prévoient une période de développement de 10 ans avec des garanties économiques et institutionnelles pour la communauté kanak, et la possibilité pour les Néo-Calédonien.nes de se prononcer sur leur indépendance.
Le 26 juin 1988, la poignée de main entre Tjibaou et Lafleur sera historique mais difficile à faire passer dans leurs camps respectifs. Jean-Marie Tjibaou sera assassiné, avec Yéiwéné Yéiwéné, son bras droit, le 4 mai 1989 à Ouvéa par Djubelly Wéa, un militant indépendantiste opposé aux accords.
.jpg)
L'accord Oudinot - 20 août 1988
Il fixe le principe d'une consultation sur l'autodétermination à échéance de dix ans. Il s'agit « de créer, par une nouvelle organisation des pouvoirs publics, les conditions dans lesquelles les populations de Nouvelle-Calédonie, éclairées sur les perspectives d'avenir qui leur sont ouvertes par le rétablissement et le maintien de la paix civile et par le développement économique, social et culturel du territoire, pourront librement choisir leur destin » (2).
L'accord de Nouméa - 5 MAI 1998
Les accords de Nouméa (3) ont été écrits à « trois mains » : l’État français, le FLNKS (4) et le RPCR (5). Ils ont été signés sous la présidence Chirac, lors de la troisième cohabitation, avec Lionel Jospin comme Premier ministre.
Nous prendrons le temps de rapporter ici les 4 premiers articles du préambule de l'accord, car ils nous semblent fondamentaux pour comprendre comment, par la reconnaissance et la prise en compte des faits historiques, l'Etat français a pu, en 1998, se rapprocher de la mise en oeuvre d'une réelle décolonisation, et comment cette opportunité, tout aussi historique, est aujourd'hui détricotée par le gouvernement Macron.
1. Lorsque la France prend possession de la Grande Terre, que James Cook avait dénommée « Nouvelle-Calédonie », le 24 septembre 1853, elle s'approprie un territoire selon les conditions du droit international alors reconnu par les nations d'Europe et d'Amérique, elle n'établit pas de relations de droit avec la population autochtone. Les traités passés, au cours de l'année 1854 et les suivantes, avec les autorités coutumières, ne constituent pas des accords équilibrés mais, de fait, des actes unilatéraux.
Or, ce territoire n'était pas vide.
La Grande Terre et les îles étaient habitées par des hommes et des femmes qui ont été dénommés kanak. Ils avaient développé une civilisation propre, avec ses traditions, ses langues, la coutume qui organisait le champ social et politique. Leur culture et leur imaginaire s'exprimaient dans diverses formes de création.
L'identité kanak était fondée sur un lien particulier à la terre. Chaque individu, chaque clan se définissait par un rapport spécifique avec une vallée, une colline, la mer, une embouchure de rivière, et gardait la mémoire de l'accueil d'autres familles. Les noms que la tradition donnait à chaque élément du paysage, les tabous marquant certains d'entre eux, les chemins coutumiers structuraient l'espace et les échanges.
2. La colonisation de la Nouvelle-Calédonie s'est inscrite dans un vaste mouvement historique où les pays d'Europe ont imposé leur domination au reste du monde.
Des hommes et des femmes sont venus en grand nombre, aux XIX et XXe siècles, convaincus d'apporter le progrès, animé.es par leur foi religieuse, venu.es contre leur gré ou cherchant une seconde chance en Nouvelle-Calédonie. Iels se sont installé.es et y ont fait souche. Iels ont apporté avec elleux leurs idéaux, leurs connaissances, leurs espoirs, leurs ambitions, leurs illusions et leurs contradictions.
Parmi elleux, certain.es - notamment des hommes de culture, des prêtres ou des pasteurs, des médecins et des ingénieurs, des administrateurs, des militaires, des responsables politiques - ont porté sur le peuple d'origine un regard différent, marqué par une plus grande compréhension ou une réelle compassion.
Les nouvelles populations sur le territoire ont participé, dans des conditions souvent difficiles, en apportant des connaissances scientifiques et techniques, à la mise en valeur minière ou agricole et, avec l'aide de l'Etat, à l'aménagement de la Nouvelle-Calédonie. Leur détermination et leur inventivité ont permis une mise en valeur et jeté les bases du développement.
La relation de la Nouvelle-Calédonie avec la métropole lointaine est demeurée longtemps marquée par la dépendance coloniale, un lien univoque, un refus de reconnaître les spécificités, dont les populations nouvelles ont aussi souffert dans leurs aspirations.
3. Le moment est venu de reconnaître les ombres de la période coloniale, même si elle ne fut pas dépourvue de lumière.
Le choc de la colonisation a constitué un traumatisme durable pour la population d'origine.
Des clans ont été privés de leur nom en même temps que de leur terre. Une importante colonisation foncière a entraîné des déplacements considérables de population, dans lesquels des clans kanak ont vu leurs moyens de subsistance réduits et leurs lieux de mémoire perdus. Cette dépossession a conduit à une perte des repères identitaires.
L'organisation sociale kanak, même si elle a été reconnue dans ses principes, s'en est trouvée bouleversée. Les mouvements de population l'ont déstructurée, la méconnaissance ou des stratégies de pouvoir ont conduit trop souvent à nier les autorités légitimes et à mettre en place des autorités dépourvues de légitimité selon la coutume, ce qui a accentué le traumatisme identitaire.
Simultanément, le patrimoine artistique kanak était nié ou pillé.
A cette négation des éléments fondamentaux de l'identité kanak se sont ajoutées des limitations aux libertés publiques et une absence de droits politiques, alors même que les kanak avaient payé un lourd tribut à la défense de la France, notamment lors de la Première Guerre mondiale.
Les kanak ont été repoussés aux marges géographiques, économiques et politiques de leur propre pays, ce qui ne pouvait, chez un peuple fier et non dépourvu de traditions guerrières, que provoquer des révoltes, lesquelles ont suscité des répressions violentes, aggravant les ressentiments et les incompréhensions.
La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak qu'elle a privé de son identité. Des hommes et des femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leurs raisons de vivre. De grandes souffrances en sont résultées. Il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté, préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté, partagée dans un destin commun.
4. La décolonisation est le moyen de refonder un lien social durable entre les communautés qui vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, en permettant au peuple kanak d'établir avec la France des relations nouvelles correspondant aux réalités de notre temps.
Les communautés qui vivent sur le territoire ont acquis par leur participation à l'édification de la Nouvelle-Calédonie une légitimité à y vivre et à continuer de contribuer à son développement. Elles sont indispensables à son équilibre social et au fonctionnement de son économie et de ses institutions sociales. Si l'accession des kanak aux responsabilités demeure insuffisante et doit être accrue par des mesures volontaristes, il n'en reste pas moins que la participation des autres communautés à la vie du territoire lui est essentielle.
Il est aujourd'hui nécessaire de poser les bases d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, permettant au peuple d'origine de constituer avec les hommes et les femmes qui y vivent une communauté humaine affirmant son destin commun.
La taille de la Nouvelle-Calédonie et ses équilibres économiques et sociaux ne permettent pas d'ouvrir largement le marché du travail et justifient des mesures de protection de l'emploi local.
Les accords de Matignon signés en juin 1988 ont manifesté la volonté des habitant.es de Nouvelle-Calédonie de tourner la page de la violence et du mépris pour écrire ensemble des pages de paix, de solidarité et de prospérité.
Dix ans plus tard, il convient d'ouvrir une nouvelle étape, marquée par la pleine reconnaissance de l'identité kanak, préalable à la refondation d'un contrat social entre toutes les communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie, et par un partage de souveraineté avec la France, sur la voie de la pleine souveraineté.
Le passé a été le temps de la colonisation. Le présent est le temps du partage, par le rééquilibrage. L'avenir doit être le temps de l'identité, dans un destin commun.
La France est prête à accompagner la Nouvelle-Calédonie dans cette voie.
On prend la mesure, à la lecture de ces quatre articles, de l'avancée majeure du processus de décolonisation mis en place en 1998. Elle permettra également de mesurer la reculade, toute aussi majeure, que constitue la validation du troisième référendum boycotté par les indépendantistes et l'adoption du dégel du corps électoral proposé par Nicolas Metzdorf, relayé par Gérald Darmanin, et également entériné par Emmanuel Macron.
Rappel des épisodes précédents
Premiers contacts
Le 4 septembre 1774, le vaisseau Resolution commandé par James Cook aborde la terre kanak et la baptise New Caledonia en l'honneur de la région de Grande-Bretagne dont son père est originaire (Ecosse britannique). L'essor de la chasse à la baleine, l'exploitation du bois de santal, de la nacre, du coprah, des écailles de tortues, motivent les visites de navires européens, surtout anglo-saxons, et une première exploitation économique de l'île. Marins, aventuriers naufragés et négociants fondent des familles avec des femmes mélanésiennes et créent des comptoirs pour les échanges. C'est aussi le début de l'évangélisation qui mène des missionnaires catholiques à s'implanter en Mélanésie. Des frères maristes (6) s'installent en 1848 à l'Ile des Pins qui servira de base à l'évangélisation.
.jpeg)
Ces premiers contacts européens modifient rapidement les sociétés mélanésiennes aux niveaux technologique (outillage en fer), alimentaire (introduction du cochon et de l'alcool), religieux, social et démographique (abandon de la polygamie et de la régulation de la natalité). L'introduction de nouveaux microbes, contre lesquels les populations ne sont pas immunisées, décime les populations (comme chez les Amérindiens à la fin du XVe) ce qui entraîne le début d'un déclin démographique, qui s'aggravera avec le temps.
Un antécédent : l'Algérie
La France a développé, à partir de 1830, une colonie de peuplement en Algérie, pour laquelle elle a mis en œuvre une véritable politique de confiscation des terres dites « indigènes » qui permettra, de 1842 à 1845, la création de 35 centres de colonisation sur 105.000 hectares annexés (7). Les populations paupérisées de l'ensemble du bassin méditerranéen (Espagne, Italie, Grèce et Malte), des immigrant.es allemand.es et suisses, et des ouvrier.es parisien.nes s'y installent.
A la suite des journées insurrectionnelles de juin 1848, la France souhaite se débarrasser de ses « éléments subversifs ». Les révolutions de 1830 et 1848 ont créé une véritable « panique sociale » dans la classe possédante : opposants politiques, criminels de droit commun, militaires indisciplinés de l'armée française, sont déportés en Algérie - l'Assemblée nationale votera un crédit de 50 millions dans cette perspective. L'Algérie constitue le modèle originel de l'annexion de la Nouvelle-Calédonie : la création d'une colonie de peuplement et d'une colonie pénitentiaire.
Napoléon III veut renforcer sa présence dans le Pacifique face aux Néerlandais et aux Britanniques qui souhaitent également conquérir le territoire mélanésien. La France annexe la Nouvelle-Calédonie en 1853, tentant de reconstituer l'empire colonial qu'elle a perdu un siècle plus tôt, lors du traité de Paris (8). Le contre-amiral Febvrier-Despointes prend possession du territoire au nom de l'Empereur. La France souhaite faire de la Nouvelle-Calédonie une colonie pénitentiaire modèle, car Cayenne, en Guyane, ouverte en 1852, fait preuve, de manière un peu trop évidente, d'un taux de mortalité très élevé parmi la population carcérale.
La Nouvelle-Calédonie est proclamée colonie française à Balade le 24 septembre 1853. Les militaires français du navire La Constantine, arrivés en juin 1854, fondent Port-de-France, chef-lieu de la colonie, qui deviendra une petite ville, Nouméa, en 1866. Le premier gouverneur (de 1862 à 1870), Charles Guillain, est chargé de trouver des terres pour organiser le bagne. Il s'agit à la fois de garder les bagnards et de motiver les libérés à s'installer durablement sur le territoire en leur donnant des terres. Des accords sont signés avec les principaux chefs kanak qui estimeront avoir été trompés et spoliés par les actes signés. La France reconnaîtra 150 ans plus tard, dans le préambule des accords de Nouméa, le caractère unilatéral et univoque de sa prise de possession.
Confiscation des terres
1853 – En raison de la spoliation des terres, des révoltes kanak éclatent dès la prise de possession de l'île par l'Etat français. Ces révoltes sont ponctuelles, assez faibles, et aisément réprimées par l'administration coloniale. Il existe peu d'éléments de documentation.

1855 – Le commandant Testard accorde près de 2.000 hectares à la mission mariste autour du village de la Conception pour y installer 120 indigènes, amené.es depuis Balade et Pouébo par le Père Rougeyron. En mars, les Kanak interviennent contre l’installation de colons, surtout vers Port-de-France.
Le 20 janvier 1855, le commandant Joseph Du Bouzet fait une déclaration qui deviendra la charte foncière de la Nouvelle-Calédonie : les propriétés kanak sont (implicitement) inaliénables, mais l’Etat français se réserve la possibilité de les acheter, pour les concessions destinées aux colons européens ! A la suite de cette déclaration plutôt contradictoire, les administrateurs se querellent sur le statut des terres kanak : la déclaration reconnaît-elle ou non aux Kanak le statut de propriétaires, ou n'en sont-iels qu'usufruitier.es ? Un arrêté du 22 janvier 1868 leur accorde le statut de propriétaire, mais seulement dans le cadre de la propriété collective et non de la propriété privée. Cela permet à l'Etat de conserver la maîtrise du patrimoine foncier, et il se réserve, dans la foulée, un droit perpétuel d'expropriation (9).
Une déclaration de Charles Guillain, le 28 janvier 1869, est tout à fait explicite (10) :
C’est un fait exact que toutes les terres appartiennent à l’Etat par droit de conquête. Le gouvernement a fait une générosité aux indigènes et leur a laissé une partie des terrains qu’ils occupaient lors de la prise de possession ; mais cela ne diminue en rien notre droit qui est celui du plus fort, droit qui nous a été reconnu par les puissances étrangères et dont nous n’avons à rendre compte à personne. Quand nous aurons établi les cantonnements de chaque tribu, les terrains restants demeureront la propriété de l’Etat.
L'Etat se déclare également propriétaire de toutes les terres « apparemment vacantes », c'est-à-dire les terres en friche : cela constitue une catastrophe économique pour ce peuple d'agriculteur.ices qui pratique la culture en jachère, et a développé un système d'irrigation sophistiqué.
Un premier cantonnement établit une « nouvelle » tribu, constituée de Kanak de Pouébo et des Paimboas, regroupé.es contre leur gré à Tchambouenne, au sud de Pouébo, le 3 septembre 1869 : 323 personnes, 200 hectares, soit 0,6 hectare par personne – contre les 6 hectares par personne initialement prévus par l'administration. Le chef de la tribu relèvera de l’autorité coloniale (11). Neuf villages kanak sont supprimés, plusieurs centaines d’hectares de bonnes terres récupérés, vite attribués à des colons. Les opérations de cantonnement s’étendront par la suite à toute la Grande Terre, et une commission est créée à cet effet dans les années 1870.
Déportation, transportation, relégation

Une loi relative à la déportation, transportation et relégation (12) est votée à Paris le 30 mai 1854, qui décidera du sort, entre 1864 et 1897, de 30.000 femmes et hommes déporté.es en Nouvelle-Calédonie, à l'autre bout de la terre. Son article 6 indique que « Tout individu condamné à moins de huit années de travaux forcés sera tenu, à l’expiration de sa peine, de résider dans la colonie dans un temps égal à la durée de sa condamnation. Si la peine est [au moins] de huit années, il sera tenu d’y résider pendant toute sa vie. Toutefois, le libéré pourra quitter momentanément la colonie, en vertu d’une autorisation expresse du gouverneur ».
Sans espoir de retour, certain.es condamné.es sont tenu.es de « faire souche » sur place. Seul.es les communard.es (13) bénéficieront d'une loi (partielle) d'amnistie, qui leur permettra d'être rapatrié.es en 1880.
Politique de peuplement
Des vagues successives de peuplement ont lieu, principalement dans les années 1850, 1860 et 1870, au point que les colons égalent pratiquement en nombre la population kanak :
Les colons ont donc servi la politique coloniale de la France qui, grâce à l'installation des familles jusque dans les vallées les plus reculées de l'île, assoit sa présence sur le territoire (14).
L'administration coloniale doit leur trouver des terres. Les moins fertiles sont attribuées aux Kanak, qui ne peuvent ni les vendre, ni en acheter, mais sont, théoriquement, protégé.es contre leur violation. On verra, avec la révolte d'Ataï, que ce ne fut pas le cas. En 1897, l'Etat français mène une politique de cantonnement, et rassemble tou.tes les Kanak dans des réserves, leur attribuant 3 hectares par habitant.e. Comme on l'a vu en introduction, l'Etat proposait, en 1891, aux colons français des concessions de pas moins de 25 hectares. Au fur et à mesure de l'arrivée des colons, les terres attribuées aux Kanak passent de 320.000 en 1898 à 124.000 hectares en 1902. Frappée par les maladies importées (15), la sous-alimentation et la répression des insurrections (entre 2.000 et 3.000 mort.es lors de la révolte d'Ataï en 1878), la population Kanak chute drastiquement. Selon les estimations, elle s'élevait à environ 45.000 au moment de la prise de possession, et chute à 20.000 en 1920.
Si on remonte à l’arrivée de Cook et aux premiers contacts avec les Européens, on parle d’un effondrement de 70 à 90 % de leurs effectifs. Au début du XXe siècle, les autorités françaises considèrent que le peuple océanien est voué à la disparition et qu’il est destiné à être remplacé par une population européenne supposément plus résistante – on est en plein darwinisme social ! (…) Au début du XXe siècle, les réserves des Kanak représentent 8 % seulement du territoire de la Grande Terre (16).
Seules l'Algérie et la Nouvelle-Calédonie ont constitué des colonies de peuplement, d'abord sous l'Empire, puis sous la République française. Ces colonies particulières sont restées minoritaires dans les espaces coloniaux. Les socialistes saint-simoniens, adeptes d'une « colonisation utopiste » prêchaient en faveur « d'une fusion harmonieuse » des communautés « indigène » et européenne, d'un « mariage régénérateur » entre l'Orient et l'Occident, qui produirait une société nouvelle, fidèle aux principes de 1789. Victor Hugo, partisan en 1879, d'une « colonisation sociale », proposait de « (re)civiliser les prolétaires parisiens, ''barbares de l'intérieur'' sans cesse en agitation, au contact d'une terre lointaine qui leur appartiendrait et avec laquelle ils feraient corps ». Ernest Renan, dans La Réforme intellectuelle et morale de la France (17), écrivait en 1871 : « La colonisation en grand est une nécessité politique tout à fait de premier ordre. Une nation qui ne colonise pas est irrévocablement vouée au socialisme ».
La colonisation rurale algérienne, malgré les vastes opérations d'expropriation des terres en faveur des colons par les différents gouvernements français, de 1871 à 1900, a échoué. La majorité des colons français vit dans les zones urbanisées de la côte, et non dans les zones rurales - la colonisation de peuplement a manifestement réussi au regard du développement démographique relevé : 28.000 personnes en 1840 / 900.000 en 1962. En Nouvelle-Calédonie, cette politique de peuplement a eu de funestes conséquences, inversant dans des proportions désastreuses les deux pans de la démographie, Kanak et Caldoche (18), et condamnant les populations natives à devenir minoritaires dans leur propre pays. La société s'en trouve depuis divisée, économiquement, socialement, politiquement, jusqu'à aujourd'hui.
1864 - La colonie pénitentiaire
Le premier convoi pénitentiaire arrive le 5 janvier 1864 en Nouvelle-Calédonie, transportant 250 prisonnier.es de droit commun à bord de l'Iphigénie. Après la Commune de Paris (1871), la colonie pénitentiaire (qu'on appelait alors « guillotine sèche ») « accueille » de très nombreux.ses communard.es condamné.es à la déportation par les Conseils de guerre d'Adolphe Thiers. Les raisons du choix de la Nouvelle-Calédonie (19) sont multiples : contrairement à la Guyane, le climat sain permet de simplifier les « installations d'accueil » (les terrains sont pratiquement sans bâtiments ni baraquements) ; l'éloignement est maximum (jusque dans les années 1970 et l'apparition des avions rapides, on considère que c'est la « dernière étape avant la lune ») ; la colonie pénitentiaire existe déjà, ce qui constitue une commodité administrative ; et enfin, pour des raisons de sécurité : selon les autorités pénitentiaires, les évasions y sont impossibles, car « les évadés seraient aussitôt mangés, d'un côté par les requins, de l'autre par les « naturels » » (les populations Kanak !) (20) Environ 2.000 condamnés d'Afrique du Nord (surtout des résistants algériens à l'occupation française de 1830) seront envoyés en Nouvelle-Calédonie.

Les détenu.es constituent un apport de main d'œuvre considérable et très profitable pour la mise en œuvre de grands travaux : aménagement, à Nouméa, du plan urbain, avec remblaiements, construction de la cathédrale et du temple protestant ; en « brousse » (dans les zones rurales), construction de routes, ponts et tunnels par les détenu.es. On pose le chiffre de plus de 11.000 détenu.es en 1877, soit environ deux tiers des Européen.nes de la colonie.
Fin XIXe, début XXe, des tentatives de colonisation libre ou pénale sont conduites : des femmes condamnées par la justice, venues de la région de Bordeaux, sont embarquées pour épouser d'anciens bagnards devenus colons. Environ 600 mariages sont célébrés entre 1870 et 1895. L'installation de populations européennes libres se développe, en parallèle des « libérés » du bagne. Elles pratiquent la culture du café - celle de la canne à sucre ou du coton sont des échecs – et l'élevage. Cette implantation, ainsi que la politique foncière et de l'indigénat de l'Etat français, entraîneront des révoltes de la population kanak, nous le verrons au prochain épisode, avec la plus célèbre, celle d'Ataï, en 1878.
1878 - La Révolte d'Ataï
C'est la plus célèbre de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Elle a eu un retentissement très postérieur à la mort du grand chef. Quatre témoignages vont rendre compte de cet épisode : celui de Berger Kawa, un descendant d'Ataï, celui de Louise Michel (21), celui du Commandant Rivière qui a dirigé la répression et celui du Général de brigade de Trentinian.
Les colons calédoniens ont obtenu de l'administration pénitentiaire les meilleures terres, celles des plaines, confisquées aux Kanak, qui ont été repoussé.es dans les espaces rocheux, sablonneux, infertiles de l’île. Les Kanak étaient réquisitionné.es pendant 3 mois, parfois 6 mois par les autorités françaises comme canotiers (pour ramer), comme plantons, sans être payé.es, à peine nourri.es. « Il n'y a pas une seule cause, mais un faisceau de cause (à la révolte), dont la principale est le problème des terres, du bétail, le fait de ne plus être chez soi (22). »
Le récit suivant est tiré du témoignage de Berger Kawa, grand chef du district de Sarraméa, descendant du clan d'Ataï (23).
Berger Kawa : Dans le district de Sarraméa, tout est sec, le bétail des colons a faim et va pâturer les cultures vivrières des Kanak, qui commencent à manquer. Le grand-père, chef de la tribu, va à la chefferie (au bagne) pour demander qu'on empêche le bétail de saccager les cultures et pour tenter d'endiguer l'attribution des terres aux bagnards libérés. On lui promet de faire le nécessaire. Trois ou quatre mois plus tard, rien n'est fait. Le grand-père retourne au bagne. On lui promet d'intervenir, mais il faut le temps. Le grand-père croit à la promesse parce que, coutumièrement, on respecte la parole donnée. A la fin de l'année, rien n'a été fait, et il n'y a plus rien à manger. Le frère du grand-père, Ataï, accompagne celui-ci lors d'une troisième visite. Au directeur colonial Olry, qui lui demande d'ôter sa casquette devant lui, Ataï répond « Quand tu auras quitté la tienne, j’ôterai la mienne ! » (24). Olry : « Si vous êtes vraiment pressé, allez la faire vous-même votre barrière ». Berger Kawa : « Le vieux, ça l'a choqué d'entendre ça, puisqu'ils avaient déjà promis deux fois. Donc il leur a répondu : ''Monsieur, je pense que ce sera à nous de faire les barrières le jour où nos ignames et nos tarots sortiront de terre et iront manger vos bœufs'' ». Devant le gouverneur colonial, Ataï vide un sac de terre : “Voilà ce que nous avions”. Puis il vide un second sac, rempli de cailloux : “Voilà ce que tu nous as laissé”. Le grand-père a continué de faire patienter tout le monde. Mais le vieux Ataï a fait le tour de la tribu et un groupe tente de chasser les colons les plus proches. Les insurgés coupent les lignes télégraphiques récemment implantées et attaquent les postes militaires susceptibles de receler des armes à feu. L'Etat français envoie l'armée, puis se rappelle, fort à propos, les conflits kanak récurrents entre les camps de l'Est et de l'Ouest. Ils vont trouver le vieux Nondo, de la tribu des Canalas, à l'Est. Ils lui promettent des fusils et de l'argent pour chaque tête coupée. Nondo rallie les chefs Gelina, Kaké et de Houaïlou. Avec l'armée française, ils arrivent à Foa, déciment les tribus sur leur route et détruisent les cultures vivrières. Ils encerclent Ataï, qui est tué le 1er septembre 1878, ainsi qu'un de ses fils et son médecin et second, Naïma (31). Ils leur coupent la tête.

Louise Michel avait fait porter à Ataï, en signe de solidarité, un morceau de son écharpe rouge de la Commune (25). Dès son arrivée à la presqu’île Ducos, elle s’intéresse à la langue et à la culture kanak. « Eux aussi luttaient pour leur indépendance, pour leur vie, pour la liberté. Moi, je suis avec eux, comme j’étais avec le peuple de Paris, révolté, écrasé et vaincu ». Elle écrit un livre, Légendes et chants de gestes canaques, publié en 1885 (lire aussi dans la rubrique (Ré)créations). Dans ses Mémoires, Louise Michel écrivait :
Ataï lui-même fut frappé par un traître. Que partout les traîtres soient maudit ! Suivant la loi canaque, un chef ne peut être frappé que par un chef ou par procuration. Nondo, chef vendu aux blancs, donna sa procuration à Segou, en lui remettant les armes qui devaient frapper Ataï. Entre les cases nègres et Amboa, Ataï, avec quelques-uns des siens, regagnait son campement quand, se détachant des colonnes des blancs, Segou indiqua le grand chef, reconnaissable à la blancheur de neige de ses cheveux. Sa fronde roulée autour de sa tête, tenant de la main droite un sabre de gendarmerie, de la gauche un tomahawk, ayant autour de lui ses trois fils et le barde Andja, qui se servait d'une sagaie comme d'une lance, Ataï fit face à la colonne des blancs. Il aperçut Segou. Ah ! dit-il, te voilà ! Le traître chancela un instant sous le regard du vieux chef ; mais, voulant en finir, il lui lance une sagaie qui lui traverse le bras droit. Ataï, alors, lève le tomahawk qu’il tenait du bras gauche ; ses fils tombent, l'un mort, les autres blessés ; Andja s'élance, criant : tango ! tango ! (maudit ! maudit !) et tombe frappé à mort. Alors, à coups de hache, comme on abat un arbre, Segou frappe Ataï ; il porte la main à sa tête à demi détachée et ce n'est qu’après plusieurs coups encore qu'Ataï est mort. Le cri de mort fut alors poussé par les Canaques, allant comme un écho par les montagnes. […].
Alain Saussol, géographe (26), précise que, dans la vallée de Fonwahry, à côté de la maison d'Ataï, se trouvait un cimetière kanak. Le directeur du pénitencier, un certain Lécart, offrait en cadeau à ses amis des crânes, des armes, des ossements volés au cimetière : « Non seulement on lui prenait ses terres, mais aussi les ossements de ses ancêtres. Il avait de bonnes raisons d'être excédé par ce voisinage... ».
Le 19 juin 1878, près de La Foa, un groupe kanak vient tenter de restituer à ses parents une jeune femme à la merci d'un colon. Devant son refus de la libérer, le colon est assassiné. Le 24 juin, les chefs de la vallée de Pocreux sont arrêtés pour ce meurtre. Le 25 juin, des insurgés kanak attaquent la gendarmerie, volent les armes, incendient le bâtiment et tuent 5 gendarmes. Des fermes de concessionnaires pénaux et le camp de la transportation sont attaqués. C'est le début de la révolte, et de la répression.
Le Commandant Rivière, qui a dirigé la répression (27), écrit dans ses mémoires :
De temps en temps, on aperçoit, au creux d'un vallon, dans un bouquet de palmiers et de cocotiers, les toits de chaume pointus d'un village. Tour à tour, Vaux-Martin ou Boutan me demandent la permission d'aller le brûler. […] Nous avons traversé, à deux reprises, tout le pays insurgé, brûlé une centaine de villages et tué quelques kanaks. […] Dans l'intervalle de ces expéditions, de grandes corvées de 100 soldats et de condamnés, allaient à la vallée d'Ataï. Ils y dévastaient ou y détruisaient […] 5 ou 6 hectares de plantations.
Pour rassurer l'opinion et montrer que l'insurrection est sous contrôle, Ataï est présenté comme le chef de la révolte, bien que celle-ci durera jusqu'en juin 1879, c'est-à-dire des mois après la mort d'Ataï (1er septembre 1878). La grande révolte kanak fera entre 800 et 1.000 morts côté Kanak, et 200 morts côté Européens ou assimilés.
Navarre, un officier médecin de marine, achète la tête d'Ataï, sa main, et la tête de son sorcier, Andja, les plonge dans le formol et les expédie en France. L'anatomiste et anthropologue Paul Broca récupère la tête d'Ataï en octobre 1879, et fait effectuer un moulage de son visage. Le crâne d'Ataï sera présenté à l'Exposition universelle de Paris en 1889, puis il sera égaré (il existe cependant des doutes sur cette « disparition »). Pendant des décennies, le peuple kanak réclamera le retour de la tête d'Ataï, qui sera finalement « retrouvée » en 2014. Le 28 août 2014, les crânes d'Ataï et de Andja, son sorcier, sont remis officiellement aux clans coutumiers Xaracuu, représentés par Berger Kawa, le descendant d'Ataï. Le 1er septembre 2021, jour anniversaire de leur mort, ils sont inhumés définitivement au site funéraire de Wereha, un espace mémoriel de réconciliation à Fonwharry, là où vivait Ataï, près de La Foa. Le mausolée sera profané le 21 juillet 2024, les cercueils incendiés et les crânes volés.
Pour conclure cet épisode, le Rapport sur les causes de l’insurrection canaque en 1878, rédigé à Nouméa le 4 février 1879 par le Général de brigade A. de Trentinian, est édifiant :
Mus par un sentiment généreux, en prenant possession du sol, nous avons voulu réserver des droits aux canaques, pour vivre en bonne harmonie avec eux. Mais la colonisation a pris son essor, on a oublié les promesses premières, et l’on n’a pas songé qu’il en résulterait forcément une lutte avec celui dont on prenait le territoire sans l’avoir conquis. Le canaque vaincu comprend qu’on lui enlève la terre, il considère cela comme le prix de la défaite ; mais nous n’avions pas fait la conquête ; cependant il avait cédé, reculé, puis consenti à prendre des terres qui n’étaient pas très bonnes ; mais enfin acculé par les blancs qui avançaient toujours, il a médité de secouer le joug quand il a vu que bientôt il ne pourrait plus vivre. […] On aurait dû, puisqu’on foulait aux pieds les engagements, songer à cette loi qui régit les nations et qui elle-même cause les guerres européennes : l’intérêt des peuples, leur condition d’existence. L’Administration aurait dû prévoir l’envahissement des blancs, mais elle était plus envahissante que les autres et engageait ses agents dans cette voie. Malheureusement elle trouvait un Lécart (28) qui poussait les choses au-delà de toute limite et provoquait jusqu’à son summum la haine des canaques contre nous.
Nous pouvions éviter ce qui est arrivé, c’est-à-dire que l’administration aurait dû comprendre et forcer les colons à être plus prudents, et prendre elle-même des mesures de précaution vis-à-vis des indigènes pour arriver à un modus vivendi acceptable de part et d’autre. Il n’en a rien été (29).
1887 - Le Code de l'indigénat (30)
Le gouverneur Guillain jette les bases du futur Code de l'indigénat, formalisé en 1887, qui distingue deux catégories : les citoyens français (de souche métropolitaine) et les sujets français (Africains noirs, Malgaches, Algériens, Antillais, Mélanésiens et travailleurs immigrés). La seconde catégorie est privée d'une grande partie de ses libertés et de ses droits politiques. Il s'agit d'un asservissement des populations autochtones, dépouillées de leurs identités, et qui s'applique à l'ensemble des colonies françaises.
Pour les libérés, Guillain met en œuvre un principe de « propriété collective », de modèle dit « fouriériste » (31) dans les faits une politique de cantonnement. Il soumet les Kanak et les travailleurs immigrés à plusieurs jours de travaux forcés par an en faveur des colons et des autorités françaises, à l’interdiction de circuler la nuit et de porter des armes, aux réquisitions, aux taxes sur les réserves et à l'impôt de capitation (32) et à un ensemble de mesures toutes aussi dégradantes. Iels sont surtout intégré.es dans des « réserves autochtones » : il s'agit de faire régner le « bon ordre colonial », basé sur l'institutionnalisation de l'inégalité et de l'injustice. Ce code fut sans cesse « amélioré » pour adapter les intérêts des colons aux « réalités du pays ».
Le code de l'indigénat sera aboli (33) en trois étapes, de 1945 à 1947. (34) Les Kanak obtiendront alors la liberté de circulation, de propriété (relative), et leur statut civil particulier sera reconnu. Le droit de vote des Kanak, théoriquement accordé en 1946, ne sera que progressivement appliqué : 267 membres de l'élite mélanésienne pourront voter en 1946, puis la loi du 23 mai 1951 élargira le collège électoral indigène à 60 % des Mélanésiens en âge de voter. Quid des 40 % de Mélanésiens restants ?
En Algérie, le code de l'indigénat persistera jusqu'à l'Indépendance, en 1962 !
1889 - L'exposition Universelle de Paris
L'exposition universelle présente, à Paris, sur l'esplanade des Invalides, un « spectacle anthropo-zoologique », un zoo humain, composé de 400 personnes vivant sous occupation coloniale. Un village kanak y est exhibé à côté de Sénégalais, Alfourous, la pagode d’Angkor, les pavillons de Cochinchine, d’Annam et du Tonkin... Le programme, élaboré avec l’administration des colonies, a pour but de « réaliser une figuration rationnelle et attrayante à la fois de l’industrie, des mœurs, de l’aspect extérieur de chacun de nos groupes de possessions dans les différentes parties du monde » (35). La France, qui dispose à l'époque d'un empire colonial gigantesque - dix fois plus grand que la métropole - met en scène son pouvoir géopolitique, destiné à toiser les pays rivaux et à susciter le patriotisme français. Dans le « village nègre », on observe le « quotidien » des peuples représentés, tressant des nattes et des paniers en paille, tissant des étoffes, forgeant le fer. Des mises en scènes fantaisistes, destinées à provoquer l'effroi du public – qui fait la queue pendant des heures pour accéder au spectacle - évoquent le « sauvage cannibale et sanguinaire », l'animalité des populations colonisées que la colonisation a pour mission de « domestiquer ». Ces exhibitions infamantes induisent un sentiment raciste lié à la prétention de la « mission civilisatrice » de la IIIe République.
.jpg)
Jules Ferry, quelques années avant l'exposition, avait affirmé que « les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures », ce qui donne une idée assez précise des intentions et méthodes coloniales en Nouvelle-Calédonie. Les conditions de vie sont si difficiles pour les populations réquisitionnées que plusieurs personnes meurent, ne survivant pas au climat français.
1894 - Le « robinet d'eau sale »
Le gouverneur Feillet se prononce « contre le robinet d'eau sale » de la transportation, qui sera interrompu en 1897. Les convois de « transportés » et de « relégués » (36) s'arrêtent, mais il reste encore 8.230 personnes à la colonie. Le bagne est contesté par les colons libres, qui y voient une forme de concurrence déloyale liée à la main d'oeuvre gratuite des bagnards, et au fait que l'administration pénitentiaire réquisitionne les meilleures terres. La déportation de prisonniers politiques continuera jusqu'en 1931. En 1921, ils étaient encore 2.300.
Les révoltes - 1913/1917
Des révoltes importantes ont lieu en 1913 (37) mais surtout en 1917 (38). La guerre en France entraîne des besoins supplémentaires en approvisionnements et en mobilisation de soldats. Le code de l’indigénat soustrait les Kanak à la conscription, mais l'engagement volontaire est « autorisé ». L'administration coloniale promet des avantages (médailles, suppression des impôts de capitation (39) emplois réservés, citoyenneté, terres en toute propriété) mais profère aussi des menaces envers les tribus qui n'enverraient pas de volontaires. 979 Kanak se battent dans le Bataillon mixte du Pacifique, 382 seront tués. Les départs à la guerre perturbent la tenue des exploitations, le ravitaillement par la métropole s'amenuise, et les conditions de vie se dégradent en Nouvelle-Calédonie. En outre, les colons français sont contraints par l'administration coloniale d'étendre leurs élevages au détriment des territoires kanak, pourtant déjà largement spoliés de leurs terres ancestrales. En 1916 et 1917, deux cyclones très violents achèvent d'altérer la situation dans l'île.
Le 17 février 1917, des tribus loyalistes de Koniambo, au nord de la Grande Terre, sont attaquées par la tribu de Tiamou, menée par son chef Noël Néa Ma Pwatiba, après des échanges de menaces lors de la seconde campagne de recrutement.
En avril 1917, le chef de Tiamou brûle sa case en signe de révolte. Après l'arrestation de membres de sa tribu, il se réfugie dans la brousse avec d'autres membres de sa tribu et le chef Cavéat. Ils commencent une guérilla contre l'administration française qui les traque dans les montagnes jusqu'en mai 1918. Les autorités françaises offrent une récompense pour sa capture. Il sera décapité le 18 janvier 1918. La révolte est suivie par un procès à Nouméa en 1919. 78 hommes seront jugés, 61 condamnés et 2 guillotinés en 1920.
1931 - L'Exposition coloniale internationale
En 1931 se tient à Paris, à la Porte Dorée et au bois de Vincennes, dans un luxe effréné de constructions architecturales, l'Exposition coloniale internationale. Huit millions de visiteur.ses viennent faire « le tour du monde en une journée ». Le projet, impulsé en 1913 par Henri Brunel, chef de file du Parti colonial, tentait, selon le souhait de Gambetta (40), de compenser la perte de l'Alsace et de la Lorraine à la suite de la guerre franco-prussienne de 1870. L'exposition se veut le reflet de la puissance coloniale de la France, de sa « mission civilisatrice » dans les colonies, ainsi qu'un outil économique au service des industriels métropolitains et coloniaux : montrer les bénéfices de la colonisation sur l'économie française.

La Fédération française des anciens coloniaux, avec l'assistance soutenue du gouverneur de Nouvelle-Calédonie Joseph Guyon et de son chef de cabinet, « recrutent » une centaine de Kanak pour présenter leurs danses et leur culture à l'exposition, leur promettant également de leur faire visiter la capitale. En mars 1931, à leur arrivée à Marseille, les Kanak sont, non pas envoyé.es à Vincennes où se tient l'exposition coloniale, mais au zoo du Jardin d'acclimatation.
Joël Dauphiné (41) : On leur demandait de simuler l'acte du cannibalisme. On leur faisait pousser des cris gutturaux, [on leur faisait faire] des gesticulations désordonnées, on leur faisait brandir des casse-têtes, on mettait autour de leurs cous des amulettes, des fétiches. Le but, c'était essentiellement de les « cannibaliser ». […] Un metteur en scène du Châtelet avait organisé des saynettes qui figuraient dans un programme distribué à l'entrée, et s'intitulait naturellement « Les cannibales ».
Témoignage de l'époque : J'ai vu nos pauvres indigènes au Jardin d'acclimatation. Ils sont furieux car ils n'ont presque pas de linge. En arrivant à Marseille, on ne leur a donné qu'une vareuse rouge, un tricot et un caleçon de bain. Beaucoup sont pieds nus et ils grelottent de froid, on ne leur a donné aucun vêtement chaud. Ils dansent le pilou-pilou, les danses de guerre, en manous et tricots et ce, en plein hiver. (42)
Plusieurs Kanak meurent de maladies en raison des conditions sanitaires déplorables qui leur sont réservées. En mai 1931, iels sont divisé.es en trois groupes : un groupe demeure à Paris, les deux autres sont envoyés en tournée dans des zoos en Allemagne (Hambourg, Berlin, Munich, Francfort), puis à Vienne en Autriche. La Fédération des anciens coloniaux a passé un contrat commercial exclusif avec le cirque allemand Hagenbeck, pour un spectacle intitulé « Les derniers cannibales des mers du sud ».
Lettre de Hamburg d'un Kanak au ministre des colonies : Mais en arrivant à Paris au mois d'août, cette société (43) dont M. Pourroy est l'un des membres a changé de parole et nous a dit que le gouverneur Guyon a signé avec lui un contrat de deux ans en France et ce n'est plus sept mois comme promis en Nouvelle-Calédonie […] Monsieur le ministre, nous nous désolons complètement, et nous ne voulons plus rester.
Les Kanak rentrent finalement chez eux en novembre 1931. Le gouverneur de Nouvelle-Calédonie Joseph Guyon et son chef de cabinet furent, l'un mis à la retraite anticipée, le second à l'écart. (44)
Tout cela, dit Pascal Blanchard (45), n'est qu'une construction de propagande, qui crée un rapport à l'autre totalement perverti. L'image ment, le discours ment, le texte ment, et même la réalité ment. Et cet ensemble construit un imaginaire totalement faussé dont les conséquences aujourd'hui sont la méconnaissance totale de l'autre […] La république récupère les Kanak pour les instrumentaliser dans le cadre de son discours de propagande coloniale.
Le dernier grand zoo humain en Europe se tient en 1958. La section « Congo belge » de l'exposition universelle de Bruxelles « accueille » près de 600 Congolais.es dans un village congolais reconstitué, où figure une pancarte : « Ne donnez pas à manger aux Congolais, ils sont nourris »... (46)
Années 1940-1950
Depuis 1946, la Nouvelle Calédonie a connu un nombre impressionnant de changements de statuts, selon les orientations politiques des différents gouvernements français.
Février 1944 – De Gaulle, qui dirige le Comité Français de Libération Nationale (CFLN (47)), organise à Brazzaville une réunion destinée à rétablir son autorité dans les colonies françaises d'Afrique. Il écarte toute idée d'indépendance, ce qui vaut pour la Nouvelle-Calédonie. (48)
1945 – Suppression du code de l'indigénat en trois étapes (de 1945 à 1947). L'accession des Kanak aux droits civiques entraîne la création du Parti Communiste Calédonien par Jeanne Tunica y Casas, Florindo Paladini et le grand-chef Henri Naisseline, en 1945. Le sénateur communiste de La Réunion Fernand Colardeau, natif de Nouméa, dépose en juin 1947 une proposition de loi pour un nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie, prévoyant la nationalisation des banques et des grands commerces, la citoyenneté généralisée, un double collège pour une assemblée représentative indigène distincte, l'abolition de la capitation (56)), le soutien aux écoles libres, la création d'une police indigène ou encore l'inviolabilité des réserves. (49) Des milliers de Kanak deviennent communistes. En réaction, deux associations religieuses (58), l'une catholique, l'autre protestante sont créées, en 1945 et 1947. Elles se rejoindront sur les listes de l'« Union Calédonienne » qui naît en 1953 et devient, en 1956, un parti politique majoritaire représentant toutes les communautés, dont la communauté kanak.
1946 – La Calédonie passe du statut de colonie à celui de TOM (50) par la constitution du 27 octobre. Un gouverneur, chef du territoire, assisté d'un conseil privé, y représente l'Etat. Un plan décennal d’équipement du Territoire prépare la relève de la présence américaine (51). Les Kanak accèdent cette année-là à la citoyenneté, au droit de vote et au droit d'être élus. Mais leur droit de vote est restreint pendant 10 ans par l'Etat, de peur d'un déséquilibre électoral : ils sont en légère majorité...
1956 – Sous le Président René Coty, la loi-cadre « Defferre », initialement prévue pour l'Afrique, donne à la Nouvelle-Calédonie son premier statut d'autonomie interne avec un gouvernement local. Le Conseil Général devient Assemblée territoriale. La présidence revient au Gouverneur (chef du territoire nommé par la métropole), mais le vice-président et 5 à 7 ministres sont élus à la représentation proportionnelle. Pour la première fois, un gouvernement local est expérimenté. Tous les membres de ce conseil de gouvernement sont issus de l' « Union Calédonienne » (52) dont la devise sera : « deux couleurs, un seul peuple »...
En 1957, sous René Coty, les lois « Defferre » apportent un peu plus d'autonomie à la Nouvelle-Calédonie.
Années 1960-1970
Au début des années 60, un mouvement de décolonisation s'amorce dans les colonies françaises, mais il se produit l'inverse en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires du Pacifique : en 1963, sous De Gaulle, le Conseil de gouvernement (calédonien) est placé sous l'autorité du Gouverneur (nommé par l'Etat français) ; en 1968, la « loi Billotte » retire à l'Assemblée territoriale l'essentiel de ses pouvoirs.
Car la Nouvelle-Calédonie devient stratégique pour la France : elle possède l'une des plus grosses réserves mondiales de nickel. Par ses vertus anticorrosion, le nickel est crucial pour l'industrie française dans les secteurs de l'aéronautique et des biens de consommation. De plus, après l'indépendance de l'Algérie proclamée en 1962, la France déplace ses essais nucléaires du Sahara vers la Polynésie, et s'inquiète de conséquences contagieuses d'une autonomie de la Nouvelle-Calédonie. Au début des années 60, la France y envisage même l'ouverture d'un site d'essais nucléaires.

Avec le « boom du nickel », le contexte économique favorable entraîne la mise en œuvre de grands travaux. Entre 1969 et 1976, la population s'accroît de 20.000 immigrant.es, conformément à la directive de Pierre Messmer, Premier ministre de Pompidou, qui donne explicitement, et plutôt crûment, les orientations de l'Etat français en matière de politique calédonienne :
La Nouvelle-Calédonie, colonie de peuplement, bien que vouée à la bigarrure multiraciale, est probablement le dernier territoire tropical non indépendant au monde où un pays développé puisse faire émigrer ses ressortissants. [...] A court et moyen terme, l’immigration massive de citoyens français métropolitains ou originaires des départements d’outre-mer (Réunion) devrait permettre d’éviter ce danger en maintenant et en améliorant le rapport numérique des communautés. A long terme, la revendication nationaliste autochtone ne sera évitée que si les communautés non originaires du Pacifique représentent une masse démographique majoritaire. Il va de soi qu’on n’obtiendra aucun effet démographique à long terme sans immigration systématique de femmes et d’enfants (53).
On entend, dans cette déclaration, des échos futuristes des positions actuelles du gouvernement français. La population kanak, depuis 1945, était en augmentation. En 1972, Messmer pointe le risque qu'elle devienne majoritaire et indépendantiste. Il organise des migrations importantes des territoires d'Outre-mer (Réunion, Wallis-et-Futuna, Polynésie) et de métropole, « afin de diluer la part des Kanak dans la population calédonienne […] Résultat, alors que ces derniers ont une natalité plus dynamique que celle des Européens, leur poids relatif se met à baisser dans la population de l’archipel. » (54) En 1976, si les Kanak forment une communauté plus importante que les Européen.nes (55.000 contre 50.000), d'autres communautés tempèrent leur potentielle majorité, Asiatiques, Polynésien.nes etc.
Mai 68 et le « Réveil kanak » - Des étudiants kanak qui poursuivent leurs études en France dans les années 60 reviennent profondément marqués par mai 68, les doctrines marxistes, décoloniales et tiers-mondistes. Ils adaptent les modes d'actions des étudiant.es parisien.nes aux réalités calédoniennes et engagent le « réveil kanak », qui surgit précisément au moment où la Nouvelle-Calédonie devient un enjeu stratégique pour l'Etat français. Le mouvement de marche arrière de l'Etat en matière de politique calédonienne, la politique offensive de peuplement de Messmer, suscitent l'émergence de deux groupes, le « groupe 1878 », en hommage à Ataï, et le groupe des « Foulards rouges », en hommage à Louise Michel. La contestation politique se double d'une réflexion sur l'identité kanak, d'une réappropriation de son héritage culturel, qui sont aux racines de la lutte indépendantiste. Les groupes se structurent en partis, puis convergent en juin 1979 vers le « Front indépendantiste », dont Jean-Marie Tjibaou sera le leader. Les loyalistes (caldoches et kanak – comme il existe des indépendantistes caldoches) créent leur propre Parti : le Rassemblement pour la Calédonie dans la république (RPCR – en hommage au RPR de Chirac), fondé par Jacques Lafleur en 1977.
1975 – Sous le Président Giscard-d'Estaing, création, le 25 juin du « Comité pour l’Indépendance Kanak », à la suite du retour d’une délégation d’élus en mission à Paris qui n’a pas été écoutée par le gouvernement français.
1976 – Le statut « Stirn » donne au conseil de gouvernement de sept membres un pouvoir délibératif. Ce conseil reste présidé par le Haut-Commissaire, nommé par l'Etat français. Les sept membres ne sont pas ministres, mais chargés de contrôler et d’animer des secteurs administratifs.
1979 – Un « statut Dijoud » est créé, qui ne change pas fondamentalement l’organisation statutaire, sauf l’élection du conseil de gouvernement qui se fait désormais au scrutin de liste majoritaire. Le ministre Dijoud, secrétaire d'Etat aux DOM-TOM, initie la réforme foncière, qui permettrait aux tribus mélanésiennes de s'agrandir en retrouvant certaines de leurs terres, ou en en acquérant de nouvelles. Naissance du « Front Indépendantiste », qui deviendra le FLNKS en 1984.
Les années 1980
En 1981, l'arrivée des Socialistes au pouvoir est une véritable source d'espoir pour les Kanak. Le discours de Mitterrand fait présager un changement possible :
On a fondé une Calédonie moderne sur un état d'injustice que je déclare insupportable ! Ils sont arrivés, les Kanak, à l'exaspération ! Et nos réformes ont été digérées tout aussitôt parce que ce n'était pas la réforme qui intéressait une population qui ne marchait plus, c'était l'indépendance.
Depuis 1981 et l'assassinat (jamais élucidé) de l'indépendantiste Pierre Declercq (55), les relations entre Kanak et Caldoches se dégradent. Le statut de l'île et l'équilibre du pouvoir dans les institutions locales provoquent des troubles : les Kanak ne représentent plus qu'un tiers de la population dans leur propre pays. Des affrontements violents ont repris : des militants et leaders indépendantistes du FLNKS sont assassinés, des incendies et pillages d'éleveurs caldoches organisés. La Nouvelle-Calédonie est au bord de la guerre civile.
Le massacre de Waan Yaat (Hienghène) ou la « légitime défense par anticipation »...
Le massacre de Waan Yaat intervient juste avant l'assassinat d'Eloi Machoro. Les deux épisodes sont mêlés dans le temps. On les distinguera ici pour une meilleure compréhension des situations.
Le 5 décembre 1984, à Waan Yaat, dans la vallée de Hienghène (56) (57), 7 métis loyalistes tendent une embuscade à des militants kanak du FLNKS revenant d'une réunion politique. Jean-Marie Djibaou, censé se trouver dans l'un des véhicules, est retenu à Nouméa pour rencontrer Edgar Pisani (61). Les 7 hommes ouvrent le feu. Les 17 passagers, sans armes, sont pris au piège. Plus de 300 coups de feu sont tirés. Les véhicules sont incendiés, les indépendantistes poursuivis et certains achevés à bout portant. C'est un carnage : 10 militants sont assassinés (dont 2 frères de Tjibaou, Vianney et Louis), et 7 autres grièvement blessés. Tjibaou déclare, le lendemain : « J'espère que la réconciliation viendra assez vite. Mais je pense que ce sera dur ». Au journaliste qui l'interroge sur ce qu'il a au fond du cœur, il répond : « J'essaie de ne pas avoir de haine ». Il demande aux indépendantistes de lever tous les barrages, pour apaiser la situation.
Les assassins, après une semaine de fuite dans la forêt, se rendent aux gendarmes, et font des aveux complets : ils ont assassiné, avec préméditation, les Kanak désarmés, sans leur laisser aucune chance. Ils sont incarcérés en attente de leur procès. Des comités de soutien se cotisent pour payer leurs frais de justice : les loyalistes les considèrent comme des héros.
Le 7 janvier 1985, Pisani propose un nouveau statut, intégrant une meilleure reconnaissance de l'identité kanak, une décentralisation et une déconcentration des pouvoirs. Cette proposition n'emporte les suffrages ni des indépendantistes, ni des loyalistes.
Le 11 janvier 1985, un jeune caldoche, Yves Thual, est tué par des Kanak. Des émeutes anti-indépendantistes éclatent à Nouméa, 48 blessés et 51 arrestations. Le 12 janvier, Eloi Machoro (62) est abattu par le GIGN. Les loyalistes fêtent bruyamment sa mort. Jean-Marie Djibaou déclare un assassinat politique. Pisani déclare l'état d'urgence le lendemain. Une semaine plus tard, Mitterrand fait une visite à Nouméa, annonce l'élaboration d'un nouveau statut, et lance un appel au calme : meurtres, incendies, émeutes, barrages, sabotages répondront à son appel, immédiatement suivis par la répression, des arrestations et opérations militaires.
L'arrivée de Chirac au pouvoir le 20 mars 1986, en tant que Premier Ministre de cohabitation, n'améliore pas la situation. En mars 1986, les indépendantistes boycottent les élections législatives. Mitterrand n'a rien fait pour aider les Kanak, Chirac va tout faire pour les stopper. Il annule les projets de nouveaux statuts, envoie l'armée sur le territoire, « méthode néo-coloniale classique utilisée pour mater toute tentative d'insurrection ». Le FLNKS entre dans la clandestinité : « Il ne participera plus à aucun scrutin tant qu'il ne concernera pas exclusivement un électorat kanak. Sans quoi, minoritaire électoralement et démographiquement, ils n'ont aucune chance (69)».
.jpeg)
Le 29 septembre 1986, le juge d'instruction qui opère pour le procès des 7 assassins de l'embuscade de Waan Yaat, décide un non-lieu pour cause de « légitime défense par anticipation » : « Les 7 meurtriers auraient ainsi mené une action préventive contre les indépendantistes qui auraient pu mener une action violente »... Mais la chambre d'instruction renvoie les accusés devant la cour d'assises, en contradiction du juge d'instruction.
Le 17 octobre 1987, les 7 accusés, Maurice Mitribe, Robert Sinéméné, Raoul Lapetite et ses 4 fils, Jacques, Jean-Claude, Jess et José, sont jugés à Nouméa pour « assassinat et violences volontaires avec préméditation et avec armes ». Le jury n'est constitué que de Caldoches et d'Européens. C'est un « déni de justice érigé en système. »
Le procès est enregistré. Olivier Pighetti, le réalisateur de Nouvelle-Calédonie, l’invraisemblable verdict (2023), a eu accès aux enregistrements. Lapetite père dit regretter son geste, il n'est pas un assassin, mais un homme d'honneur, s'ils ont tiré, ce n'est pas de leur faute, ils avaient à faire à des terroristes. S'ils n'avaient pas agi, ce n'est pas 10 morts qui auraient eu lieu, mais 2.000. Il déclare : « Mais il y a des responsables, malheureusement ces responsables (les Kanak) ne sont pas à la barre aujourd'hui »... L'avocat des 7 meurtriers, Henri-René Garaud (63) proche de l'extrême droite, est le fondateur de l'Association pour la légitime défense, et milite pour le rétablissement de la peine de mort. C'est donc à partir de la légitime défense qu'il va baser sa plaidoirie : après le fracassement d'une urne électorale, le 18 novembre 1984, par Eloi Machoro, dans le contexte d'une situation insurrectionnelle, les Caldoches ont peur pour leurs biens et leurs vies. Jean-Marie Tjibaou, qui témoigne au procès, rappelle de son côté le contexte de la colonisation et la spoliation des terres des Kanak (65) :
Un bien volé réclame toujours son propriétaire. Là est le fondement du contentieux. Nous n'avons jamais accepté d'être spoliés de la souveraineté sur nos terres et sur notre pays.
Garaud, l'avocat des 7 accusés, pousse à ses limites le concept de « légitime défense » : les forces de l'ordre n'étaient plus là pour faire respecter la loi (les autorités administratives éviteront d'ailleurs, de témoigner au procès) :
On ne répare pas un grand malheur en commettant une injustice. Qu'auriez-vous fait à leur place ? A qui la faute ? Voilà les deux questions. A Hienghène, on était heureux, et après le 18 novembre, et bien ce fut l'enfer ! Neuf ans de réclusion criminelle ? Mais j'en frémis ! Regardez-les ces hommes ! Non, ils ne sont pas coupables ! Non ce drame n'est pas de leur faute ! Mais pour vous-mêmes, pour votre conscience, acquittez-les ! Acquittez-les, et vous serez en paix avec votre âme.
Le jury, dont nous rappelons qu'il est composé uniquement de Caldoches et d'Européens, déclare, sous des salves d'applaudissements et aux cris de « Vive la France », que les 7 assassins (66) sont acquittés.
Jean-Marie Tjibaou, à la suite du procès, estime que la « chasse aux Kanak est ouverte », et que la lutte armée va s'imposer.
1984 - Eloi Machoro (67)
Dans la brousse, l'accès à l'éducation est difficile. Il passe par les missionnaires, catholiques ou protestants. Eloi Machoro est brillant à l'école et il est envoyé au séminaire de Saint Léon de Païta. Il y rencontre Jean-Marie Tjibaou, qui se destine à la prêtrise. Puis Tjibaou part à Paris continuer ses études, et Machoro à Nouméa suivre des études d'instituteur. En 1974, il est en poste à Canala. Il enseigne à ses élèves l'histoire de son peuple, et développe ses talents d'orateur. En 1977, lors du Congrès de l'Union calédonienne à Bouraï, il commence à afficher ses convictions politiques. Tjibaou revient en Calédonie, après avoir vécu mai 68 à Paris et en avoir rapporté quelques idées expérimentales. Avec Machoro, ils transforment l'Union calédonienne en parti indépendantiste. Machoro devient le bras droit de Pierre Declercq, qui dirige l'Union calédonienne. Celui-ci est assassiné le 19 septembre 1981. Machoro lance une vaste opération d'occupation des terres. Les armes sont sorties. Les funérailles de Declercq ramènent le calme et Machoro devient Secrétaire Général du parti. On attend des signes de Paris, qui ne viennent pas. Les manifestations se multiplient, des affrontements ont lieu à Nouméa.
En 1983, Georges Lemoine, secrétaire d'Etat à l'Outre-mer, organise des négociations d'une semaine à Nainville-les-Roches, avec tous les partis calédoniens. Machoro accompagne Tjibaou. En date du 12 juillet 1983, une déclaration est rédigée, qui marque les trois points principaux (extraits) :
I - Volonté commune des participants de voir confirmer définitivement l’abolition du fait colonial par la reconnaissance à l’égalité de la civilisation mélanésienne et la manifestation de la représentativité par la coutume dans les institutions à définir.
II - Reconnaissance de la légitimité du peuple kanak, premier occupant du Territoire, se voyant reconnaître, en tant que tel, un droit inné et actif à l’indépendance, dont l’exercice doit se faire dans le cadre de l’autodétermination prévue et définie par la Constitution de la République Française, autodétermination ouverte également, pour des raisons historiques, aux autres ethnies dont la légitimité est reconnue par les représentants du peuple kanak.
III - Favoriser l’exercice de l’autodétermination est « une des vocations de la France » qui doit permettre d’aboutir à un choix, y compris celui de l’indépendance.
Les Kanak ont accepté d'ouvrir le vote aux « victimes de l'histoire », les héritier.es des ancien.nes bagnard.es, mais les participant.es ne sont pas parvenu.es à se mettre d'accord sur un statut commun. Machoro est déçu de cette occasion manquée. Lors de la venue en Nouvelle-Calédonie de Lemoine, qui annonce un référendum sur l'avenir du pays dans les cinq ans, Machoro force le barrage de police et l'interpelle : il lui présente le drapeau kanak comme futur drapeau du pays.
En juillet 1984, l'Assemblée nationale vote le « statut Lemoine », qui n'intègre aucun des amendements proposé par l'Union calédonienne. Machoro et Tjibaou créent le FLNKS, qui rassemble plusieurs partis indépendantistes. Machoro part en Lybie avec 17 stagiaires pour une formation de stratégie politico-militaire. Le combat politique change de dimension.
.jpg)
Le 18 novembre 1984, ont lieu les élections territoriales, pour lesquelles le FLNKS a appelé au boycott : Machoro brise une urne de vote à coup de hache traditionnelle dans la mairie de Canala, où il enseigne. Il fait des élections une tribune pour dénoncer un vote perdu d'avance, dans un pays où les Kanak, à la suite des politiques successives de peuplement, sont devenu.es minoritaires. Un bras de fer s'engage entre les indépendantistes et le gouvernement : barrages, mairies occupées, urnes détruites. L'abstention dépasse 80 % chez les Kanak.
Machoro : Il n'a jamais été dit que nous allions jeter les autres gens à l'extérieur, on reconnaît leurs droits sur ces terres, mais on veut d'abord qu'ils reconnaissent nos droits de premiers occupants, ensuite on pourra discuter avec eux, parce que eux comme nous, on est appelés à vivre et à mourir ensemble dans ce pays.
Machoro décide de frapper plus fort et de s'attaquer à l'industrie du nickel, richesse qui représente à ses yeux le colonialisme calédonien et dont les Kanak sont exclu.es : aucun.e Kanak ne siège dans les instances de gouvernance de la Société Le Nickel (SLN) détenue par la multinationale minière française Eramet. Le 20 novembre 1984, Machoro organise le blocus du village de Thio : barrages routiers et blocus maritime coupent l'île de sa plus importante ressource économique. Le drapeau de la Kanaky flotte sur la mairie. Le pays bascule dans une atmosphère de guerre civile.
Un Caldoche : Nous, on fera notre loi nous-mêmes. Parce que Machoro fait sa loi là-bas, et Machoro on aura sa peau. Machoro on aura sa peau. Et qu'il fasse gaffe ! Machoro on aura sa peau (67).
Jean-Marie Tjibaou, dans le même temps, forme le gouvernement provisoire de la République socialiste de Kanaky, et nomme Machoro ministre de la sécurité. Pour l'Etat français, c'est une déclaration de guerre. Le lendemain, 21 novembre, une vaste opération militaire est lancée pour libérer Thio. Machoro, maître de la ville, a confisqué les armes des habitant.es pour éviter les dérapages. Les membres du GIGN, à peine arrivés, sont encerclés par les hommes de Machoro, qui les ramènent à la gendarmerie, avant de les obliger à quitter la ville. Aucun coup de feu n'est tiré.
Gérard Cortot (68) : On aura tout entendu sur Eloi. Quand Thio était bloqué, Eloi Machoro mangeait un gamin à chaque petit déjeuner. Et quand je suis allé en discuter, des gens qui n'étaient pas indépendantistes disaient : « Heureusement qu'il était là, il a totalement évité un bain de sang sur Thio » (69).
Gaétan Dohouade, compagnon de lutte de Machoro : Il nous disait toujours : ne pas tirer. Ne jamais tirer sur les Européens. Vous devenez des assassins. Vous allez tirer sur un Kanak, vous n'êtes pas un assassin. Vous allez tirer sur un Européen, vous êtes un assassin, on va venir vous chercher (70).
La sœur de Machoro, Caroline, explique : Il était chargé, en tant que ministre de la guerre, à la fois de défendre, mais aussi de créer sur le terrain, un rapport de force qui permettrait à Jean-Marie (Tjibaou), qui était chargé de discuter avec la France, avec l'Etat, de négocier (71).
Le 4 décembre 1984, Edgar Pisani, Haut commissaire de la République chargé de la Nouvelle-Calédonie, arrive dans l'île pour tenter de restaurer le dialogue. Le 5 décembre, une embuscade loyaliste est tendue à Waan Yaat, dans la vallée de Hienghène : 10 Kanak sont tués, 7 autres gravement blessés. Tjibaou appelle cependant à lever le blocus de Thio pour pouvoir démarrer les discussions avec Pisani. Machoro ne comprend pas cette décision : pour négocier, il faut maintenir la pression. Il reste à proximité avec ses troupes, prêt à refermer le blocus.
Le 11 janvier 1985, la mort d'un jeune caldoche de 17 ans, Yves Thual, relance les tensions. Malgré ses appels à ne pas tirer, Machoro est considéré coupable par les loyalistes et l'Etat français, qui veut le neutraliser. Il passe à la clandestinité avec ses hommes, traverse l'île vers l'ouest, la zone européenne. Il veut couper l'île en deux, en barrant la route de Bouraï à Nouméa.
Le 12 janvier 1985 à l'aube, le GIGN et 120 gendarmes encerclent une maison à la Foa, où Machoro s'est réfugié avec ses hommes. Selon la version du Haut commissariat, ils ont été sommés toute la nuit de se rendre. Grenades lacrymogènes, puis grenades offensives sont lancées. Les tireurs d'élite prennent position, il a une minute pour se rendre, il refuse, il reçoit une balle dans le sternum. Son compagnon, Marcel Nonnaro, est tué. Les circonstances de la mort de Machoro opposent le GIGN (« neutralisation d'un chef de guerre ») et les indépendantistes (« assassinat ciblé »). Pour Jean-Marie Tjibaou, il s'agit d'un « assassinat politique ».
Le tir sur Machoro a été effectué par deux tireurs du GIGN, dont le capitaine Jean-Pierre Picon, qui sera mêlé aux événements de la grotte d'Ouvéa, en 1998.
Gaétan Dohouade, compagnon de lutte de Machoro : Moi je me disais, mais lui là, que vous avez abattu, vous ne savez pas que vous avez abattu celui qui vous défendait ? Pour pas que nous, on soit à tuer les Européens, c'est lui qui nous arrêtait. Vous l'avez abattu, mais c'est lui qui vous défendait (72).
Christian Christnacht, Haut commissaire en Nouvelle-Calédonie de 1991 à 1994 : Ca n'a été une bonne nouvelle pour personne, y compris pour les Européens, contrairement à ce que... Ils (les loyalistes) ont réagi avec satisfaction, pour ne pas dire avec indécence, c'est une réaction épidermique. Mais sur le fond politique, ça rendait une solution politique encore plus compliquée (73).
Tous les 12 janvier, une cérémonie a lieu sur la tombe d'Eloi Machoro dans la tribu Naketi. Sa mort sera le début d'une escalade de violence qui culminera avec la grotte d'Ouvéa, en 1998.
1988 – La grotte d'Ouvéa (74)
En février 1988, 10 gendarmes sont pris en otage par des Kanak, puis relâchés, et 15 indépendantistes sont arrêtés. En mars 1988, Pons, informé que des opérations se préparent, envoie 840 CRS et gendarmes en Nouvelle-Calédonie, portant à 3.000 hommes les effectifs sur place. La tension monte encore.
Le 22 avril 1988, deux jours avant le premier tour des élections présidentielles qui opposent le Président François Mitterrand à son Premier ministre Jacques Chirac, des indépendantistes attaquent une gendarmerie à Fayaoué, sur l’île d’Ouvéa. Quatre gendarmes sont tués et 27 autres faits prisonniers. A la libération des détenus, sont posées trois conditions : le retrait des forces de l’ordre, l’annulation des élections régionales (le boycott des indépendantistres avait faussé les résultats) et la nomination d’un médiateur pour « discuter d’un véritable référendum d’autodétermination ». D'autres incidents ont lieu, à Canala notamment, commune isolée par l'Armée qui incendie plusieurs maisons kanak.
Chirac arrive second au premier tour des élections, mais n'en reste pas moins Premier ministre : il a déjà dépêché la gendarmerie mobile, le RIMaP (75), des unités du Régiment d'infanterie et du Régiment parachutiste, mais il envoie également ses troupes d’élite : 48 gendarmes du GIGN (76) et de l'EPIGN (77), des hommes du Choc (78), des fusiliers-marins du commando Hubert, et une équipe lance-flammes du Régiment du génie parachutiste. L’île d’Ouvéa est déclarée « zone militaire » et interdite aux journalistes. « Normalement », seuls l'état d'urgence ou létat de siège autorisent l'Armée à récupérer les pouvoirs de l'autorité civile, ce qui ne semble pas préoccuper Chirac et Pons. « Comme si la France était en guerre contre un pays étranger (79) »...
Le 25 avril, les otages retenus au nord sont libérés, mais ceux du sud restent introuvables. La population de Gossanah, suspectée d'être liée aux ravisseurs, est très violemment « interrogée » : coups, matraquages, simulacres d’amputation et d’exécution... (80) Les otages sont finalement localisés dans la grotte d'Ouvéa. Le GIGN investit la zone dans la nuit du 26 au 27 avril.
La situation se complique de deux points de vue antinomiques : celui du chef du GIGN, Philippe Legorjus, dont le récit des événements, La morale et l'action sera à l'origine du film de Matthieu Kassovitz, L'ordre et la morale ; et celui de Jean Bianconi, premier substitut du procureur de Nouméa qui a vécu avec lui les événements, et conteste, plutôt virulemment, sa version des faits (81).
Philippe Legorjus tente d'engager des négociations avec les indépendantistes, mais échoue. Le 1er mai, Mitterrand tente de convaincre Chirac de mener une mission de conciliation, ce que celui-ci refuse. A Nouméa, « l'opération Victor », (l'attaque de la grotte) est en préparation, mais Mitterrand donne l'ordre « de ne pas exécuter les Kanak ». Le général Vidal, chef des Forces Armées de Nouvelle-Calédonie et chef des opérations, annonce le report de l'opération : le 4 mai Chirac annonce la libération de 3 otages au Liban, et l'Elysée soupçonnera que le report est opportunément lié à la libération des otages (laisser à l'événement un espace médiatique favorable et suffisant).
Le 5 mai 1988, l'assaut est donné ; libération des otages, mort de 19 Kanak et de 2 membres des forces d'intervention. Alphonse Dianou, chefs des preneurs d'otages, est blessé superficiellement à la suite de sa reddition, mais n'arrivera pas en vie à l'hôpital.
En 2008, dans une émission de France Culture, Michel Rocard avoue :
Ce que je savais, moi – et que j’étais le seul à savoir […] c’est qu’il y avait aussi des officiers français… enfin, au moins un et peut-être un sous-officier, on ne sait pas très bien… A la fin de l’épisode de la grotte d’Ouvéa, il y a eu des blessés kanak et deux de ces blessés ont été achevés à coups de bottes par des militaires français, dont un officier. […] Il fallait prévoir que cela finisse par se savoir et il fallait donc prévoir que cela soit garanti par l’amnistie (82).
Le Parlement français a voté cette loi d’amnistie ignominieuse, qui a couvert ces officiers, et aussi le fait que, sur 19 cadavres kanak décomptés le 5 mai, les constatations médico-légales ont avéré que 12 d’entre eux avaient une balle dans la tête (83).
Jean-Pierre Chevènement, ministre de la Défense de Mitterrand réélu, « dénonce des ''actes contraires à l’honneur militaire '' mais se contente de ce rapport, ne voulant pas se mettre l’armée à dos. (84) »
Notes
- (1) https://www.dokamo.nc/commeoration-de-nainville-les-roches-1983/
- (2) https://www.senat.fr/rap/l23-441/l23-4416.html
- (3) Qu'on pourra lire in extenso ici : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000555817
- (4) Front de libération nationale kanak et socialiste.
- (5) Rassemblement pour la Calédonie dans la République, lié à Chirac.
- (6) Congrégation dédiée à la Vierge.
- (7) La colonie de peuplement, c'est la confiscation des terres « indigènes » pour les colons, Christelle Taraud, https://shs.cairn.info/idees-recues-sur-la-colonisation--9791031802640-page-49?lang=fr
- (8) Traité de paix signé le 10 février 1763 entre la France et l’Espagne d’un côté, la Grande-Bretagne et le Portugal de l’autre, qui met fin à la guerre de Sept Ans (1756-1763).
- (9) Cynthia Debien-Vanmaï, La nouvelle Calédonie de la fin du XIXème siècle au début du XXème siècle, https://histoire-geo.ac-noumea.nc/spip.php?article101=&artpage=2-2&lang=fr
- (10) Joël Dauphiné, Les spoliations foncières, L’harmattan, 1989, p 41.
- (11) Le gouverneur dispose de vastes pouvoirs : justice, police, législation foncière, économique et fiscale.
- (12) https://criminocorpus.org/fr/legislation/textes-juridiques-lois-decre/textes-relatifs-a-la-deportati/acces-aux-textes/loi-du-30-mai-1854/
- (13) Participant.es de la Commune insurrectionnelle de Paris en 1871.
- (14) Cynthia Debien-Vanmaï, La nouvelle Calédonie de la fin du XIXème siècle au début du XXème siècle, https://histoire-geo.ac-noumea.nc/spip.php?article101=&artpage=2-2&lang=fr
- (15) Lèpre (1866, dès 1862 aux Loyauté, via des Samoans), dengue (1883, 1908), variole (1893), blennoragie, pian, syphilis.
- (16) Voir l'anthropologue du CNRS Michel Naepels : https://lejournal.cnrs.fr/articles/nouvelle-caledonie-165-ans-dune-histoire-mouvementee.
- (17) Paris, Calmann-Lévy, 1947.
- (18) La partie de la population d'origine européenne, installée en Nouvelle-Calédonie depuis la colonisation commencée au milieu du XIXe siècle.
- (19) Bernard Brou, La déportation et la Nouvelle-Calédonie, voir : https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1978_num_65_241_2146
- (20) La célèbre évasion de Rochefort, journaliste communard, et de cinq de ses amis, semble avoir bénéficié de complicités incluant le gouverneur et le directeur de l'administration pénitentiaire.
- (21) Institutrice et écrivaine féministe, l'une des figures majeures de la Commune de Paris-1871, déportée en Nouvelle-Calédonie.
- (22) In Mehdi Lallaoui, Le retour d'Ataï, film de 2017, Société des Océanistes & Mémoires vives productions.
- (23) https://www.lemonde.fr/societe/article/2014/06/13/petite-histoire-de-la-guerre-datai_4438034_3224.html. A la fin de cet article, un lien sur un autre témoignage, celui d'un ardéchois, le Caporal Dubois.
- (24) https://www.commune1871.org/la-commune-de-paris/histoire-de-la-commune/a-l-heure-du-bilan/542-nouvelle-caledonie-le-retour-d-atai
- (25) Michel Millet, 1878, Carnets de campagne en Nouvelle-Calédonie, édit. Anacharsis, 2013.
- (26) https://maitron.fr/spip.php?article24872. Le nom de « Foulards rouges » a été donné à un mouvement de lutte kanak, fondé en 1969 par Nidoïsh Naisseline, et constitue un hommage à l'écharpe de Louise Michel.
- (27) Mehdi Lalloui, op.cit.
- (28) Les anciens bagnards.
- (29) Lallaoui, op.cit.
- (30) Directeur du pénitentier.
- (31) https://ehne.fr/fr/eduscol/premiere-generale/la-troisieme-republique-avant-1914-un-regime-politique-un-empire-colonial/metropole-et-colonies/1887-le-code-de-l'indigenat-algerien-est-generalise-a-toutes-les-colonies-francaises
- (32) Charles Fourier, socialiste dit « utopique » du XIXe, créateur des phalanstères. Voir https://francearchives.gouv.fr/authorityrecord/FRAN_NP_052612
- (33) Impôt prélevé indépendamment du niveau de revenus sur tout locataire ou propriétaire d'un logement.
- (34) https://www.elections-nc.fr/histoire/l-histoire-de-la-nouvelle-caledonie
- (35) Ordonnance du 7 mars 1944 (suppression du statut pénal de l'indigénat) ; loi Lamine Gueye du 7 avril 1946 (nationalité française pleine et entière à tous les Français, Kanak compris ; statut du 20 septembre 1947 (égalité politique et accès égal aux institutions).
- (36) Journal Le Constitutionnel, 1889.
- (37) Ultime recours contre les multirécidivistes, la relégation sert, aux frais de l'Etat, à éloigner définitivement du territoire national les condamnés jugés incorrigibles dont le « relèvement » est impossible, et à peupler et exploiter les colonies françaises (Guyane et Nouvelle-Calédonie). Prononcée par les tribunaux, elle n'est pas considérée comme une peine mais comme une mesure préventive. Voir https://www.enap.justice.fr/histoire/la-relegation-ou-lelimination-des-recidivistes
- (38) Sur lesquelles nous n'avons pas trouvé d'éléments concrets.
- (39) Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volte_kanak_de_1917
- (40) Impôt prélevé indépendamment du niveau de revenus sur tout locataire ou propriétaire d'un logement.
- (41) Homme politique républicain. Il déclare la troisième République en septembre 1870 après la défaite de Sedan.
- (42) Docteur en histoire. Son intervention dans le film d'Alexandre Rosada - journaliste, grand reporter, auteur - Le Regard Colonial, à voir : https://www.youtube.com/watch?v=4DJRcSEkftI&t=10s
- (43) Alexandre Rosada, ibid.
- (44) La Fédération française des anciens coloniaux.
- (45) Alexandre Rosada, ibid.
- (46) Pascal Blanchard, historien, in Alexandre Rosada, Ibid.
- (47) https://www.huffingtonpost.fr/culture/article/dans-le-village-de-bamboula-sur-france-2-retour-sur-l-enfer-d-un-zoo-humain_191182.html
- (48) Contrairement à ce qu'avance le site académique d'histoire-géographie de Nouvelle-Calédonie, qui parle du GPRF (Gouvernement provisoire de la République française) qui n'est entré en fonction qu'en juin 1944.
- (49) « En Afrique française comme dans tous les autres territoires où des hommes vivent sous notre drapeau, il n’y aurait aucun progrès qui soit un progrès, si les hommes, sur leur terre natale, n’en profitaient pas moralement et matériellement, s’ils ne pouvaient lever peu à peu jusqu’au niveau où ils seront capables de participer chez eux à la gestion de leurs propres affaires. C’est le devoir de la France de faire en sorte qu’il en soit ainsi »...
- (50) Impôt prélevé, indépendamment du niveau de revenus, sur tout locataire ou propriétaire d'un logement.
- (51) https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Nouvelle-Calédonie
- (52) UICALO (Union des indigènes calédoniens amis de la Liberté dans l’ordre) et AICLF (Association des indigènes calédoniens et loyaltiens français).
- (53) Territoire d'Outre-Mer
- (54) 1.200.000 soldats américains sont présents à partir de 1942 pour mener la « bataille de la mer de Corail », et « occuper et protéger la Nouvelle Calédonie face à l'expansionnisme de l'ennemi japonais » - https://rosada.net/americains-en-caledonie-1942-deuxieme-guerre-mondiale/.
- (55) Roch Pidjot, le seul membre kanak, déçu par les camouflets des gouvernements français, finira par se déclarer en faveur de l’Indépendance.
- (56) Circulaire Opération de peuplement outre-mer, (https://blogs.mediapart.fr/alaincastan/blog/171020/kanaky-caledonie-lire-relire-et-faire-connaitre-la-circulaire-messmer-de-1972
- (57) Michel Naepels, CNRS : https://lejournal.cnrs.fr/articles/nouvelle-caledonie-165-ans-dune-histoire-mouvementee.
- (58) Secrétaire général de l'Union Calédonienne.
- (59) Voir les films : Waan Yaat, sur une terre de la République française, Dorothée Tromparent et Emmanuel Desbouiges, 2022, et Olivier Pighetti, Nouvelle-Calédonie, l’invraisemblable verdict, 2024, qui a eu accès à des archives enregistrées du procès.
- (60) L'embuscade de Waan Yaat : quand la justice coloniale française acquitte des assassins de Kanaks Voir : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/affaires-sensibles/affaires-sensibles-du-lundi-10-mars-2025-2918584
- (61) Haut Commissaire de la République chargé de la Nouvelle-Calédonie, nommé par Laurent Fabius.
- (62) Indépendantiste Kanak, bras droit de Jean-Marie Tjibaou.
- (63) A partir de 23:16 : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/affaires-sensibles/affaires-sensibles-du-lundi-10-mars-2025-2918584
- (64) Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri-René_Garaud
- (65) Témoignage enregistré de Tjibaou lors du procès.
- (66) L’assassinat est considéré comme plus grave que le meurtre car il est commis avec une circonstance aggravante : la préméditation.
- (67) Voir le film d'Eric Beauducel, Eloi Machoro, itinéraire d'un combattant, Gédéon Programmes, 2023, 53 mn.
- (68) Militant indépendantiste calédonien.
- (69) Eric Beauducel, ibidem.
- (70) ibidem.
- (71) ibidem.
- (72) ibidem.
- (73) ibidem.
- (74) Voir : https://www.herodote.net/22_avril_5_mai_1988-evenement-19880422.php
- (75) Régiment d'Infanterie de Marine du Pacifique.
- (76) Groupe d'Intervention de la Gendarmrie Nationale.
- (77) Escadron Parachutiste d'Intervention de la Gendarmerie Nationale.
- (78) Dépendant des services secrets.
- (79) https://www.herodote.net/22_avril_5_mai_1988-evenement-19880422.php
- (80) idem.
- (81) Voir : https://amicale2rima.fr/index.php/coin-popotte/glane-sur-la-toile/950-le-mythe-legorjus + https://amicale2rima.fr/images/stories/Glane_sur_le_net/legorgus.pdf
- (82) https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-politique/20080819.RUE5426/nouvelle-caledonie-l-aveu-de-rocard-sur-l-affaire-d-ouvea.html
- (83) idem.
- (84) Hérodote, ibidem.