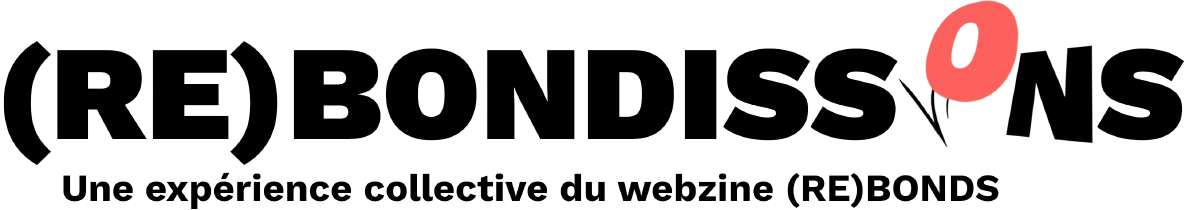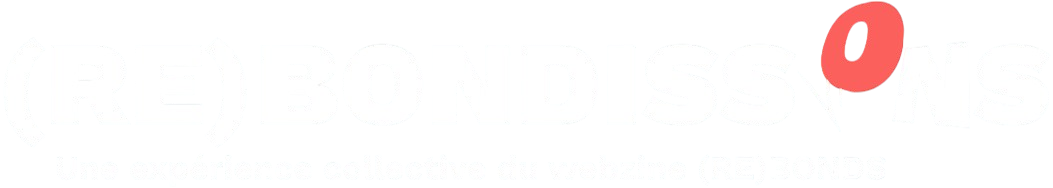« Histoire de la séparation : vie et mort du mouvement ouvrier »
Ce livre, publié par la toute jeune maison d’édition indépendante franco-suisse « Sans soleil » (basée à Marseille), est la traduction d’un recueil d’articles publiés entre 2010 et 2015 par la revue Endnotes. Cette revue est écrite par un groupe de discussions, initialement basé à Brighton au Royaume-Uni, mais désormais d’envergure internationale.
La revue Endnotes se donne pour principale orientation la réflexion sur les « conditions de possibilité d’un dépassement communiste du mode de production capitaliste – et des multiples structures de domination qui modèlent les sociétés caractérisées par ce mode de production – à partir des conditions actuelles ».
Cette revue se réclame de la « communisation », une tendance de la théorie communiste qui, dans le sillage de Mai 68 et de la révolution des œillets au Portugal, reprend les hypothèses issues des courants anti-léninistes du communisme de l’entre deux guerres, pour les adapter et les appliquer à ses propres questionnements.
Pour résumer grossièrement le concept contenu par le néologisme de « communisation », on peut dire qu’il s’agit d’affirmer le communisme non comme le but ultime et final d’une révolution prolétarienne mais bien comme son processus. Les théoriciens de la communisation considèrent qu’on ne fait pas la révolution « pour » mais bien « par » le communisme. Autrement dit, même si le processus est long et non-linéaire, il ne pourrait y avoir de transition vers le communisme, puisque celui-ci serait déjà le processus de transition en lui-même (1).
Les deux idées majeures qui traversent tout le recueil et me semblent les plus importantes et les plus intéressantes, sont probablement l’explication marxiste de la désindustrialisation et du chômage de masse, ainsi que celle d’unité-dans-la-séparation.
A propos du premier de ces thèmes on peut, par exemple, lire page 10 du livre : « les usines produisent toujours plus, mais elles emploient toujours moins de bras, aggravant une demande déjà déficitaire en main-d’œuvre dans l’ensemble de l’économie. » En effet, la lecture marxiste de la désindustrialisation que propose l’ouvrage montre que le gain de productivité induit par les machines produit une baisse de la demande de travail, et ainsi, le temps libéré par les machines se traduit dans la société capitaliste par une « oisiveté forcée » pour le plus grand nombre et un « surcroît de travail » pour les autres. C’est cette « oisiveté forcée » pour le plus grand nombre, et donc le chômage de masse, que vise à expliquer la notion marxiste de « surpopulation relative ».
Enfin, à propos du second thème, il est tout à fait regrettable que les auteurs ne proposent pas une définition claire et unifiée de leur concept d’ « unité-dans-la-séparation », dont il font pourtant un usage extensif tout au long du recueil. D’après ce que j’en ai compris, on peut néanmoins affirmer que l’unité-dans-la-séparation s’inscrit en faux par rapport à la lecture « classique » que proposait le mouvement ouvrier de la séparation originelle entre travailleur.ses et moyens de production, et qu’il tenait pour fondamentale. Nous retiendrons à ce propos ces deux passages qui me semblent particulièrement éclairants :
« Le marché est la communauté matérielle de l’humanité. Il nous unit, mais seulement dans la séparation, seulement à travers et dans la concurrence de tous contre tous. » (p.133)
« (…) nous sommes coupés de la nature et des autres, de manière à ce que nous ne puissions entrer en relation que par la médiation du marché, elle-même supervisée par l’Etat. Nous restons dépendants les uns des autres, mais d’une façon qui nous maintient séparés. » (p.154)
Le recueil se divise en quatre chapitres formés par des articles de la revue Endnotes, que nous allons maintenant brièvement passer en revue.
« Il n'existe pas de modèle »
Le premier chapitre, qui a donné au livre son sous-titre, se donne pour objectif non pas de répondre différemment aux vieilles questions posées par le mouvement ouvrier mais plutôt de remettre en question leurs hypothèses de départ. Autrement dit, sans affirmer que notre présent constituerait une rupture fondamentale avec le passé, il s’agit pour ce texte de distinguer le présent du passé. La thèse de ce premier chapitre pourrait se résumer à montrer que la forme du rapport capital-travail sur laquelle reposait le mouvement ouvrier n’opère plus. Le chapitre explore les usages ainsi que les limites internes et externes de l’idée de travailleur collectif proposée par le mouvement ouvrier. Les syndicats sont notamment abordés comme un exemple d’organisation ouvrière permettant une intégration et une reconnaissance sociale accrue du prolétariat mais interdisant de ce fait même de renverser le cadre auquel ils permettaient de s’intégrer. De plus, la reconnaissance des syndicats comme interlocuteurs pertinents pour la négociation par l’Etat découle tout autant, et peut-être même d’avantage, de leur capacité à cesser la grève que de celle à l’initier ou à l’organiser.
Ce texte affirme que le mouvement ouvrier n’était qu’un horizon du communisme et non pas son horizon invariant et, par conséquent, rejette l’idée selon laquelle le communisme ne pourrait redevenir possible qu’à la condition d’un renouvellement du mouvement ouvrier. De ce point de vue, ce n’est sans doute pas pour rien que ce chapitre s’ouvre sur cette citation de Mario Tronti, marxiste italien des années 1970 : « Il n’existe pas de modèle. L’histoire des expériences passées ne nous sert que pour nous en libérer. »
« Misère et dette »
Le second chapitre, intitulé « Misère et dette » s’intéresse à la théorie de la paupérisation de Marx en lien avec sa théorie des crises du capitalisme, et plus particulièrement à la crise de la reproduction du rapport capital-travail. Ce chapitre insiste sur le discrédit subi, durant les Trente Glorieuses, par cette théorie de la paupérisation et des crises chez Marx, et en quoi la situation actuelle éclaire ces théories sous un jour nouveau. Cet article s’interroge aussi sur la réalité des reprises économiques succédant aux crises, et en particulier leur capacité à générer de l’emploi et non du chômage de masse. La notion de « surpopulation relative », déjà abordée dans le chapitre précédant, est donc à nouveau abordée ici. Cette notion désigne les travailleur.ses expulsé.es d’une branche d’industrie du fait des gains de productivité mais qui ne trouvent pas de travail dans une autre, iels deviennent donc « superflu.es » au regard du travail disponible, excédentaires uniquement par rapport à l’accumulation du capital. Tout le chapitre cherche à démontrer que malgré l’alternance de phases d’expansions et de récessions du capital, la tendance générale est à la hausse de cette population. Le chapitre se conclut sur une réponse aux objections classiques et consensuelles faites à cette analyse et prenant pour exemple la Chine.
La fragmentation de la classe ouvrière
Le troisième chapitre - « Un sujet abject ? » - s’attache à montrer en quoi la surpopulation excédentaire, abordée dans le chapitre précédent, n’est pas « un sujet social ou un groupe sociologique cohérent et singulier » (p.207) et donc qu’elle n’est pas plus à même de constituer un nouveau sujet révolutionnaire capable d’unifier la classe, que ne l’a été l’hégémonie du travailleur industriel qualifié par le passé (l’ouvrier industriel comme sujet révolutionnaire). L’article montre également comment, dans un contexte de désindustrialisation et de croissance faible, la fragmentation de la classe ouvrière diminue drastiquement sa capacité d’unification et la divise en au moins deux segments principaux : un premier segment qui conserve des salaires relativement importants et des protections sociales, se trouve en situation de mener des luttes essentiellement réactives contre les « réformes » et les restructurations capitalistes ; un second segment de la classe, en croissance nette, relégué à l’économie informelle et dont l’accès à l’emploi est de plus en plus discontinu et précaire, le plus souvent privé de protections sociales. Le premier segment a besoin du second pour gagner ses luttes, mais il paraît de plus en plus improbable que les luttes d’une partie de la classe bénéficieront à sa totalité.
Le concept de subsomption
Enfin, le quatrième chapitre - « Histoire de la subsomption » - revient sur les querelles historiographiques entre Marxistes à propos des périodisations en terme de subsomption formelle et de subsomption réelle. Chez Marx, la subsomption désigne la subordination du processus de travail sous le processus de valorisation capitaliste. L’article propose une genèse philosophique du terme de subsomption, de son utilisation chez Marx ainsi que chez plusieurs de ses successeurs au XXe siècle. Par la suite, le concept de subsomption et sa capacité à interpréter l’Histoire sont analysés et critiqués.
Ce dernier chapitre est sans doute le moins intéressant du recueil puisqu’il détaille un concept et sa généalogie pour mieux en récuser l’utilité pour la pensée et l’interprétation. On regrettera également les nombreuses coquilles présentes dans l’édition de cet ouvrage qui laissent deviner une relecture superficielle avant l’impression.
On notera que peu de temps après la parution des articles traduits dans ce recueil, le collectif Endnotes a publié en décembre 2015 un court texte intitulé « Les Thèses de Los Angeles », qui offre un résumé succinct, en huit points, tout à fait pertinent du livre et des problématiques qu’il aborde. Ces Thèses de Los Angeles sont disponibles sur différents sites en ligne, notamment sur celui des éditions Sans Soleil (dans la rubrique actualité, où la préface du livre est également disponible).
Pour conclure, cet ouvrage m’a paru particulièrement stimulant du point de vue de la critique, interne à la théorie communiste, de l’ouvriérisme et de l’industrialisme qu’il propose. Ces textes ne présentent pas cette critique du fétichisme de l’ouvrier et de l’industrie comme un supplément d’âme morale pour la théorie communiste mais comme une nécessité stratégique absolue dans le contexte de désindustrialisation et de croissance faible ou nulle qui est le nôtre. Enfin, j’ai aussi beaucoup apprécié le rôle que la postface de l’ouvrage assigne à la théorie et qui se conclut en ces termes : « Selon nous, la théorie doit être avant tout comprise comme une thérapie face au désespoir qui accompagne les moments creux de la lutte des classes, qui durent parfois des années. (…) Ce désespoir ne se manifeste pas toujours dans les moments de retrait des luttes. Les militants désespèrent souvent face aux luttes alors qu’elles se déploient sous leurs yeux. On observe alors une scission entre ceux, les activistes, qui agissent sans réfléchir, et les théoriciens critiques, qui réfléchissent sans jamais agir. La théorie doit permettre une réflexion dans l’action, une réflexion qui connaît les limites de cette action, mais agit malgré tout. »
Martin B.
Notes
- (1) Pour de plus amples informations à propos du concept de « communisation » on consultera l’ouvrage « De la crise à la communisation », de Gilles Dauvé aux éditions Entremonde.