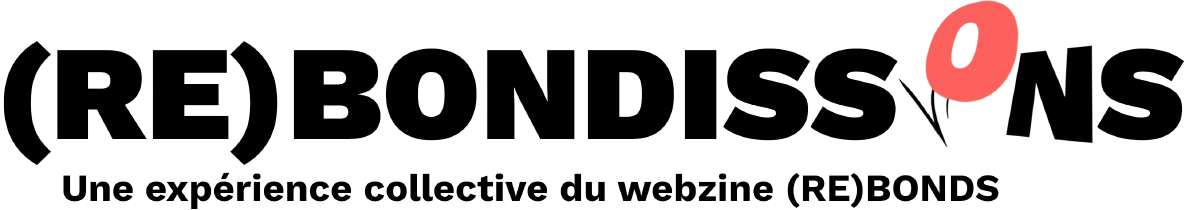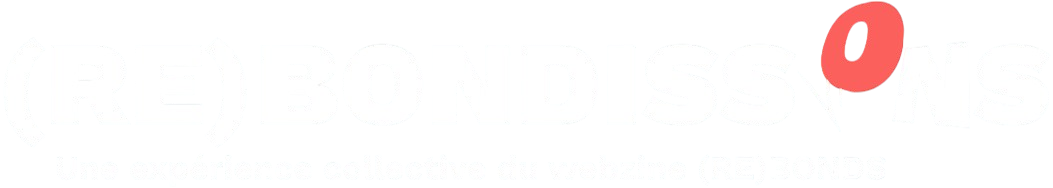Loi Immigration : relever les exigences en français, facteur d’exclusion ?
Selon l’étude d’impact du projet de loi, avec ces nouvelles dispositions, 40 % des personnes qui demanderont une carte de séjour pluriannuelle ne pourront plus y accéder, idem pour la carte de résident·e ou la naturalisation. Des « décisions qui pousseront définitivement une grande partie des personnes migrantes vers la précarité et l’exclusion », dénonce la Cimade (1).
Pourquoi ? Parce que les niveaux demandés « sont excessifs et inaccessibles de par leur difficulté ». Par exemple, le niveau universitaire serait exigé pour atteindre la naturalisation et l’accès à la citoyenneté (alors que la majorité des Français natif·ve·s n’ont pas ce niveau).
De plus, pour la Cimade, « il est reconnu par les chercheurs et chercheuses que la langue n’est pas le seul facteur de l’intégration ». « De nombreuses études montrent que l’apprentissage de la langue officielle du pays dit « d’accueil » n’est pas une condition à une « intégration », laquelle passe aussi et surtout par d’autres voies, notamment emploi, logement, relations sociales... »
Mais quels moyens sont réellement mis en place par l’Etat pour accompagner les personnes dans l’apprentissage de la langue ? « Ces mesures sur l’exigence en français sont aujourd’hui inapplicables car les organismes de formation et les centres d’examen en français sont déjà saturés, affirme la Cimade. Plusieurs mois d’attente sont parfois nécessaires avant de pouvoir intégrer une formation linguistique ou s’inscrire à un examen. D’autre part, les centres de formations et d’examens ne sont pas présents sur l’ensemble des territoires. »
A Bourges, le Centre Ressources Illettrisme et Analphabétisme du Cher (CRIA 18) évalue et oriente les demandeur·se·s. Quel est le parcours pour obtenir aujourd’hui les niveaux de français requis ? Comment sont appréhendées les propositions de la nouvelle loi ? Quel impact sur l’activité du centre ?
Au CRIA, 80 % de personnes d’origine étrangère
Créé dans les années 1995, le CRIA du Cher est porté par l’association d’éducation populaire PEP 18. Il est animé par deux salariées, dont Valérie Tiaïba, la coordinatrice. « A l’origine, notre mission était la lutte contre l’illettrisme, pour des personnes en difficulté avec les connaissances de base, explique-t-elle. Il s’agissait surtout de francophones mais avec l’évolution de la situation internationale, 80 % des personnes accueillies aujourd’hui sont d’origine étrangère. Soit elles sont francophones mais ne maîtrisent que l’oral parce qu’elles n’ont pas ou peu été scolarisées ; soit elles ont été scolarisées dans leur pays, mais pas en français. »
Repérées par des partenaires du CRIA tels que le Conseil départemental, la mairie de Bourges, ses centres sociaux, Pôle emploi ou la Mission locale, elles passent des tests de lecture, d’écriture, de calculs et de maîtrise du numérique. En fonction de leurs besoins, le CRIA les oriente ensuite vers des centres de formation spécialisés, et les reçoit à nouveau quelques mois plus tard pour l’examen final. « Ici, nous ne dispensons pas de formations ou bien uniquement à destination des professionnel·le·s et des bénévoles qui accompagnent ces personnes », précise Valérie Tiaïba.

Une formation linguistique et civique
Aujourd’hui, les personnes primo-arrivantes n’ayant pas un niveau débutant en français (niveau A1) sont dans l’obligation de suivre des heures de formation linguistique prescrites par l’OFII (2) : 200 à 600 heures de cours selon les personnes. A cela, s’ajoute une formation civique qui dure 24 heures, étalée sur quatre jours. L’assiduité est la seule condition à remplir pour honorer ce contrat dit Contrat d’Intégration Républicaine (CIR). Dans la nouvelle loi, une obligation de résultat apparaît.
« A l’oral, le niveau A1 consiste à savoir construire des phrases simples : se présenter ou prendre un rendez-vous, explique Valérie Tiaïba. A l’écrit, il s’agit de remplir un formulaire administratif par exemple. Dans la formation civique, il y a les institutions françaises, les droits et les devoirs, la santé, l’emploi, la parentalité, le logement et le « portrait de la France ». »
Une barrière infranchissable
Désormais, c’est le niveau A2 qui sera exigé pour les débutant·e·s, soit un niveau de langue vivante étrangère collège. La carte de résident·e passe du niveau A2 à un niveau avancé B1 (langue vivante au lycée) et la naturalisation du niveau B1 au B2 (niveau de français requis pour entrer à l’université). Pour y parvenir, il n’est pas prévu d’heures supplémentaires de formation, hormis une augmentation de 100 heures pour l’acquisition du niveau A2.
De plus, « le Sénat a voté l’obligation de présenter un diplôme de français de niveau A1 (niveau débutant) pour les personnes voulant entrer sur le territoire français au titre du regroupement familial », révèle la Cimade. Impossible pour la majorité des demandeur·se·s qui viennent de pays où les infrastructures d’éducation sont faibles, inexistantes ou ne proposent tout simplement pas l’apprentissage du français ! C’est le cas en Afghanistan par exemple.
« Cette proposition avait déjà été faite en 2007 par le ministre de l’immigration Brice Hortefeux, rappelle la Cimade. Elle a été abandonnée et remplacée par la signature obligatoire du Contrat d’Accueil et Intégration (CAI) puis du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) à l’arrivée en France des personnes rejoignant leur famille. » Les écueils de cette mesure avaient été documentés dans un rapport de la commission des finances en octobre 2012 qui soulignait la difficulté de couvrir l’offre pour l’ensemble des pays d’origine, d’atteindre les territoires éloignés des capitales et l’hétérogénéité des tests selon les pays. « A cette époque, le rapport notait que la non réussite à un test de langue ne pouvait prévaloir sur la délivrance d’un visa pour raison familiale. »
Pour la naturalisation, l’ajout en 2020 de la maîtrise du français à l’écrit en plus de l’oral représentait déjà une barrière infranchissable pour 30 % des prétendant·e·s. « Je connais des personnes qui ont toujours travaillé en France, qui n’ont donc pas eu le temps de suivre des formations, mais qui se débrouillent bien et qui sont intégrées, raconte Valérie Tiaïba. Et bien avec ces dispositions, elles n’auront jamais la nationalité française. Pourtant, on en voit beaucoup qui ont des emplois dont les Français ne veulent pas... »
La langue : un droit pas un devoir
Les associations ne nient pas que l’apprentissage de la langue soit un facteur d’inclusion essentiel. « Bien sûr que c’est utile ! reconnaît Valérie Tiaïba. C’est important dans le parcours des personnes, ne serait-ce que pour accéder à des formations qualifiantes. Et puis, c’est valorisant : lorsqu’elles reçoivent leur diplôme, elles ressentent beaucoup d’émotions. Ce n’est pas qu’un acte administratif. »
Mais les dispositifs d’accompagnement mis en place ne sont pas à la hauteur des exigences avancées dans la nouvelle loi. « Dans le Cher, il y a très peu de possibilités pour qui veut atteindre les niveaux B1 ou B2. Il y aura donc un temps de latence entre le vote de la loi et les réponses sur le terrain. »
De son côté, la Cimade continue à revendiquer « le droit à la langue et à la culture française pour toutes et tous » (et non le devoir), et une suppression du lien entre titre de séjour et niveau de langue, à l’écrit comme à l’oral.
Fanny Lancelin
Notes
- (1) L’association la Cimade défend depuis près de 85 ans les personnes déplacées, réfugiées, migrantes. Elle a produit un argumentaire contre la loi Immigration : https://www.lacimade.org/analyse/projet-de-loi-asile-et-immigration-2023/
- (2) Office Français de l’Immigration et de l’Intégration.