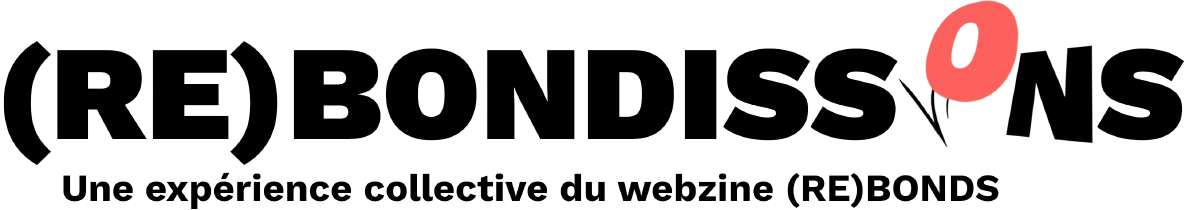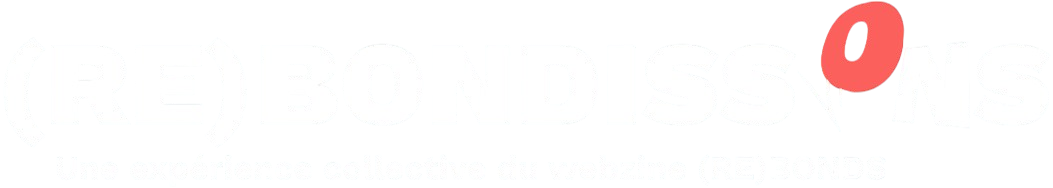Village de l’Eau : après les élections, la lutte continue !
« Préparez-vous à faire fleuve, par équipes, par rivières et par bassins versants. » C’est ainsi que l’invitation a été lancée il y a quelques mois sur les réseaux sociaux. Depuis, une quinzaine de convois se sont organisés et s’apprêtent à converger vers le Poitou : en voiture, à vélo, en tracteur ou à pied, depuis Toulouse, Saint-Etienne, Lyon, Bordeaux, le Centre de la France, Brest ou même depuis la Belgique et l’Allemagne… Tous·tes se retrouveront à Melle, dans les Deux-Sèvres, pour vivre une semaine au rythme du Village de l’Eau.
Un site aux enjeux proches de la lutte
Il sera établi dans la vallée de l'Argentière, sur plus de dix hectares regroupant différentes infrastructures communales, dont la magnifique ferme de la Genellerie. Ce lieu est intimement lié aux enjeux de préservation de l'eau et d'installation paysanne défendus par les organisateur·ice·s.
Voué en 2016 à l’extension d’un lotissement, le projet a été réorienté par la nouvelle équipe municipale pour redonner au lieu sa vocation première : être un espace nourricier et d'expérimentation dans le domaine de l'agriculture paysanne et citoyenne. La municipalité s'engage ici à mettre à disposition de porteur·euse·s de projet des bâtiments à usage agricole et des terrains à cultiver, et poursuit une démarche d'acquisition foncière pour étendre le projet.
Ce programme d'animation foncière et le maintien des prairies naturelles sur les zones sensibles de la vallée vise également à préserver le captage de la Chancelée situé à proximité, qui alimente en eau potable 4.800 des 6.200 habitant·e·s de la commune de Melle.
Ainsi, le Village de l'Eau a pour but de donner à voir qu'il est désirable et possible de mettre en place des pratiques compatibles avec l'enjeu vital et prioritaire de la préservation de l'eau.

La dénonciation du « système bassines »
Plus d’un an après la manifestation à Sainte-Soline et sa féroce répression, les militant·e·s vont se retrouver une nouvelle fois pour dénoncer l’accaparement de l’eau par le système de l’agro-industrie dont les bassines sont un des symptômes.
Les bassines sont des cratères d’une surface allant parfois jusqu’à 18 hectares, recouverts de plastique et remplis d’eau pompée dans les nappes phréatiques. Elles sont avant tout conçues pour des cultures nécessitant une irrigation intensive, au profit d’une petite minorité d’agriculteur·ice·s (2 %) et ce, aux dépens de formes de stockage et de partage de l’eau vertueuses, bénéficiant à l’ensemble des cultivateur·ice·s, de la population et de la biodiversité.
L’été dernier, le financement des méga-bassines à 70 % par de l’argent public a été vivement critiqué jusque par la Cour des comptes. Celle-ci constate que le parti-pris gouvernemental pour ces infrastructures retarde dangereusement le changement nécessaire des pratiques agricoles. Au sein même des institutions en charge de la protection qualitative et quantitative de l’eau, les critiques apparaissent au grand jour et le doute sur la viabilité des bassines s’installe parmi les irrigants.
Le gouvernement a cherché, dans le cadre de la Loi d’Orientation Agricole (LOA), à faire reconnaître un « intérêt général majeur » à ces infrastructures afin de court-circuiter les recours juridiques et de contourner les protections environnementales. Sa réponse au mal-être agricole exprimé cet hiver a été de favoriser – au bénéfice des géants de l’agro-industrie – les dispositifs et filières qui empoisonnent les agriculteur·ice·s, plutôt que de leur assurer un travail et un revenu digne. L’Etat continue ainsi de se soumettre à des intérêts privés plutôt que de défendre réellement les paysan·ne·s et les biens communs.
Les organisateur·ice·s du Village de l’Eau estiment que les subventions publiques devraient être accordées à une véritable transition agricole. C’est pourquoi, iels entendent mettre en œuvre un moratoire populaire sur le terrain. Le Village de l’Eau sera un moyen pour les participant·e·s d’échanger, de se former, de s’organiser et de poser des gestes forts pour lutter ensemble cet été et au-delà.

Une invitation internationale
Parce que l’accaparement de l’eau est un problème mondialisé, des militant·e·s de toute l’Europe et d’ailleurs sont invité·e·s. Le mardi 16 juillet sera ainsi placé notamment sous le thème des résistances transcontinentales, avec des intervenant·e·s venu·e·s de Méditerranée et d’Amérique du Sud. Mercredi 17 juillet, les conférences, tables-rondes et assemblées seront déclinées pour « s’organiser pour le partage de l’eau et des terres à l’échelle d’un bassin-versant » avec des témoignages venus de la région du Jourdain, par exemple. Jeudi 18 juillet, le fil conducteur sera « désarmer les méga-bassines, ouvrir une brèche dans le modèle agro-industriel ». Vendredi 19 et samedi 20 juillet, seront proposées des manif’actions (dont les détails ne sont pas encore annoncés). Et enfin, le dimanche 21 juillet, il s’agira de « bâtir des perspectives communes » avec une déclaration pour une alliance planétaire et une grande assemblée des mouvements de l’eau.
L’ensemble du programme, actualisé régulièrement, est à retrouver sur le site de Bassines Non Merci, ainsi que toutes les informations pratiques pour organiser sa venue : https://www.bassinesnonmerci.fr/bnm79/2023/11/09/20-21-juillet-2024-stop-mega-bassines-prochaine-mobilisation-internationale/
Plus
L’actualité des bassines
Dans les Deux-Sèvres :
- chantiers entamés depuis 2022 à Sainte-Soline, Priaires et Épannes. Ces bassines, que les porteur·se·s de projet, la Coop de l'Eau 79, espéraient opérationnelles pour 2021, ne sont donc toujours que des cratères en chantier.
Dans la Vienne :
- début juin, nouveau permis d'aménager déposé pour la bassine de Saint-Sauvant (d'un volume de 318.000 m³) qui fait partie de la première tranche de financement du projet des 16 bassines de la Sèvre niortaise. Date prévisionnelle de démarrage du chantier : 2 septembre 2024 (avec début des travaux préparatoires le 1er août).
Ce chantier serait le premier d'une série de bassines annoncées dans la Vienne, où une quarantaine de projets sont prévus sur le bassin du Clain, dont 6 ont été annulés par la justice à l'automne dernier. Des chantiers pourraient démarrer avant la fin de l'année 2024 dans cette zone.
En Charente-Maritime :
- projets annoncés sur le bassin de la Boutonne ;
- nouvelle autorisation par la Cour administrative d’appel de Bordeaux d’un projet de 21 bassines. Décision de justice qui annule le jugement rendu en première instance par le tribunal administratif de Poitiers en février 2021 ;
- poursuite de la bataille juridique avec un projet de pourvoi en cassation par les associations anti-bassines.
Hors du Poitou :
- une bassine de plus construite dans le Cher aux Aix-d’Angillon avec un recours en cours de l’Association de Veille Environnementale du Cher (AVEC) ; deux projets à Quincy et Villequiers ;
- des projets de giga-bassines dans le Puy-de-Dôme ;
- des projets annoncés dans le Gard, l’Hérault et même en Italie…
Cette multiplication s'appuie sur un arsenal de mesures législatives et de contournements réglementaires, dont faisait partie le projet de Loi d'Orientation Agricole (LOA). S’il était repris par la nouvelle Assemblée Nationale, il risquerait d'accélérer les projets et procédures juridiques, de criminaliser davantage les militant·e·s écologistes, et de permettre un financement des bassines sans contrepartie de concertation ou de prise en compte d'études scientifiques.