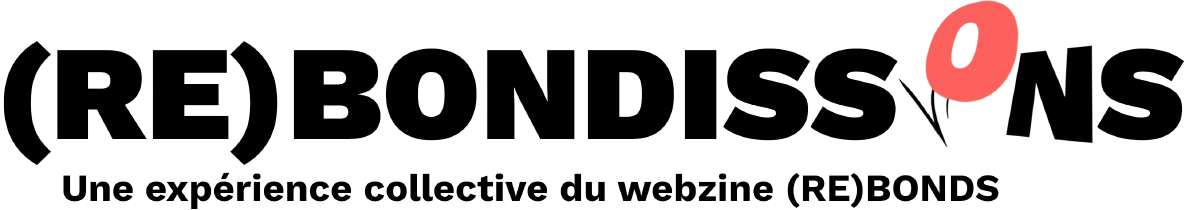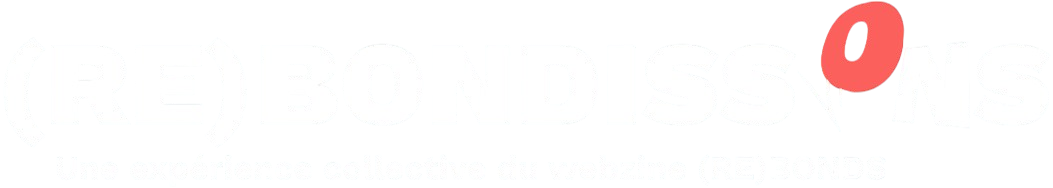Danser l’extra-ordinaire
Comme à l'abbaye de Noirlac en mai dernier, les applaudissements sont forts et généreux, ce vendredi 9 juin à la Maison de la Culture de Bourges. Essouflé·es, les danseur·ses de la pièce « 22 mixtes » saluent en souriant. Les spectateur·ices qui leur font face aussi. Des larmes arrivent au bord des yeux. Depuis leur place, sur scène ou dans le public, iels viennent de vivre une expérience extraordinaire, au sens premier du terme : une expérience qui sort de l’ordinaire, de la norme, des codes.
Des personnes à diversité fonctionnelle viennent de danser ensemble et de se produire en spectacle. Des personnes dites « valides » et d’autres dites « en situation de handicap », moteur et / ou mental. Des personnes qui ont peu ou pas l’occasion de se côtoyer, de prendre le temps de se connaître et de créer ensemble, tant la société dans laquelle nous vivons les sépare.
Cela ne devrait pas être extraordinaire. Mais ça l’est.
Parce que les participant·es à « 22 mixtes » ont su briser les barrières érigées par des systèmes entre elleux. Parce qu’iels ont su se reconnaître pour ce qu’iels étaient au moment présent : des êtres vivants et des danseur·ses.
Comment est née cette formidable histoire ? Qui l’a rendue possible ? Qu’est-ce qu’elle dit de notre rapport au corps et au handicap ? Et ouvre-t-elle d’autres portes ?
Se rencontrer par la danse contemporaine
Il a d’abord fallu croire que c’était possible. L’équipe de la Maison de la Culture de Bourges l’a voulu. Pour cela, elle a fait appel au chorégraphe Mickaël Phelippeau et à sa compagnie Bi-p. Il avait déjà co-animé des ateliers mixtes avec ART21 (1) à Laon dans les Hauts-de-France et imaginé un duo avec Françoise et Alice Davazoglou. Alice est l’une des premières personnes atteintes de Trisomie 21 à être devenue danseuse professionnelle en France. (2)
De son côté, la Maison de la Culture de Bourges collaborait déjà depuis plusieurs années avec APF France Handicap, en proposant aux adhérent·es un accès privilégié : présentations de saison spécifiques et tarif préférentiel pour les spectacles. L’an dernier, iels avaient ainsi assisté à la représentation de « De Françoise à Alice » à la Maison de la Culture.
Mais l’équipe souhaitait aller plus loin en permettant à des danseur·ses amateur·es à diversité fonctionnelle (3) de se rencontrer lors d’un atelier de création de danse contemporaine. Au total, sept week-ends de novembre à juin ont été organisés pour aboutir au spectacle « 22 mixtes ». Une première à Bourges !
Chacun·e participe au résultat final
Le principe reprend celui de « 22 », une pièce créée par Mickaël Phelippeau en 2017 à Poitiers. Chaque danseur·se est invité·e à proposer une traversée de l’espace que les autres interprètent. En revenant sans cesse à leur point de départ, le groupe dessine une fontaine. Le mouvement est permanent, même s’il oscille dans sa vitesse, son rythme, son énergie.

A Bourges, le chorégraphe n’a pas transmis la pièce geste après geste. Il a fait des propositions qui ont ensuite été testées et enrichies par les participant·es. Les ateliers mêlaient ainsi pratique et discussions, dans lesquelles chacun·e avait sa place pour composer le résultat final.
Pascale tend une main qui caresse des blés ; Morgan danse à l’orientale ; Alice chante et signe ; Sarah quitte son fauteuil roulant pour épouser le sol ; Jean tourbillonne ; Marion décrit les mouvements que Valérie esquisse dans l’air ; Christelle salue la foule… Des portraits apparaissent. Des questionnements aussi. Des frissons. Des rires.
Pour une fois, ne pas être dans la thérapie
Pour le SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapé·es), l’aventure a débuté lorsque des usager·es ont demandé à pratiquer la danse. C’est ainsi que depuis l’année dernière, une fois par mois, Carole Constant anime un atelier à l’APF France Handicap auprès de six à huit personnes. « Sans cet atelier, on n’aurait pas pu se projeter, se dire que c’était possible, explique Colombe Duval, accompagnatrice. Notre objectif, c’est que les personnes finissent par aller dans des ateliers de danse ordinaires mais on s’est vite rendu compte que c’était très difficile. Ça va vite, ce n’est pas adapté, les enseignant·es ne sont pas formé·es… C’est plus facile quand ce sont les valides qui viennent à nous. » Un essai avait également eu lieu avec une art-thérapeute. « Mais pour une fois, nous ne voulions pas être dans la thérapie. Juste dans la danse, le loisir, un moment de bien-être. »
Le projet « 22 mixtes » a été proposé aux bénéficiaires du SAMSAH, tous·tes suivi·es à domicile. Pascale Barrère, Nathalie Caroff, Morgan Michel, Christelle Larpent et Marion Megnien ont immédiatement accepté ! Non sans ressentir une pointe d’appréhension. « Mon handicap est invisible, alors j’avais des craintes sur le jugement des valides sur moi », reconnaît Marion. Finalement, elle assure avoir trouvé « des personnes attentives et bienveillantes ».

Comment ont-elles vécu les ateliers, physiquement ? « Au départ, j’étais coincée mais maintenant, ça va mieux. Il y a des mouvements qui se libèrent », répond Pascale. Elle sent qu’elle se dépasse, ce qui provoque parfois des douleurs le lendemain. Même constat pour Marion : « Mais c’est de la bonne fatigue, c’est positif parce que sur le moment, j’en profite vraiment. »
Pour Nathalie toutefois, « les séances étaient trop longues ». « Ce qui est difficile, c’est de trouver un rythme qui corresponde à mon état du moment. »
Durant les ateliers à la Maison de la Culture, les échauffements avaient lieu sur des chaises et des pauses étaient programmées. Chacun·e avait la liberté de décliner les propositions ou de suspendre sa participation le temps de souffler. « Mais parfois, on n’osait pas ou on n’avait pas envie ! » sourit Pascale.
A quelques jours de la représentation, aucune ne semblait stresser. « Je sais qu’on n’attend pas de moi une performance, explique Colombe. C’est collectif, ce n’est pas moi en particulier qu’on regardera. Bon… avant de monter sur scène, je ferais peut-être moins la maline ! »
« On apprend à prendre soin »
Au foyer Claude-Bozonnet de Châteauneuf-sur-Cher, à quelques jours de la représentation à Noirlac, le trac monte progressivement. Sandra Mazaudier, Enola Foucard et leurs accompagnatrices Emmanuelle Berger et Manon Moysan participent aussi à « 22 mixtes ». « Plus ça approche, plus ça fait peur ! » résume Sandra, qui reconnaît toutefois être « très contente » et « fière » de prendre part au projet. Pour Enola, participer à un atelier danse « fait du bien » : « ça vide la tête ».
Comme leurs collègues Colombe et Claire, Emmanuelle et Manon se sont laissées embarquer : « C’est une très chouette expérience. On partage autre chose que la vie du foyer. On voit que Sandra s’entraîne, crée des chorégraphies. Enola est plus à l’aise en groupe parce que pendant l’atelier, elle peut s’exprimer, faire des propositions. »

Chez Sandra et Enola aussi, des douleurs apparaissent ou sont ravivées par l’intensité de l’atelier. Mais elles n’entament pas leur enthousiasme. Elles se savent entourées. Comme l’a écrit l’une des participantes, Emilie Chaillou, dans un texte racontant l’expérience (4) : « Certaines vont et viennent, devancent les besoins, ont des yeux et des oreilles partout, sont enthousiastes pour deux quand le corps fait un peu défaut : elles connaissent des tonnes d’infra-langages. » Les autres membres de « 22 mixtes » tentent aussi de développer « la vision périphérique », « deviner la présence de l’autre », « anticiper son prochain mouvement ». « Et on est frappé alors, écrit encore Emilie. On apprend à prendre soin. »
« Je danse. Point. »
Nadège L’Houtellier a le même sentiment. Habituée des stages de danse organisés chaque année à la Maison de la Culture, elle s’est inscrite à « 22 mixtes » naturellement. « Je venais d’abord pour la danse. Ensuite pour le partage. » L’expérience est néanmoins singulière : « ça oblige à prendre soin. D’habitude, dans un atelier de danse entre personnes non handicapées, on ne le fait pas particulièrement. On ne demande pas : tu as mal quelque part ? Je peux te toucher ? »
Dominique Kleinsmith danse depuis 50 ans. « Mais c’est la première fois avec des personnes en situation de handicap ! Ça pose quand même question, de manière plus générale, sur la place du handicap dans des pratiques comme la danse. » Au départ, elle a refusé de considérer les personnes avec qui elle dansait comme empêchées. « Je danse, point. Ce sont des danseur·ses, je les prends comme tel·les. Quand tu improvises avec quelqu’un, tu dois de toute façon lire dans son corps. Mais en agissant ainsi, j’ai pu choquer certaines personnes. J’ai fait un peu peur à Sandra, je crois... »

Chantal Adams a aussi connu « 22 mixtes » via le programme des stages de la Maison de la Culture. Mais elle ne se considère pas comme danseuse, pas même amateure. « Je me sens raide et parfois, pas à ma place. J’ai peur d’être un boulet pour le groupe ! Dans ma tête, je me vois faire des trucs que je ne peux pas faire ! » Nadège acquiesce : « quelque part, on a tous un handicap... »
Toutes les trois sourient. Elles pensent à cette traversée dans la pièce, initiée par Valérie Coulon. En fauteuil, celle-ci parvient néanmoins à lever et baisser les jambes comme sur une balançoire. Celleux qui marchent tentent vainement de l’imiter. Physiquement impossible, bien sûr ! Mais cela donne lieu à des scènes drôles voire grotesques. Et si les soi-disant « valides » tentaient d’imiter les personnes dites en « situation de handicap » ? Ridicule ? Alors pourquoi exiger l’inverse ? Pourquoi les cultures ne pourraient-elles pas être mixées dans un respect réciproque ?
« C’est la société qui est handicapée »
En France, la question n’est pas suffisamment posée. Il s’agit trop souvent de penser à la place de l’autre, voire d’adapter une fois les décisions (mal) prises ou les réalisations terminées. Le milieu culturel ne fait malheureusement pas exception.
« C’est la société qui est handicapée, pas nous », dit gravement Morgan. « Déjà, sortir de chez soi, c’est tout un truc, explique Pascale. En milieu rural, le problème, c’est le transport. » Pour que « 22 mixtes » puisse exister, c’est la Maison de la Culture qui a dû financer le coût des taxis, les subventionneurs (Direction Régionale des Affaires Culturelles et Agence Régionale de la Santé) ne prenant pas en charge cette partie.
« Le comportement des valides est aussi un problème, souligne Nathalie. Même si des lois existent, si nous avons des cartes de priorité, nous ne sommes pas respecté·es. » Marion acquiesce : « Il y a beaucoup de choses qui font que je ne sors plus. » Claire soupire : « On tourne en boucle : comme vous sortez moins, vous êtes moins visibles, et comme les valides ne vous voient pas, ils font encore moins attention... »

Du côté des aménagements des bâtiments, des efforts restent à faire y compris sur des constructions ou rénovations récentes. L’accueil de la médiathèque de Bourges, qui a rouvert il y a pourtant quelques jours seulement, est un non-sens en termes de mixité : hauteur des bornes ou des tables, couleurs des murs et des sols, largeur de l’ascenseur… La nouvelle Maison de la Culture, qui n’a pourtant qu’un an, n'est pas parfaite non plus, à commencer par les portes d’entrée. « Rien n’est pensé pour l’autonomie des personnes, il faut sans cesse être accompagné·es. Et même dans ce cas, ça reste compliqué. »
Toutefois, Emmanuelle Berger évoque une expérience locale positive : l’édition 2023 du Printemps de Bourges. « Depuis douze ans, c’est la première fois que je n’ai à redire ! » Du parking à l’espace de discrétion en passant par la plateforme pour les concerts et les spectacles signés… Les efforts lui semblent à la hauteur d’un festival qui communique beaucoup sur son inclusivité.
Relever un nouveau défi ensemble
L’Abbaye de Noirlac, elle, date du XIIe siècle. Le public à diversité fonctionnelle lui accorde donc quelques excuses... mais la plupart des espaces investis par l’événement « Les Futurs de l’Ecrit », les 13 et 14 mai dernier, étaient accessibles. Les spectateur·ices ont donc pu venir en nombre pour découvrir la pièce « 22 mixtes ».
Après une demi-heure à un rythme effréné sur scène, la joie se lisait sur tous les visages des participant·es et le public était soufflé. « Incroyable », « fort », « touchant » sont les mots qui revenaient le plus souvent. « Vous recommencez demain ? » interroge une jeune femme, portable à la main, pour partager l’information avec ses réseaux. « Non, mais le 9 juin à la Maison de la Culture de Bourges ! »

Et après ? Comment transformer cette expérience extraordinaire et l’ancrer ? Comment faire vivre cette mixité dans une réalité quotidienne ? Un défi encore plus grand que celui de « 22 mixtes ». Mais le projet a donné des idées et de la force pour le relever.
Texte : Fanny Lancelin
Photos : Danilo Proietti
Notes
- (1) Association Regards Trisomie 21.
- (2) « De Françoise à Alice » : lire la rubrique (Re)découvrir.
- (3) Engagée dans une démarche anti-validiste, l’équipe de (Re)bonds évite d’employer le terme « valide » ou « en situation de handicap », et préfère l’expression « à diversité fonctionnelle » : https://fr.wikipedia.org/wiki/Diversit%C3%A9_fonctionnelle
- (4) Lire en encadré « Plus ».
Plus
22 MIXTES, danser c’est prendre soin
Il n’aura fallu aux danseurs qu’un week-end pour dessiner les contours de leur aire de jeux. Quelques échanges et déjà, le mot valide est banni. Ici, on ne présuppose pas des aptitudes de l’autre ; on risquerait d’être surpris. Etre touché ne va pas de soi, c’est aussi une question à reposer sans cesse.
Ça y est ! Une friche incroyable vient d’apparaître. C’est joyeux, libre et doux aussi. On expérimente, on regarde ce qui germe, et très vite une évidence : ici, le corps n’est ni un standard, ni un laissez-passer. C’est juste une formidable machine à jouer.
A la deuxième rencontre, on est surpris d’avoir retenu presque tous les prénoms, les dernières timidités s’effacent devant ce groupe volontaire. On dévoile ce qui nous amène. Rien n’est superflu ni ridicule : si c’est ressenti, ça a sa place.
On déjeune tous ensemble. Certaines vont et viennent, devancent les besoins, ont des yeux et des oreilles partout, sont enthousiastes pour deux quand le corps fait un peu défaut : elles connaissent des tonnes d’infra-langages.
On apprend à utiliser la vision périphérique, à devenir la présence de l’autre, à anticiper son prochain mouvement et on est frappé alors : on apprend à prendre soin.
C’est dimanche soir et on porte haut son cœur.
Les week-ends suivants, les « ça va » du matin ne sont pas des politesses, ça nous importe vraiment de savoir. On est embarqués.
Des idées se dessinent, des rencontres ont lieu, incroyables, riches, joyeuses. Tout est partagé, on se marre.
Le soir, on est à la fois vidés et remplis, c’est incompréhensible.
La rencontre suivante, le groupe est devenu une entité autonome. Chacun est singulier, beau, et s’agrège en un corps mouvant. Les propositions individuelles prennent tout leur sens dans le collectif.
Tout peut être discuté, remis en cause : ici, il n’y a pas de rapport de force.
D’ailleurs, Mickaël, loin d’en prendre ombrage, s’en amuse. De cette matière foisonnante, il surlignera le meilleur en jaune fluo.
Des week-ends, il en faudrait encore pour danser tout ce qu’il y a à danser, s’étreindre encore, faire des rondes d’anniversaire, se demander comment ça va et repousser le retour à l’anormalité…
Encore un week-end et on ne s’est pas aperçus qu’un spectacle était né ; on était trop occupés à jouer.
Emilie Chaillou, danseuse de « 22 mixtes »