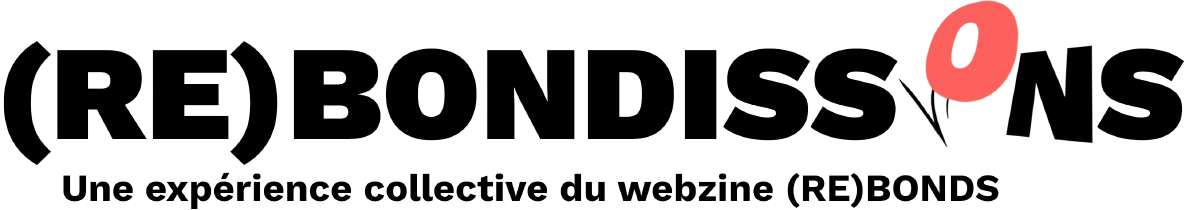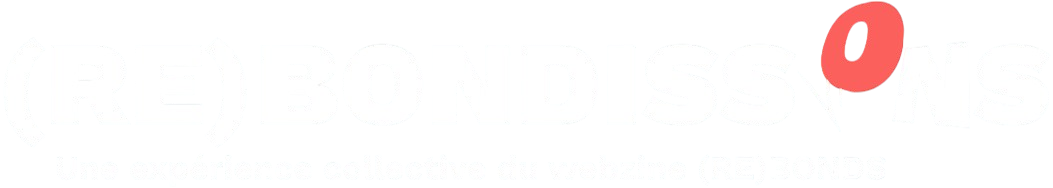Au cœur du Convoi de l’eau
Au loin, dans la nuit noire et tiède, la cloche de l’église sonne 1 heure. Sous les noyers, dans l’alcôve des tentes, les yeux se ferment, les corps se détendent, l’esprit vagabonde… Demain, le Convoi de l’eau que nous préparons depuis des mois prendra vie. Nous sommes le jeudi 17 août 2023 et ce soir, c’est notre premier bivouac. Spartiate – quelques cabines de toilettes sèches, une grande tente berbère et des barnums pour s’abriter, deux points d’eau – mais il n’en faut pas plus à l’équipe d’organisation. L’important est de terminer les préparatifs de la grande aventure qui s’annonce : des centaines de vélos et une dizaine de tracteurs lancés sur les routes, du Poitou à la Capitale.

« Il est bon d’être réuni.e.s et il sera bon de cheminer ensemble »
Comment l’idée de ce Convoi est-elle née ? Au lendemain de la grande manifestation contre les méga-bassines (1) à Sainte-Soline en mars dernier, durant laquelle les 30.000 manifestant.e.s ont été durement violenté.e.s, recevant près de 5.000 grenades en deux heures alors qu’iels tentaient de prendre symboliquement un trou… Il fallait un rendez-vous commun pour se retrouver de nouveau en foule soudée, vibrante et.... roulante. Inspiré.e.s par la marche du Larzac à l’été 1978 pour stopper l’extension d’un camp militaire, et de la « tracto-vélo » de l’hiver 2015 partie de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour arracher la fin du projet d’aéroport, nous avons décidé de partir des terres menacées par les bassines, afin d’exiger un moratoire sur les projets dans les Deux-Sèvres, la Vienne, en Charente, mais aussi dans le Berry, le Puy-de-Dôme, la Haute-Garonne... Notre destination : l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne à Orléans, instance qui finance ces bassines avec de l’argent public. Devant ses administrateur.ice.s, nous exigerons la mise en œuvre de projets de territoires qui assurent le partage de l’eau et une agriculture qui protège les sols, les nappes et les cours d’eau.
Plus que quelques heures avant le grand départ et tant de tâches à accomplir ! Pourtant, déjà, le travail réalisé est énorme. Des repérages aux réunions, en passant par la constitution des équipes pour accueillir et gérer les étapes, le cortège, les cantines, les bivouacs, la communication, l’anti-répression, le soin, la sécurité, la programmation des animations… Mais qu'il est bon d'être réuni.e.s et qu'il sera bon de cheminer ensemble !
Vendredi 18 août, un coq chante bien avant l’aube. A mesure que la chaleur envahit le bivouac, des vélos et des tracteurs arrivent, des caméras et des micros apparaissent – de nombreux médias couvrent l’événement – la musique résonne. Le cortège se forme. Tracteurs et véhicules devant, vélos à l’arrière, divisés en plusieurs pelotons. C’est parti pour 25 kilomètres sous le soleil et une chaleur soutenue. Direction : Jazeneuil.

Se souvenir de Sainte-Soline
Que retenir de cet après-midi ? D’abord, la commémoration des événements de Sainte-Soline et des victimes des violences policières qui marquèrent la manifestation géante du 25 mars dernier : dans le bourg de Lezay, chaque participant.e a été invité.e à poser une pierre au pied d’un panneau indiquant Sainte-Soline, afin de former un cairn, une construction traditionnelle de la région.
On se souviendra aussi de l’immense loutre en vannerie ouvrant la voie, des sourires sur les visages de ceux et celles qui regardaient passer tracteurs et vélos, des gens installés sur le bord des routes comme pour le Tour de France, des haies chargées de mûres, des chants de l’interchorales à l’arrivée...


On se souviendra aussi des difficultés : des gendarmes et des préfectures insistantes pour connaître le parcours, du réseau téléphonique défaillant, de la chaleur qui éprouve les corps, de l’électricité qui n’arrive pas, des problèmes de coordination… Alors, chaque soir, comme au premier soir dans la nuit tiède, il faudra dresser à nouveau des listes, faire d’ultimes vérifications, parer aux imprévus… pour continuer d’avancer !
Les paysan.ne.s en première ligne
Amandine conduit en tête. Les tracteurs marquent l’engagement des paysan.ne.s dans la lutte anti-bassines, notamment celleux de La Confédération paysanne. Secrétaire générale du syndicat agricole dans les Deux-Sèvres et membre du comité national, elle est installée depuis 2015 près de Parthenay, dans une ferme collective, en maraîchage, poules pondeuses et plus récemment en vaches allaitantes.
« Depuis 2018, je suis investie sur le dossier des méga-bassines, explique-t-elle. J’ai participé à l’organisation des manifestations ces dernières années. Alors être ici, ça allait de soi ! » Elle rappelle que l’accès à l’eau est une vraie problématique pour les maraîcher.e.s : « L’eau est indispensable, pas seulement pour des histoires de rendement ou de qualité, mais simplement pour une raison de survie : si tu sèmes une graine mais ne l’arrose pas suffisamment, elle meurt. Nous n’avons pas forcément besoin d’irriguer en grande quantité, mais régulièrement. Avec la sécheresse et les épisodes de grosses chaleurs qui se répètent, nous avons besoin de sécuriser notre accès à l’eau. »
Problème : les irrigant.e.s qui bénéficient déjà de volumes ne veulent pas les partager, ce qui met en difficulté celleux qui sont en activité et empêche de nouvelles arrivées. « L’accès est inéquitable, c’est une véritable injustice, soupire Amandine. Nous avons fait les calculs : avec la méga-bassine de Sainte-Soline, 0,1 % des surfaces irriguées serviront à des légumes (2). Or, 50 % des légumes consommés en France sont importés. Notre objectif, c’est que les cultures maraîchères soient une priorité, comme le dit d’ailleurs la Directive Cadre sur l’eau, la loi européenne. »

Son engagement lui a permis d’en apprendre davantage sur la gestion de l’eau, très complexe en France, mais aussi de travailler avec différentes composantes : « en local avec des associations environnementales, avec Bassines Non Merci bien sûr, depuis deux ans avec les Soulèvements de la Terre... Ça nous porte, ça nous conforte dans nos engagements. Quand tu vois 30.000 personnes qui manifestent dans un champ comme à Sainte-Soline, tu te dis que tu n’es pas seul.e. Ce que tu fais a du sens ! »
Au deuxième jour du Convoi, une femme de 70 ans l’a remerciée. « Quand nous sommes arrivé.e.s dans le village de Vouillé, elle travaillait sur le marché… Ça lui rappelait la lutte sur le Larzac… Elle nous a dit : « Tant qu’il y a de la lutte, il y a de la vie ! » Vraiment, je suis sûre que nous vivons un moment historique ! »
Quatre pelotons d’environ 200 personnes
« C’est qui les plus forts ?
C’est nous les castors !
On pédale fort et on chante encore et encore
Allez castor !
Casse tout castor !
Allez-ez ! »
Dans le cortège, les pelotons chantent souvent pour se donner du courage. Ils parcourent chaque jour entre 50 et 70 kilomètres, sous une chaleur plombante. Le cortège de vélos est divisé en quatre pelotons d’environ 200 personnes, pouvant s’étendre chacun sur un kilomètre. Ils sont affublés de noms d’animaux et de drapeaux : Castors jaunes, Loutres vertes, Rosalies des Alpes en bleu et Hérons rouges. Le but ? Rejoindre rapidement son peloton après les pauses, et retrouver facilement ses bagages le soir dans les camions qui portent les mêmes étendards colorés.

David est référent « Castor ». Il explique : « Dans ces pelotons, nous avons quelques poignées de « serre-files », ces cyclistes motivé.e.s par des sprints réguliers, par la gestion des automobilistes bloqué.e.s qui évoquent tous.tes de bonnes raisons pour traverser notre rivière cycliste. Iels donnent de leur énergie pour remonter le peloton, pousser doucement les personnes les plus fatiguées, motiver les gens et transmettre des informations entre l’avant et l’arrière. Il y a aussi deux « médics », ces personnes formées aux premiers secours, parfois infirmières dans la vie « régulière », pour prendre soin des blessé.e.s et des fatigué.e.s, en lien avec la voiture infirmerie située juste à l’arrière. »

Selon les départements (et donc, les préfectures), la présence de la police de la route est plus ou moins marquée : dans les Deux-Sèvres, des véhicules ouvrent, ferment la voie, sécurisent les carrefours. Dans la Vienne ou le Loiret, c’est service minimum. Pour éviter les blocages, la Confédération paysanne n’a déclaré que les départs et les arrivées. Chaque jour, le parcours fait l’objet de discussions en direct avec les services compétents. Globalement, tout se passe bien, hormis un barrage dans le bourg de Vouillé (le maire ne souhaitant pas que le Convoi s’arrête sur sa commune), que les cyclistes ont dépassé gentiment mais sûrement. Comment une voiture de police aurait-elle pu contenir 800 vélos ?…
En revanche, lors d'un incident à Saint-Cyr (la dégradation d'un terrain de golf), les forces de l'ordre sont venues en nombre et il a fallu négocier pour pouvoir repartir.

Avec les automobilistes en revanche, deux accidents à déplorer : alors qu’il essaie de bloquer un conducteur énervé tentant de couper le Convoi, David se fait… rouler sur son vélo ! Plus tard, une serre-file est renversée par une voiture électrique, que le cortège n’avait pas entendu arriver. Dans les deux cas, ces actes étant volontairement malveillants, des plaintes ont été déposées.

Le soir, les pelotons sont chaque fois émus de l’accueil qui leur est réservé sur les bivouacs. David raconte : « On tape dans les mains au passage, on a le poing levé. L’effort produit démultiplie l’émotion, pour tout le monde, vélo ou non. C’est beau. C’est fragile, et c’est fort à la fois. »
« Une fois les vélos entreposés, organisés, nous trouvons un bivouac totalement opérationnel. Des cuisines aux WC en passant par les douches, le camping en non-mixité choisie ou la tente de communication pour l’équipe médias. Quel travail incroyable de la part de la logistique et des groupes locaux ! Et ça redonne toute l’énergie nécessaire pour, le lendemain, enfourcher à nouveau nos bicyclettes… »
Dénoncer et proposer
Les étapes du Convoi ont été choisies de Lezay à Orléans, selon les projets que nous voulions dénoncer : des méga-bassines en Charente et dans les Deux-Sèvres ; un méthaniseur à Lezay ; une ferme-usine à Coussay-les-Bois ; une plateforme logistique à Mer ; une centrale nucléaire à Saint-Laurent-des-Eaux… Agricoles ou industriels, tous ont un lien avec l’artificialisation des terres agricoles et l’accaparement de l’eau, qu’ils confisquent ou polluent.
Mais le Convoi voulait aussi donner de l’espoir, en montrant des alternatives, comme à Dolus-le-Sec, avec la Coopérative paysanne de Belêtre, ferme collective qui expérimente l’agriculture biologique et paysanne. Enfin, il a soutenu les militant.e.s écologistes qui subissent la répression, en manifestant par exemple devant le tribunal de Tours où comparaissaient des membres de Dernière Rénovation.


Chaque soir, les participant.e.s étaient accueilli.e.s par les groupes des luttes locales. Iels ont ainsi assuré une partie de la communication, de la logistique, et la programmation des animations (tables-rondes, concerts, interventions théâtrales…).
Une équipe logistique appuyée par des groupes locaux
Marco fait partie de l’équipe logistique du Convoi : « Le Convoi n'aurait pu exister sans les équipes bénévoles locales. » Au total, ce sont une quinzaine de personnes qui constituent le « noyau dur » de la logistique, renforcées chaque jour par 30 à 60 volontaires selon les bivouacs. Leurs missions ? « Monter un barnum, charger un véhicule, organiser une circulation, délimiter un périmètre, alimenter un réseau, réparer une machine défectueuse, trouver du matériel manquant, se fournir en énergie, sécuriser un approvisionnement, prévenir des risques, veiller au grain... de sable ». Car « il y a ce qui vient, ce qui arrive, ce qui cloche, ce qui achoppe à toute prévision. Il y a cette nécessité à improviser, à se réorganiser, à anticiper l'imprévu quand même ! »



Parmi ce que Marco a apprécié, la verticalité des relations : « Ici, aucun leader. Les décisions sont collégiales et les avis partagés. Les groupes qui se créent et se dénouent au gré de l'avancée du Convoi de l'eau ont peu d'appétence pour l'esprit pyramidal et autoritaire. La hiérarchie ici est une connivence, un goût pour les affinités électives, pour la reconnaissance du partage effectif des tâches, de toutes les tâches, un attachement à la liberté d'agir et d'être ensemble. »
Intercantine : « nourrir les luttes »
Une autre équipe force le respect de tous.tes les participant.e.s : l’Intercantine. Chaque jour, elle démonte puis remonte toute l’infrastructure nécessaire à la préparation des repas.
L’équipe est bien rodée. Pourtant, les cantines qui la composent viennent de lieux et de cultures variés. Mais elles sont mues par le même désir de « nourrir les luttes, de les renforcer, de les faire durer ». « On n’est pas des prestataires de service, précise Hakim, membre de l’Intercantine. On ne vient pas seulement préparer des repas. On pose des actes forts. »
Des modes d’approvisionnement au ravitaillement au coeur des mobilisations, en passant par des choix de menus les plus inclusifs possibles, l’Intercantine s’oppose à sa manière au système de production alimentaire dominant, et entend contribuer pleinement, politiquement, au rapport de forces engagé contre l’accaparement de l’eau et l’artificialisation des terres agricoles.
Son acte fondateur a été posé en septembre 2021, à Niort, lors d’une manifestation contre la méga-bassine de Mauzé-sur-le-Mignon. Elle se compose aujourd’hui du Plat de Résistance (79), Mange ta langue (86), le RAARE (49), le R2R (35), les Schmruts et les Lombrics utopiques (44), le CAC 23 (23) et la Louche finale (37). Des liens sont aussi tissés avec l’Internationale Boulangère Mobilisée (IBM).

Sur le Convoi de l’eau, l’équipe était régulièrement renforcée par des volontaires, habitant.e.s des territoires traversés. Comme Françoise, Marie-Ange, Joël, Isabelle et Jacqueline, croisé.e.s à Lestiou alors qu’iels découpaient des tomates pour un taboulé et des burritos. Françoise et Jacqueline font partie du collectif Action Climat 41 ; Marie-Ange du réseau Sortir Du Nucléaire et de l’association « A bas le béton ! » contre les plateformes logistiques à Mer ; Joël est venu du Cher après avoir participé à la mobilisation à Sainte-Soline.
Pourquoi ont-iels rejoint la cantine ? « Parce qu’on aime cuisiner et parce que c’est important de faire des choses ensemble ! » A la découpe, les conversations vont souvent bon train : on prend des nouvelles des luttes, on badine aussi, on échange ses coordonnées pour de futures rencontres…
Selon les étapes, l’Intercantine a assuré 700 à 1.000 petits-déjeuners, pique-nique/sandwiches et dîners. Avec un menu à prix libre et principalement végétalien.
Un campement surprise à Orléans
Jeudi 24 août. Les participant.e.s ne le savent pas encore, mais c’est la dernière fois qu’iels sont réveillé.e.s de bon matin par Paloma. Dès 5 h 30 ou 6 h selon les départs, munie de sa guitare, elle s’emploie à motiver cyclistes et conducteur.ice.s à se lever. Avec plus ou moins de succès, tant son style est… particulier ! Tantôt douce, tantôt véhémente, elle plaît autant qu’elle agace. A tel point que certain.e.s sont allé.e.s se plaindre à l’organisation ! Mais une manifestation de soutien fomentée par ses fans devant sa tente aura eu raison de la contestation, et Paloma remplira sa mission jusqu’au bout !

Si elle chante pour la dernière fois, ce n’est donc pas parce qu’elle a cédé aux pressions mais parce que vendredi matin, le Convoi ne sera pas à Bou comme prévu mais… devant l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne à Orléans !

Pourquoi avons-nous dévié notre parcours ? Parce que nous espérons être reçu.e.s par les représentant.e.s du Comité de bassin et notamment par son président, Thierry Burlot. Parce que nous tenons aussi à être bien à l’heure à notre rendez-vous avec la nouvelle préfète de bassin, Sophie Brocas, fixé au lendemain, vendredi, 15 heures !


Arrivé.e.s devant l’Agence de l’eau, un campement provisoire s’installe en plein boulevard. Les paysan.ne.s apportent de la paille pour que les tentes s’installent confortablement, la pluie orageuse ayant mouillé le bitume, des douches et toilettes apparaissent, les tables et bancs aussi… Tout le monde a le sourire aux lèvres ! Les cantines, qui ont pu bénéficier du camp de base de Bou, arrivent bientôt avec de fabuleux repas. Les forces de l’ordre sont positionnées de chaque côté du boulevard mais n’empêchent pas les allers et venues. La soirée se prolonge sous la nuit étoilée. Des musicien.ne.s se relaient sur une petite scène improvisée devant les grilles de l’Agence, où l’on danse et chante à tue-tête pour expulser fatigue et tension.
Le lendemain matin, à 11 heures, une délégation composée de membres de Bassines Non Merci et de la Confédération paysanne est reçue par Thierry Burlot, le président du Comité de bassin. Elle insistera pour qu’il vienne parler à la foule. Il n’osera pas.
L’échec des négociations
Peu après 15 heures, la délégation entre à nouveau dans l’Agence de l’eau pour rencontrer la préfète Sophie Brocas. Nos revendications, martelées durant tout le Convoi de l’eau, n’ont pas varié : un moratoire sur l’ensemble des chantiers en cours, des projets et des financements de méga-bassines.
Mais un événement vient enflammer les échanges : par téléphone, nous apprenons que des grilles ont été posées autour du terrain de la future méga-bassine de Priaires, dans les Deux-Sèvres, annonçant le début éminent des travaux. La préfète semble mise devant le fait accompli. Les téléphones chauffent en direction des ministères. C’est la panique ! Dehors, stupéfaction et colère s’expriment surtout à grands coups de cris et de percussions improvisées sur des casseroles, des pancartes…

Pour autant, rien n’avance, la préfète ne cessant de répéter que le financement des six premières méga-bassines ne peut être annulé, mais que le dialogue sera rouvert sur les dix suivantes. Inacceptable pour la délégation. Après cinq heures de négociations, elle annonce qu’elle restera dans l’Agence de l’eau. Sophie Brocas quitte les lieux pour animer une conférence de presse dans sa préfecture. Elle se dit « trahie » !
Le siège s’organise : on réunit duvets, matelas, nourriture, eau pour celleux qui s’apprêtent à dormir dans des bureaux presque vides. La fatigue et la déception sont palpables. Cette fois, il faut vraiment dormir. Car demain, puisque nous n’avons pas été entendu.e.s ici, nous irons porter nos revendications aux ministères. Paris, nous voilà !

Etape finale à Paris
Environ 80 cyclistes avaient courageusement décidé de relier Orléans à Paris mais l’organisation matérielle du Convoi s’arrêtait bien au Loiret. C’est donc en voiture, en bus ou en train que les participant.e.s sont « monté.e.s à la Capitale ». Auparavant, au petit matin, iels ont accueilli leurs camarades de la délégation à la sortie de l’Agence de l’eau et entamé un atelier « démontage de grilles » pour accompagner leur nouveau slogan : « Grille par grille, bâche par bâche, on démontera toutes les bassines ! »



A Paris, ce sont environ 700 personnes qui se retrouvent sur le Champ-de-Mars, face à la Tour Eiffel. L’image est belle. Des représentant.e.s de Bassines Non Merci, la Confédération paysanne et les Soulèvements de la Terre prennent la parole pour raconter l’épopée qu’iels viennent de vivre mais aussi pour rappeler la détermination de leurs organisations à stopper tous les chantiers et projets de méga-bassines. Les représentant.e.s des luttes locales d’Île-de-France et de collectifs internationaux sont également présent.e.s pour marquer les convergences.

A pied et en vélos, les manifestant.e.s prennent les rues de Paris. Le dispositif policier est de taille, mais hormis une tentative de la Brav-M de diviser le cortège, tout se déroule joyeusement, y compris les passages devant l’Assemblée nationale et devant le ministère de la Transition écologique.


A l’origine, cette dernière étape devait se terminer à La Baudrière, squat auto-organisé et lieu de réflexion anarcho-féministe pour un groupe de personnes TPG (trans-pédé-gouine). Malheureusement, il a été expulsé trois jours avant l’arrivée du Convoi, et reccueilli par la Parole Errante à Montreuil, autre lieu auto-géré anarchiste. Mais les manifestant.e.s n’ont pas manqué de passer devant La Baudrière, afin de rappeler qu’en ville comme ailleurs, l’accaparement des terres et du foncier par le Capital se fait au détriment des plus précaires.

Quelles suites ?
A peine le temps de respirer que déjà, la lutte doit s’intensifier : à Priaires, dès le lendemain de l’arrivée du Convoi, les engins creusent la nouvelle méga-bassine, obligeant les Bassines Non Merci des Deux-Sèvres à se remobiliser très vite, notamment en invitant les médias à constater les travaux ; le 8 septembre, les militant.e.s organisent une grande journée de soutien aux neuf prévenus convoqués devant le tribunal (lire la rubrique (Ré)acteur.ice.s) ; le lendemain, iels vont démonter les grilles du chantier de Priaires et constater les dégâts causés par la bassine SEV 17 sur le Mignon, totalement à sec…

Une bonne nouvelle est cependant arrivée pendant le Convoi : le projet de retenue collinaire pour fabriquer de la neige artificielle à La Clusaz a été suspendu. Preuve que les victoires sont possibles, même si l’étendue de la tâche semble immense. Partout, des signes montrent que le système se fissure. La marche arrière est encore possible. Obtenir le moratoire aussi. En tracteur, en vélo, à pied… toutes les mobilisations de l’automne seront décisives.
Textes : Fanny Lancelin pour (Re)bonds et extraits du Journal de bord du Convoi
Photos : Bassines Non Merci et les Soulèvements de la Terre
Notes
- (1) Une bassine est une retenue d’eau artificielle pour l’irrigation agricole, creusée en plaine, plastifiée avec de la géomembrane et remplit avec de l’eau pompée dans les nappes phréatiques. Elle s’étend en moyenne sur 10 hectares (350 piscines olympiques). Bénéficiant à une poignée d’exploitant.e.s, elles servent à arroser des grandes cultures, principalement du maïs, plante inadaptée au changement climatique puisqu’ayant besoin de grandes quantités d’eau au moment où les niveaux d’étiage sont les plus bas.
- (2) La majorité sert à du maïs pour l’export ou pour alimenter des bêtes à viande.
Plus
Des boucles locales
- C’est Bassines Non Merci - Aume Couture qui a inauguré le Convoi de l’eau en partant dès 9 heures du matin, le vendredi 18 août, pour rejoindre le départ général à Lezay.
En Charente, 14 bassines ont déjà vu le jour ces vingt dernières années, le pompage hivernal représentant aujourd’hui 3 millions de m³ d’eau.
BNM Aume Couture lutte contre un projet de neuf nouvelles bassines.
- Dimanche 21 août, une boucle locale a été organisée par Bassines Non Merci Berry au départ d’Issoudun (36) pour visiter les bassines de Lazenay et de Baugy.
Un nouveau projet est annoncé à Saint-Aoustrille dans l’Indre et aux Aix-d’Angillon dans le Cher, contre lequel un collectif d’habitant.e.s vient de se créer.
Pour connaître toutes les bassines existantes ou en projet, et contacter les collectifs locaux, rendez-vous sur le site www.bassinesnonmerci.fr