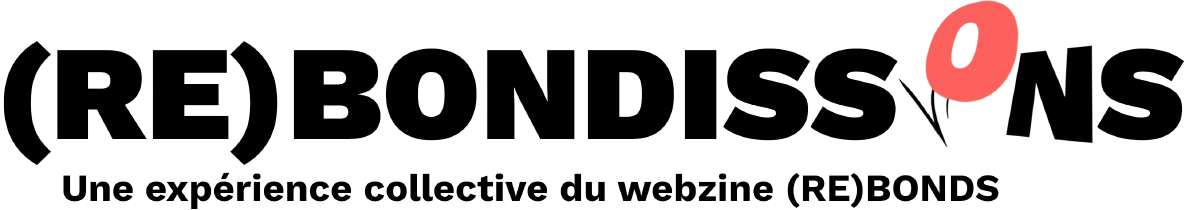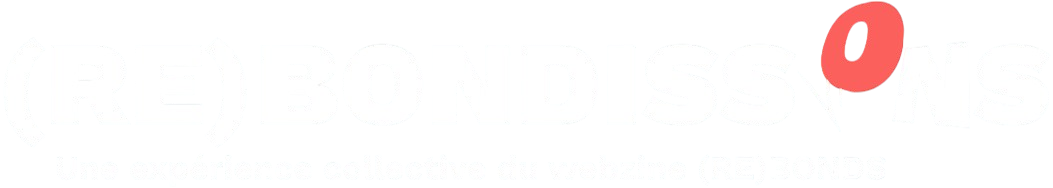« Premières secousses », les Soulèvements de la terre
« Au fil des saisons, nous avons formé des cortèges bigarrés, muni·es de bêches, de mégaphones et de meuleuses, vêtu·es de bleus de travail et de combinaisons blanches, escorté·es par des oiseaux géants… Nous avons traversé les bocages et les plaines, arpenté les vallées industrielles et le bitume des usines – et même frôlé les cimes alpines. Nous nous soulevons pour défendre les terres et leurs usages communs. Contre les méga-bassines, les carrières de sable, les coulées de béton et les spéculateurs fonciers, nous voulons propager les gestes de blocage, d’occupation et de désarmement, pour démanteler les filières toxiques. Nous nous soulevons parce que nous n’attendons rien de ceux qui gouvernent le désastre. Nous nous soulevons parce que nous croyons en notre capacité d’agir.
Depuis des siècles, du nord au sud, des mouvements populaires se battent pour défendre une idée simple : la terre et l’eau appartiennent à tou·tes, ou peut-être à personne. Les Soulèvements de la Terre n’inventent rien ou si peu. Ils renouent avec une conviction dont jamais nous n’aurions dû nous départir. »
C’est ainsi que les auteur·ice·s du livre présentent « Premières secousses », paru aux éditions La Fabrique le 19 avril dernier. Créé en janvier 2021 en pleines vagues successives de confinement, le mouvement agrège alors des membres d’associations et de collectifs qui ont tous·tes à résister sur leurs territoires contre des projets d’accaparement des terres agricoles et de biens communs tels que l’eau. Rapidement, l’idée d’actions concrètes un peu partout en France émerge et une première saison est lancée avec la défense de jardins populaires contre un projet d’artificialisation à Besançon, l’opposition à une carrière de sable à Saint-Colomban et à la destruction de terres maraîchères à Rennes, ou encore le blocage d’une centrale à béton dans le port de Gennevilliers…
Mais l’idée de cet ouvrage n’est pas seulement de revenir sur les actions passées. Il s’agit aussi de s’interroger sur les formes de gouvernance que peut prendre un tel mouvement : à mesure qu’il s’élargit, et dans un contexte de répression féroce, comment mettre en place un fonctionnement efficace et dans un cercle de confiance, sans verser dans trop de verticalité ? Comment les multiples collectifs qui constituent le mouvement peuvent-ils trouver leur place et faire entendre leurs voix ?
De même, les types d’actions des Soulèvements de la terre sont protéiformes. Pour autant, c’est le « désarmement » qui a le plus braqué les projecteurs médiatiques sur le mouvement. Comment a-t-il été pensé, organisé, vécu, revendiqué ? Avec quels doutes, quelles réussites, quelles erreurs ? Les auteur·ice·s du livre le racontent sans détours, en s’appuyant sur leurs expériences concrètes.
Aujourd’hui, plus de 200 comités locaux des Soulèvements de la terre existent en France, avec plus ou moins d’activité. S’ils se sont créés surtout en réaction à l’annonce de la dissolution du mouvement par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin – dissolution annulée par le Conseil d’Etat – ils sont la preuve que partout en France, des habitant·e·s se sentent concerné·e·s par les questions sociales et écologiques inhérentes aux projets destructeurs comme les méga-bassines dans le Poitou, l’A69 entre Castres et Toulouse, ou le Grand Paris.
« Nous ignorons ce dont nous sommes capables avant de l'avoir fait », écrivent les auteur·ice·s. Encourageant ainsi tous·tes celleux qui ont envie d’agir à imaginer des formes d’actions concrètes, immédiates, que des milliers de personnes pourront s’approprier. Pour que s’étende le mouvement et retentissent encore d’autres secousses.
Plus d’informations et les dates de présentation publique du livre sont sur https://lafabrique.fr/premieres-secousses/