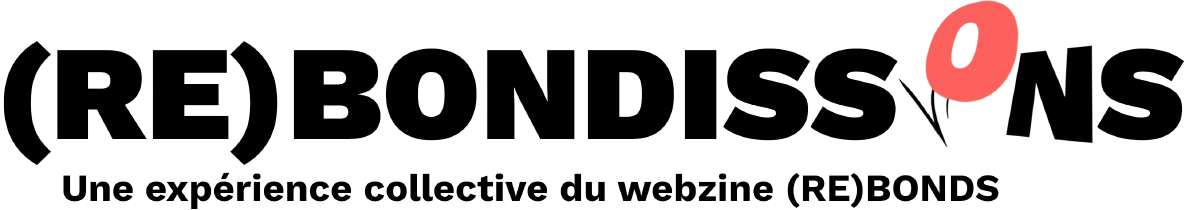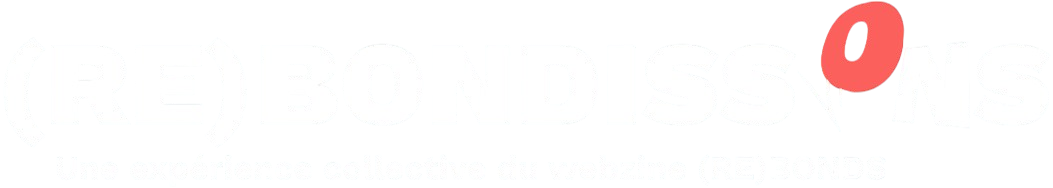Le Convoi de l’eau, Akira Yoshimura
C’est un nom très peu connu en France et pourtant, Yoshimura Akira est l’un des plus grands auteurs contemporains du Japon. Né en 1927 à Tôkyô et décédé en 2006 à Mitaka, il a écrit des nouvelles, des documentaires, des romans de guerre et des romans historiques. Il fait partie de « la deuxième vague » : une génération d’écrivains qui ont écrit sur la Seconde Guerre mondiale sans l’avoir vécue en tant que soldat, la première vague l’ayant décrite de l’intérieur. Leur particularité : récolter minutieusement informations et témoignages pour comprendre eux-mêmes les événements avant de se saisir de leur plume. « Yoshimura fouillait jusqu’au bout, assimilait les faits et portait son œuvre à la perfection », dit ainsi de lui l’écrivain, critique littéraire et historien Hosaka Masayasu (1).
Akira Yoshimura est également connu pour son style littéraire singulier : un rythme soutenu où s’enchaînent des phrases claires et concises, des descriptions très nettes, une narration très réaliste.
Enfin, l’œuvre de Yoshimura est marquée par le thème de la mort, qu’elle soit « apprivoisée » (c’est-à-dire qui n'effraie pas, fait partie du quotidien) ou « ensauvagée » (qui a disparu de la vie quotidienne et qu'on soustrait aux regards). (2)
Ecrit en 1967, Le Convoi de l'eau raconte l'histoire d'un homme, le narrateur, qui fait partie d'un groupe d'ouvriers chargé de préparer la construction d'un barrage près d'un mystérieux hameau : celui-ci a été découvert peu avant la fin de la guerre, lorsqu'un bombardier américain a échoué à proximité et qu'une unité de l'armée japonaise a été envoyée en reconnaissance. Les habitant.e.s semblent y avoir vécu en autarcie pendant plusieurs siècles, leur hameau ne figurant sur aucune carte, perdu dans une vallée au fin fond de la montagne, environné de forêts et bordé par un torrent. Le hameau possède également un cimetière d'une taille démesurée, qui témoigne de son ancienneté. Les ouvriers installent leur campement près du hameau pour plusieurs mois. Leur chef est chargé de négocier l'évacuation du village, car une fois le barrage construit, il se trouvera enseveli sous les eaux. Le narrateur est un ancien prisonnier qui s’engage dans ce chantier en guise de fin de peine. Grâce à l’eau, véritable miroir, s’instaure entre lui et le village un dialogue inattendu…
Alors qu’on qualifie souvent l’eau de source de vie, elle est aussi dans bien des œuvres poétiques et littéraires symbole de mort. « Le cours d'eau de la vallée du Convoi de l'eau, peu profond, rapide, qui tout le long du récit, par son bruit, faisait écho à la mémoire du narrateur, est destiné à mourir, enseveli sous le lac de retenue, il va être réduit au silence, il va mourir », écrit ainsi Anaïs Farrugia dans un mémoire consacré à l’auteur et son œuvre (2).
Pour autant, Le Convoi de l’eau n’est pas un ouvrage sinistre. La présence des éléments – l’eau, le feu, le vent, le froid – apporte au récit une lumière singulière. Si le style est direct et les images parfois crues, elles sont aussi empreintes de beaucoup de poésie.
Le Convoi de l’eau raconte aussi la rencontre entre deux mondes a priori hermétiques : celui des ouvriers, synonyme de progrès, de technologie, d'industrialisation, de modernité donc et celui du hameau, ancien, avec ses traditions, ses ancêtres… Pourtant, c’est bien celui des ouvriers qui provoquera la destruction de la montagne, la mort. Déclenchera-t-il la révolte ou la réaction des villageois.e.s sera-t-elle bien plus inattendue encore ?...
Le Convoi de l’eau a été traduit en français par Yutaka Makino en 2009 pour Actes Sud et A vue d’œil.
Notes
- (1) Hosaka Masayasu, « Lire Yoshimura Akira : la vérité réside dans les détails », in Yoshimura Akira, « La guerre de Shôwa : la nuit avant la guerre ». http://www.shinchosha.co.jp/book/645021/
- (2) Anaïs Farrugia, « Le crâne suspendu dans l'eau » : mise en relation entre la disparition du corps et l'élément liquide dans l’œuvre de Yoshimura Akira, notamment dans le roman Le Convoi de l'eau (1967), Université Lyon III, sous la direction de Claire Dodane, 2017. https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/out/memoires/langues/2017_farrugia_a.pdf