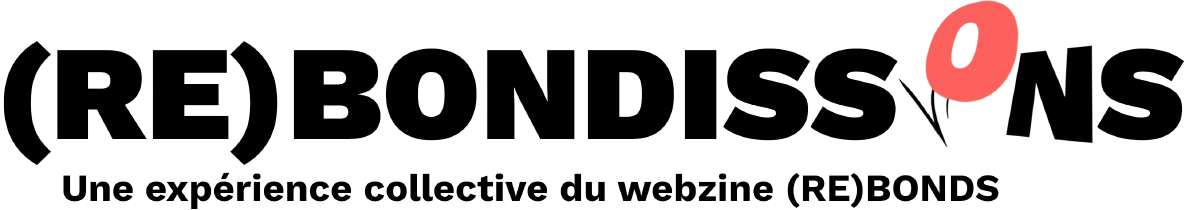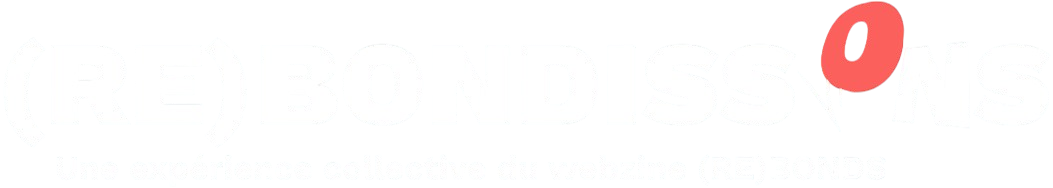« Il n’y a pas d’accord de Bougival : ce projet d’accord vise à verrouiller l’avenir » par Mathias Chauchat
(Re)bonds revient sur ce texte controversé en publiant un texte de Mathias Chauchat (1), professeur de droit public à l’Université de la Nouvelle-Calédonie, pour qui cette opération politique éloigne encore un peu plus le pays d’un processus de décolonisation juste et partagé.
Le 12 juillet dernier, un « projet d’accord sur la Nouvelle-Calédonie » a été signé à Bougival. Le texte a été présenté comme un « accord » sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Pourtant, l’Union Calédonienne et le FLNKS ont immédiatement récusé ce terme. Sur quoi repose ce malentendu entretenu par l’État ? Sur une stratégie délibérée de mise en scène. Le document signé à Bougival n’est qu’un projet de texte, soumis pour consultation aux instances du FLNKS, qui n’ont encore rien validé. En le présentant comme un accord conclu, l’État impose une lecture biaisée du processus. Il s’agit d’un tour de passe-passe politique : faire croire à une avancée « historique » et consensuelle alors qu’ils n’y a ni accord de fond ni base légitime de négociation. Le congrès du FLNKS du 9 août sera déterminant, mais en l’état, la manipulation sémantique alimente la défiance.
Le gouvernement affirme malgré tout qu’un consensus existerait. Que cela signifie-t-il pour les forces indépendantistes ?
On tente une nouvelle fois d’avancer sans les forces indépendantistes. Le ministre Manuel Valls a clairement indiqué vouloir poursuivre le calendrier institutionnel, reporter une nouvelle fois les élections au congrès, et rédiger les textes à venir sans attendre l’accord du FLNKS. C’est une posture unilatérale qui génère un fort sentiment de marginalisation. On assiste à une relégation du FLNKS au rang de spectateur. L’appel récurrent à la « responsabilisation » masque mal une forme de paternalisme politique : faire sans vous, mais prétendre que c’est pour vous. Cela nourrit l’impression d’une rupture du dialogue.
Le contenu du projet d’accord semble entériner une dissymétrie entre Kanak et « peuple calédonien ». Qu’est-ce que cela implique ?
Le projet revient sur l’existence politique du peuple kanak, pourtant reconnu depuis 1983. Il ne reconnaît ni le nom de Kanaky, ni le drapeau, ni un droit propre à l’autodétermination. Il substitue à la reconnaissance d’un peuple autochtone une simple « identité kanak » intégrée à un « peuple calédonien » nouvellement constitué, appelé à devenir le seul sujet du droit à l’autodétermination. Ce glissement sémantique équivaut à une négation du droit international des Kanak à la décolonisation : on passe d’un peuple colonisé à une composante culturelle autochtone intégrée dans un ensemble non autochtone artificiellement fabriqué. Ce n’est pas un compromis, c’est une absorption.
La trajectoire proposée est-elle réellement une voie de décolonisation ?
Le projet s’inscrit dans une logique d’intégration à la France, à travers un statut d’autonomie interne. Il s’appuie sur la résolution 2625 des Nations Unies, qui autorise des formes de décolonisation alternatives à l’assimilation, l’association ou l’indépendance. L’autonomie est une forme d’intégration qui ne mène ni à l’indépendance ni à l’association. Elle sert surtout à enfermer, à travers les habits d’un faux fédéralisme, la Nouvelle-Calédonie dans un statut figé, sans horizon de souveraineté réelle. L’objectif à peine masqué est de faire retirer le territoire de la liste des pays à décoloniser de l’ONU.
Pourtant, le projet évoque un « Etat de Nouvelle-Calédonie ».
Cette référence peut donner l’impression d’un saut qualitatif. Mais de quoi parle-t-on réellement en droit ?
Selon la Convention de Montevideo, un État doit disposer de frontières, d’un peuple, d’un gouvernement autonome et de la capacité à signer des traités. Et s’il existe un régime d’association, de la capacité unilatérale d’en sortir. Or ici, rien de tout cela n’est réuni. Il ne s’agit que d’une collectivité territoriale française sans souveraineté. La « nationalité calédonienne » mentionnée n’est qu’une sous- catégorie de la citoyenneté française car elle n’a aucune valeur juridique propre : elle est subordonnée à la nationalité française. Ce vernis sémantique vise à donner corps à une autonomie qui reste sous contrôle direct de Paris.
Qu’en est-il des relations extérieures et des compétences régaliennes ?
Là encore, les mots masquent la réalité. Les relations extérieures qui seraient « transférées » sont l’exacte reproduction du système actuel de l’Accord de Nouméa, dit de « souveraineté partagée ». Celui-ci autorise déjà des relations diplomatiques dans la zone à la condition qu’elles ne contredisent en rien les intérêts de l’État français. Quant aux compétences régaliennes, leur transfert est soumis à un processus à plusieurs verrous : majorité qualifiée de 64% au Congrès, accord de l’État, puis référendum des citoyens calédoniens dits « nationaux ». Cela rend tout transfert effectif très improbable. C’est un mécanisme d’obstruction structurelle.
Le projet est-il réellement évolutif, comme le prétend l’État ? Quels sont les mécanismes juridiques qui rendent illusoire toute perspective d’émancipation ?
Le projet vise précisément à figer la situation. Il institue un « statut pérenne » sans échéance politique, verrouillé par une loi fondamentale qui instaure en pratique un droit de veto aux non-indépendantistes. Tout repose sur un double verrou : une loi fondamentale adoptée à la majorité des 3/5e et une loi organique spéciale votée à Paris. Cela donne un droit de veto permanent aux anti indépendantistes. Ce qui est présenté comme un partage de pouvoir est en réalité un dispositif d’immobilisation politique. Le nom du pays, le drapeau, les règles budgétaires : tout est renvoyé à plus tard, dans des conditions de vote inaccessibles. C’est une architecture qui empêche l’émancipation, mais qui pourra paradoxalement servir aux indépendantistes devenus minoritaires par le renforcement du nombre des sièges donnés à la province Sud et l’ouverture du corps électoral aux arrivants français à se défendre contre les régressions à venir. On organise ainsi l’impossibilité de toute réforme future en profondeur, tout en renvoyant les sujets sensibles — nom du pays, drapeau, fiscalité, gouvernance — à un futur indéfini.
L’ouverture du corps électoral et les orientations économiques proposées soulèvent des inquiétudes profondes. En quoi ce projet aggrave-t-il les inégalités structurelles au lieu de les corriger ?
Parce qu’il ne cherche pas la justice, mais la continuité du peuplement colonial. L’ouverture du corps électoral, au-delà des natifs et des descendants qui est un point de consensus, légitime une colonisation de peuplement qui fut au cœur de l’insurrection de mai. C’est une ligne rouge pour les Kanak. Le projet d’accord entérine les inégalités car le projet économique, lui, recycle les vieilles recettes : grands travaux, défiscalisation, base militaire, prison. Il ne prévoit rien pour corriger les déséquilibres entre provinces ni pour réparer l’injustice foncière. La solidarité, la redistribution, l’autonomie budgétaire : rien n’est au rendez- vous. Ce texte consacre une domination institutionnelle renforcée, au détriment des droits du peuple kanak.
Entre neutralisation du droit à l’autodétermination et réactivation de la colonisation de peuplement, ce projet semble nourrir les fractures plutôt que les apaiser. Quelles alternatives politiques restent aujourd’hui ouvertes ?
Ce projet est difficilement amendable tant il repose sur une logique de double contrôle des Kanak par la France et par les Européens. Deux pistes existent encore : d’un côté, le projet de pleine souveraineté avec convention d’interdépendance porté par le FLNKS ; de l’autre, une hypothèse de confédération évoquée par Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie, mais restée sans suite. En tout état de cause, il faut cesser de repousser les élections provinciales et relégitimer les élus du pays. C’est dans le temps du mandat — et non dans la précipitation institutionnelle — que peut se construire un nouveau chemin. Une consultation binaire prévue en février 2026 aboutirait nécessairement à un clivage massif, frontal et émotionnel des deux identités du pays.
Notes
- (1) Photo : Actu.nc