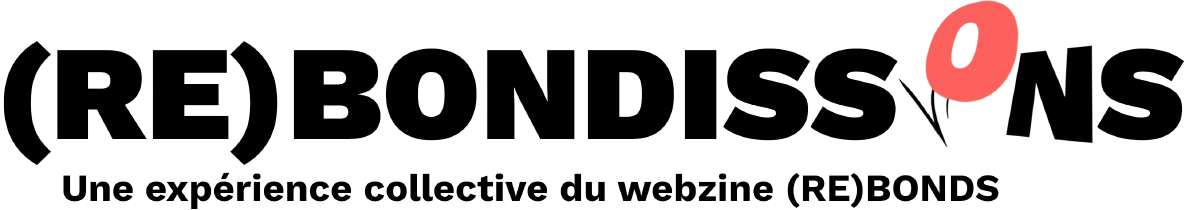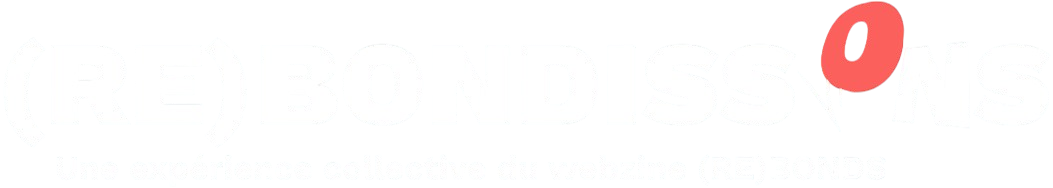Entretien avec Guillaume Vama -Dans l’attente de son procès, l’agro-forestier kanak veut construire des ponts entre Bourges et le Pacifique
D’où es-tu originaire en Kanaky Nouvelle-Calédonie ?
Je viens de Kwenyii, dans le sud du pays. C'est le nom kanak de l’île des Pins. Je fais partie du clan Vama, un clan de pêcheurs et d’agriculteurs qui vit sur l’île des Pins depuis des années.
Quel est ton parcours d'études ? Qu'est-ce qui t'a fait arrêter l'école rapidement ?
Je n'ai pas passé le brevet, j'ai arrêté l'école à 16 ans, par choix. J'étais bon élève, mais je ne voulais pas continuer et j'ai quitté l'école.
J'avais eu l'opportunité de prendre connaissance de l’allégorie de la caverne de Platon. C’est à partir de là que j'ai eu le courage d'imaginer mon propre système d’éducation. J’ai fait beaucoup de formations et, à mes 20 ans, j'ai décidé d'entrer dans l'auto-entrepreunariat en créant une entreprise. Jusqu’à mes 25 ans, je suis allé chercher d'autres savoirs.
J'ai fait des formations dans l'agriculture, dans le conventionnel au départ. Ça ne m'a pas plu parce qu’il n'y avait aucun lien avec le vivant. J'ai largué ça et j'ai fait de l'agriculture biologique. Sur le territoire, on n’en parlait pas vraiment, ça n’était pas encore la mode. J'ai été formé en sylviculture, en horticulture, dans tout ce qui est en rapport à la terre. Après, je suis parti en agro-foresterie.
J’ai fait aussi des formations de développement personnel pour être coach.
J'ai effectué des voyages à Budapest, à Peï au sud de la Hongrie, où j’ai passé un mois. Je suis allé voir des conférences, j'ai lu des livres, j'ai été chercher moi-même le savoir, notamment sur les disciplines cognitives : psychologie et philosophie, neuro-sciences, anthropologie, intelligence artificielle. A partir de là, mon but a été de développer l'accompagnement, la relation d'aide par la thérapie et le coaching. Pour moi, il s'agissait de relier la prise de conscience d'une personne, d'une situation, à la manière dont fonctionne un process, pour ensuite transformer ça en action. Sur le territoire, que ce soit sur les terres coutumières, dans le domaine économique, dans le domaine politique : il n’y avait pas assez d'actions qui avaient du sens. Beaucoup de choses se faisaient parce que l'un faisait cette chose-là, et l’autre voulait le faire aussi. Il n'y avait pas d’initiatives innovantes. Moi j'avais cette énergie justement, pour faire les choses différemment. Ça, c’était une première étape. Après, je suis allé me former dans le coaching et la thérapie, et aussi dans la communication non-violente. J'ai donné des formations par la suite, en communication non-violente et en agriculture biologique.
J'ai reçu un diplôme : un CAP agricole, dans le cadre d’une formation en alternance avec une entreprise et une pépinière. Mais pour moi un diplôme, ce n'est pas bout de papier qui va définir qui je suis : c’est mon moi intérieur et pas mon apparence. Même le nom et le prénom qui m'ont été donnés, c’est pas moi directement. Tous, nous avons reçu des noms et prénoms, mais cela ne définit pas qui nous sommes vraiment. Nous devons le découvrir par un travail intérieur. Un diplôme c'est beaucoup d'expérience, qu’il faut aller chercher.
J'ai rencontré beaucoup de blocages sur mon chemin, dans le contexte coutumier, dans le contexte politique, dans le contexte particulier du territoire, où tous les besoins de développement ne sont pas structurés, encore aujourd'hui.
Pourrais-tu nous dire ce qui, dans la caverne de Platon, t'a motivé à quitter l’école ?
L’allégorie de la caverne : des personnes sont enchaînées dans une caverne. Des ombres derrière se reflètent dans le fond. Quand quelqu’un va à droite, tout le monde va à droite ; quand quelqu’un va à gauche, tout le monde va à gauche, ou tout le monde s'assoit, etc. A un moment, le protagoniste décide de casser ses chaînes et de sortir. Au cours de son passage, il traverse, saute ou casse des murs. Devant un premier mur, il rencontre des personnes qui tiennent des marionnettes. Il voit que ce sont des humains comme lui. Et ce qu'il va comprendre, c'est que derrière, il y a cette lumière alimentée par un feu, lui-même alimenté par le système de croyance de ces gens. D’autres feux utilisent leurs croyances pour des intérêts qui leur sont propres, pour les manipuler. Le personnage sort de la caverne, mais il décide d’y revenir, pour faire les choses différemment.
C'est comme ça que j'ai compris l’allégorie, et qu’à l'âge de 16 ans, j’ai voulu tracer ma propre route, mon propre chemin, c'est pour ça que j'ai fait le choix de l'aventure.
Aujourd’hui, j’entreprends pour le pays, je crée des entreprises, je fais du conseil aussi. J'accompagne beaucoup d’entreprises privées, de provinces, d’associations, de gouvernements, sur des projets. Je monte aussi moi-même beaucoup de projets. Par exemple, avec la création d’un incubateur sur le territoire avec l’ONG Itkel, dont j’étais président.
Tu veux allier la tradition et la modernité à travers tout ce que tu fais...
Oui, complètement. Parce que pour moi, on peut avancer avec la modernité et lui donner un sens si elle est ancrée dans ́les racines de l’humanité, dans celles de l’éco-système pour nous humains, qui prenons tout dans la nature. Il faut trouver le bon équilibre.
Prends l’exemple d'une graine qui est mise en terre. La première chose qui va en sortir, ce ne sont pas les feuilles qui vont partir vers l’extérieur, ce sont les racines. Et pour moi, nos traditions, ce sont les racines de cette graine. C’est avec ces racines que peut être construite toute la partie aérienne, qui est l'avenir !
D'un côté, les traditions sont inscrites dans notre humanité, de l'autre on peut aller vers la modernisation, qui a complètement sa place. Mais aujourd’hui, dans cette société, on voit qu’il y a des choses qui n’ont plus de sens. Il n’y a plus de place pour la vie, aucun respect pour elle, aucun respect de l’humain, de l’écosystème. L'homme a l’audace de se faire appeler homme sage-sage, sapiens-sapiens. Mais en fait, la sagesse ne fait plus partie de nos paradigmes. Notre esprit, au lieu de grandir, a rétréci. Pour moi, les traditions, c’est important, parce que ça nous permet de prendre racine, de faire des hommes ou des femmes solides. Et donc les capacités à construire un monde meilleur.
Dans l’idée de rendre ce monde meilleur, il y a l’écologie. C’est un enjeu pour toi et la Kanaky.
Oui, c’est un enjeu, parce que toute notre culture, la coutume, la civilisation kanak, sont liées au monde du vivant. Chaque chose qui fait cet éco-système a une importance pour nous. Si on regarde toute la zone Pacifique, le lien à la coutume, c'est le respect de la vie, de la terre et de l’océan pour tout le monde. Ce sont des choses partagées de génération en génération.
Mais il y a quand même des limites parce qu’aujourd'hui, avec ce déséquilibre, il n'y a plus vraiment de tradition ni de culture, il y en a beaucoup qui avancent vers la modernisation. C’est tout un équilibre à trouver. Moi je suis très admiratif du peuple du Pacifique, surtout de chez nous en Kanaky, parce que tout le monde s’est mis debout pour préserver sa culture. Malgré l’oppression de l’Etat colonial, la préservation de la culture a été importante.
« Planter pour nourrir les populations correctement »
Avant que les Français débarquent en Kanaky en 1853, vous étiez en autonomie alimentaire, mais aujourd'hui, la Kanaky Nouvelle-Calédonie importe 80 % de son alimentation.
87 % en fait. De là mes engagements : l’agro-foresterie, l’accompagnement à l'installation de projets agricoles respectueux de l’environnement. J'ai été élu à la Chambre d’Agriculture : j'y ai apporté cette vision justement d'aller vers l'autonomie alimentaire, avec des choses constructives.
Je te donne un exemple : en agro-foresterie, on est souvent pas bien reçu au niveau de la Chambre d'agriculture, et même sur le territoire. C'est un système qui ne rentre pas vraiment dans les clous des productions productivistes comme le veut le marché. Mais aujourd'hui, le marché propose des produits qui détruisent la vie du sol, le système immunitaire de nos enfants, et empoisonne nos anciens. Alors est-ce qu'on veut gagner de l’argent pour attraper un cancer ou vivre longtemps en bonne santé ? Qu'est-ce qui est le plus précieux pour un agriculteur : planter pour faire du chiffre ou planter pour nourrir les populations convenablement ? La diversité ne donne pas les mêmes quantités que dans le conventionnel. Mais dans l’agriculture régénératrice, comme l’agro-foresterie, c’est la diversité des cultures qui constitue la richesse du système, un point positif pour le sol et l’environnement, comme pour la population.
J’ai été président d'une structure qui s'appelle « Agir », et je disais à tous nos adhérents : « on ne mise pas sur un capital qui se trouve dans les comptes en banque : notre capital, c’est le sol. C’est la seule chose qu’on léguera aux générations futures. »
Le conventionnel n’est pas durable, il détruit la vie. Mais il finit par découvrir qu’il perd son temps et son argent, il n’est en lien direct qu'avec son capital bancaire. En fait, il se tue, quoi ! C’est un serpent qui se mord la queue. Et il ne s’en sort pas. Il bouffe des crédits de l’Etat, des provinces, toujours pour produire plus. En fait, il ne vit pas. Toutes les personnes que je connais qui vivent dans ce système-là produisent de la nourriture à gogo, pour ensuite la jeter ou pour nourrir des bêtes. Elles gagnent de l’argent pour acheter des produits transformés. Il n’y a pas de vision d'une autonomie alimentaire.
Il y a un besoin de réapprendre à marcher ! Et ce qu’on met en valeur avec l’agro-foresterie, c’est le capital-sol ! C’est pour nous la chose la plus importante. Il y a une expression qui dit que quand on va en mer, pour la pêche au thon ou au Mahi-Mahi, on rencontre souvent des DCP (Dispositifs de Concentration de Poissons). Il existe toute une chaîne de biodiversité autour du DCP. En bien nous, les systèmes qu’on met en place en agro-foresterie, ce sont des DCB, des Dispositifs de Concentration de Biodiversité. Ce sont tous les bienfaits qu’on met en œuvre pour la biodiversité. Quand on refait une forêt ou qu’on refait le sol, qu’on amène des systèmes d’irrigation, certes, cela n’intervient pas sur la production les trois premières années, mais ce sont clairement des économies sur le long terme. Et c’est ça la vision de l’économie, c’est ça la base de la création de valeurs.
Et l’agro-foresterie embauche beaucoup plus de personnes que ne peut embaucher un agriculteur dans le conventionnel. Pourquoi ? Parce que le mec, dans le conventionnel, il va acheter un tracteur. Le tracteur, nous on le remplace par 10 ou 20 emplois. C’est l’avantage que je défends. C’est tout le sens qu’il y a derrière cet éco-système.
J’étais dans une commission de la Chambre d’agriculture en tant que représentant de l’ATF, l'Agriculture Traditionnelle et Familiale : pour nous, cultiver, c’est quelque chose de quotidien. Quand tu n’as rien à faire, tu vas faire un tour dans les champs, comme dans les campagnes en France. Ou alors dans un petit jardin autour d’une maison. On n’a pas cette vision de voir large et grand. Et c’est ce que je propose : on ne peut pas forcer les gens à faire des 4 hectares, des 10 hectares, des milliers d'hectares ! Parce que ça ne vient pas d’eux, ils n’ont pas envie. Ce qu’on peut faire, c’est les mettre en réseau, leur accorder des parcelles de 100 m2 ou d'un hectare, et ce sera l’ensemble de ces petites cultures qui constitueront la diversité pour ce besoin d’autonomie alimentaire.
« Etre Kanak, c’est de la fierté, de la richesse, des valeurs partagées, des gestes coutumiers »
Tu parlais de capital de la terre, tu as aussi un capital culturel important en tant que Kanak, en étant héritier d’une longue et riche culture. Qu’est-ce que ça représente pour toi, d’être Kanak en 2025 ?
Ca représente de la fierté, de la richesse, des valeurs partagées de génération en génération, non pas par l'écrit mais par la parole, et des gestes coutumiers. Je suis très admiratif du fait que la population kanak a tissé cette force-là avec la culture, et qu’elle continue de la tisser.
Ces dernières années, la Kanaky Nouvelle-Calédonie a vécu plusieurs référendums sur son statut : comment les as-tu vécus ?
Les deux premiers référendums, je les ai vécus avec un sentiment de gratitude, gratitude au sens de la démocratie car c’est au peuple de décider. Pour le troisième référendum, j'ai ressenti de la tristesse de voir en fait que les positionnements de l’Etat ou des loyalistes n'ont pas respecté l'essence même de la culture kanak, qui donne une grande place au deuil (1) : c’est un moment de paix, un moment d'apaisement, de travail sur soi. Ils n’ont pas laissé aux Kanak le temps de faire leur deuil. Je trouve ça triste qu’ils n’aient pas compris ça. Ou qu’ils n’aient pas voulu le comprendre.
L'Etat français, à la suite de la proposition de Nicolas Metzdorf, a fait voter cette loi sur le dégel électoral, qui a d'abord fait naître de grandes manifestations pacifiques (2). Puis cela a pris un tournant plus violent avec les révoltes en mai 2024. Qu'as tu pensé à ce moment-là et comment l’as-tu vécu ?
Nicolas Metzdorf est entré en politique avec des intérêts personnels pour détruire la poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur (2). Il a vraiment des ambitions personnelles : quand je l’ai rencontré, il était ancien élu de la Chambre d’agriculture, et j’étais en mission pour les Provinces, ou pour les gouvernements, ou pour des missions à moi, comme consultant, entrepreneur. Je le voyais déjà un peu opportuniste, avec des ambitions mal posées. Il a utilisé la population et le gouvernement français qui est actuellement au pouvoir, pour ses intérêts et ceux de sa famille. Je trouve ça décevant la manière dont il utilise une histoire politique pour développer ce clivage, plutôt que de trouver des solutions communes pour le développement du territoire. J'ai vécu ce moment comme une trahison au regard de l'avenir du pays, d'un possible destin commun.
Aujourd’hui, on le ressent encore, ce clivage n’a fait que mûrir et se développer, même auprès des jeunes. Ceux qui vivent en Nouvelle-Calédonie vont faire une société parallèle à la Nouvelle-Calédonie. Ils n’ont plus confiance en la politique, ils n’ont plus confiance dans les coutumiers, ils n’ont plus confiance en personne. Et si aujourd’hui ça a pété, et que ni le FLNKS, ni la CCAT n’ont vu le truc partir, c’est que personne ne veut comprendre ces jeunes. Derrière tout le jeu politique qui se fait dans le territoire, les jeunes aujourd’hui, qui sont demandeurs d’emploi, ont besoin d’être accompagnés, et personne ne le fait.
Metzdorf est venu avec le projet de dégel du corps électoral, et tout le dossier était accompagné par le pacte nickel. Ces deux projets étaient liés, c’était une stratégie. Après les deux premiers référendums et la validation par l’Etat du troisième, il s’agissait de passer en force avec un système politique néo-colonial sur la Nouvelle-Calédonie. Je pense qu’il savait que ça allait éclater, sans savoir jusqu’où ça pouvait aller.
« Ceux qui vivent en Nouvelle-Calédonie n’ont plus confiance en la politique »
Il y a une grande droitisation des Loyalistes en Nouvelle-Calédonie. Bakès et Metzdorf étaient plutôt macronistes au début, et là, ils posent pour la photo avec Zemour et Marion Maréchal… Et il semble que ça commence à coincer un peu…
Oui, ça commence à coincer, parce qu’ils ne savent pas comment se positionner. Quand ils disent qu’ils veulent rester dans la France, ce n'est pas pour une vision d'un destin commun, mais c’est par intérêt, parce qu’en Nouvelle-Calédonie, il y a le développement du nickel au niveau international, et la stratégie géopolitique de la Nouvelle-Calédonie est gérée actuellement dans ce sens. Ce sont des familles qui se sont construites avec l’import-export, et si aujourd’hui on peut parler de 87 % d’importation alimentaire, c’est que c’est bénéfique pour ces mêmes familles. C’est une espèce de zone de confort économique dans laquelle les Loyalistes ont vécu depuis des années, et qu’ils veulent continuer à alimenter. Je pense que c’est la question sur laquelle ils veulent se positionner. Parce qu’au-delà de toute cette armature politique, il y a aussi une armature économique. Ils veulent tisser des liens avec des structures politiques en métropole (comme avec Marion Maréchal et Eric Zemmour).
Tu étais membre de la CCAT : quel était ton rôle et qu'est-ce que ça représentait pour toi comme investissement ?
Je ne suis pas membre de la CCAT ! Il y a différents partis sur l'île, comme dans toutes les communes : l'Union Calédonienne, le Palika et, dans le sud, le Collectif Pour la Liberté du Peuple Kanak (CLPK). Ma famille en fait partie, elle se positionne souvent pour l'environnement et ce genre de choses.
J'étais à Tahiti quand tout ça a commencé. En fait, je sne avais pas vraiment ce qui se passait au pays, parce que je n'y étais pas. En y retournant en février-mars, on m'a expliqué, et j'ai dit : il faut qu'on se positionne. Il faut qu'on montre qu'on existe, nous, la jeunesse et aussi les vieux, et qu'on veut préserver la culture kanak. Le dégel, c'est pour noyer les Kanak chez eux. La CCAT a fait des mobilisations en masse sur Nouméa, et nous on l'a fait à l'île des Pins, en parallèle. Pendant 40 ans, l'île des Pins a été une commune loyaliste, et c'est encore le cas aujourd'hui. Pour moi, il fallait montrer que la majorité des personnes qui sont sur l'île sont indépendantistes. Le seul clivage qu'il y a sur l'île, c'est quoi ? Même s'il y a une majorité indépendantiste, c'est toujours les loyalistes qui gagnent ! Par exemple pour les Communales : sur place, l'Union calédonienne et le Palika ne s'entendent pas. Tous veulent représenter le FLNKS mais ils ne s'entendent pas. Du coup, ces dernières années, les membres du Palika ont donné leur voix aux Loyalistes ! Voilà ce qui s'est passé là-haut.
Je suis allé voir tous les représentants (la chefferie, avec le CLPK qui regroupe la chefferie de l'île des Pins, les coutumiers de l'île, l'Union Calédonienne, le Palika et le Comité Rheebu Nuu (3), toutes les forces vives indépendantistes et les coutumiers de l'île), et je leur ai dit de venir avec nous. Nous les jeunes, on n'est pas intéressés par les différents clivages politiques du territoire ! Ce qu'on veut, c'est une clarification au sein du FLNKS, et avancer ensemble. La CCAT faisait déjà ces choses.
Les manifestations pacifiques sur l'île des Pins, c'était pour montrer que si quelqu'un devait gérer l'île, ce serait nous. J'ai dit clairement aux gens sur place : ce n’est pas la mairie, la province, les personnes extérieures à l’île qui vont vraiment nous aider à construire l'île. On doit balayer d'abord devant notre porte avant de vouloir balayer devant la porte du pays. C'est pour ça que le CLPK a été créé. C'est pour ça qu'on a commencé nos mobilisations pacifiques. Je suis lié à la CCAT par le CLPK, mais pour moi, la racine, c'est le CLPK.
Après, on a installé notre base à Saint Louis, et les gens du CLPK y sont restés. Puis tout le monde s'est éparpillé dans les familles à la capitale. Pourquoi Saint-Louis ? Parce que ce sont nos liens coutumiers liés aux chefferies.
Je reste réaliste : avec mes frères, mes petits frères, nous on est à l'île des Pins. Et c'est nous qui allons régler les problèmes de l'île, il ne faut pas attendre que ça nous tombe du ciel, c'est ma philosophie. Je n'ai jamais attendu qu'on vienne m'aider, il faut prendre les choses à bras le corps, prendre des initiatives. J'ai monté mon projet avec toutes les difficultés qu'il y avait sur l'île. La commune, qui est loyaliste, savait que ma famille est indépendantiste. Ils m'ont mis des bâtons dans les roues, je n'ai même pas de compteur d'eau... J'ai eu plein de blocages sur mon projet.
Dans toutes les initiatives que je porte et que je vais continuer à porter, c'est ce message que je vais apporter aux gens : je ne me suis pas trouvé d'excuses, j’ai agi. J'ai développé un état d'esprit sur l'entrepreneuriat kanak, sur ma façon d'entreprendre, qui m'a fait prendre des claques au fil des années, mais je reste toujours solide et intègre avec mes principes et mes valeurs. C'est à ça que les jeunes s'attachent. Même les jeunes viennent vers moi avec respect, et je les respecte. Ils m'écoutent et je les écoute aussi. Je passe du temps avec eux, je crée du lien avec eux, du lien humain, du lien social et culturel, c'est le plus important !
« Le plus dur, c’était la souffrance de ma famille »
Tu as été arrêté à la suite de graves accusations. Il y a bon espoir d’un non-lieu parce que ton dossier apparemment est vide. Tu as été déporté en Hexagone, à Bourges, à 17.000 kilomètres de ta famille.
Peux-tu nous dire comment ça s'est passé ? Et ce que tu as ressenti ? Sais-tu pourquoi tu as été arrêté ?
J'allais enterrer un petit frère de Païta qui avait été tué par des gendarmes. Il a été mis en terre et je suis resté avec tous ses frères et soeurs. Et le lendemain matin, quand je suis redescendu de Païta, je suis allé déposer des cousins de l'île des Pins à Nouméa, et j'ai en profité pour aller visiter un ami à moi, qui fait de l'agro-foresterie et qui dirige une exploitation qui est bien avancée. J'avais à peine terminé une conversation téléphonique avec mon père, qu'une voiture est arrivée et s’est garée devant moi, avec un gars qui a sorti un Famas. Un autre, dans la même voiture, m’a pointé avec un revolver, et juste à la fenêtre de ma voiture, un autre gars a pointé le côté gauche de ma tête et m’a dit de mettre les mains en évidence sur le volant. Mon cousin, à côté de moi, partait en panique. J'essayais de le calmer. On nous a fait sortir de la voiture. On nous a mis au sol, on nous a cagoulé, on nous a attaché avec des liens plastiques aux mains et aux pieds. Après, on nous a fait monter dans une voiture.
Je ne pensais pas que c'était des gendarmes, je croyais que c'était une milice. Je leur ai demandé : « vous allez me faire quoi ? » Ils m'ont répondu : « on ne va rien vous faire, on est des gendarmes ». Ça a nourri en moi cette incompréhension que je retrouve chez les jeunes, et que je peux comprendre : ne plus avoir confiance en personne.
Puis ils m’ont changé de voiture et de gardiens, et ils m'ont emmené chez moi. En fait, c'était chez ma mère. Heureusement, il n'y avait personne. Ils ont cherché des trucs, ils n'ont rien trouvé, à part une fiche qui ne m'appartenait pas, il l'ont quand même embarquée. J'ai fait 96 heures de garde-à-vue dans une cellule. On a mangé de la soupe. J'ai échangé avec une autre gars par respect pour lui, car il dormait directement dans le bureau des enquêteurs, sous une table. Il y a avait tout le temps trois gendarmes qui me regardaient dormir, qui me surveillaient quoi !
Ensuite, on nous a embarqué au tribunal. Une avocate commise d'office est arrivée. Elle m’a expliqué quelles étaient les accusations, qu’un avion était prêt à partir, et qu’ils allaient nous transférer en France, Bichou [Christian Tein, président du parti indépendantiste FLNKS] et moi. Ils m'ont annoncé que j'allais à Bourges. Je ne savais même pas où c'était.
J'ai demandé à un gendarme, il était gentil, il m'a expliqué. IIs m'ont demandé si je voulais fumer, si je voulais boire quelque chose, ils me faisaient sortir, je sentais de la bienveillance. Les trois gendarmes qui étaient avec moi étaient bienveillants quoi !
Après, on a été transféré. Le plus dur, c'est quand ma mère est venue me dire au revoir. Ma sœur n'était pas là, personne ne savait quand je sortirais, comment ça se passerait, personne ne leur disait rien. Ils étaient dans la souffrance. Parfois au pays, il y a des rumeurs comme quoi ils enlèvent des jeunes et leur tirent une balle dans la tête, qu'ils pratiquent la torture… et la famille pensait que j'étais aussi dans ce cas-là.
Donc j'ai quitté le tribunal, j'ai dit au revoir à ma mère. J'ai pas versé de larmes, je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que tout allait bien se passer, et de passer le bonjour à la famille pour moi. Mais elle n'arrêtait pas de pleurer et pour moi, il y a eu une espèce de boule énergétique, j'imagine ça comme ça, qui est entrée en moi, avec de la haine mélangée à de la colère, un truc que je n'exprimais pas, mais dont je sentais qu'il était entré dans mon corps et prenait racine. Je pense que c'est quelque chose qui me suivra, parce que le fait juste de se dire qu'ils sont capables de faire ça alors qu'ils ont pas de preuves, et qu'ils font subir ça à ma mère, à ma famille, ça m'a détruit. Voilà.
On est allé jusqu'à l'aérodrome de Magenta, et là on a pris un avion jusqu à Tontouta, l'aéroport international, on est allé d'Honolu à Hawaï, où on a fait une escale, et de là à Vancouver au Canada. Et on a pris un avion militaire, sans sièges.
Dans quelles conditions tu étais dans l'avion ?
J'étais attaché. On avait changé de gendarmes. Trois sont restés en Nouvelle-Calédonie et trois autres nous ont accompagnés depuis Magenta. Ils étaient compréhensifs, empathiques, je blaguais avec eux. Ils devaient se dire : « il est bizarre lui, comme terroriste, il a l'air posé, serein, il rigole, il sourit ». Ce qui me déchirait, c'était de voir les femmes, Brenda et Frédérique (4). On n'avait pas le droit de se parler mais je les voyais vraiment tristes. Cette histoire, aucun d'entre nous ne va l'oublier.
Après, on est arrivé à Orléans. Ils ont fait descendre Bichou en premier, moi en deuxième, selon les villes où nous allions être incarcérés. Je me suis dis : « mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont en train de me mettre sur le dos ? » Ils ont refait une fouille, ils m'ont mis un harnais allant des jambes jusqu'à la poitrine, et des menottes. Ils m'ont mis dans une voiture.
« J’ai beaucoup appris sur ma capacité d’adaptation »
Dans quelles conditions as-tu été détenu? Comment ça s'est passé au Bordiot, la prison de Bourges ?
Les détenus m'ont tous accueilli positivement. Quand ils ont su qu'il y avait un détenu particulièrement surveillé qui allait débarquer là-bas, ils se sont renseignés. Ils m'ont tous fait glisser des cigarettes, des mots comme « si tu as besoin de quelque chose, n'hésites pas, tu as notre soutien ». C'était des gens que je ne connaissais pas et du coup, beaucoup de mecs sont devenus des frères parce que je les respecte. Certes, ils ont fait des conneries, beaucoup pour des histoires de stups’, mais ça reste des humains. Ils avaient de l'admiration pour le fait de lutter pour notre culture.
Après les quatre premiers mois en isolement, je ne me suis pas laissé aller par la routine : je lisais beaucoup, j'allais à la bibliothèque, j'avais toute une organisation entre le sport et la lecture. J'ai appris beaucoup sur ma capacité d'adaptation à n'importe quel environnement, et sur le fait d'avoir confiance. Aujourd'hui, j' ai envie de partager ça avec d'autres, cette force d'esprit qu'on se donne pour construire des choses. Du coup, moi là bas, on m'a mis rédacteur en chef du journal du Bordiot. J'ai écrit beaucoup d'articles. Même les gens du SPIP me disaient : « tu exagères, on sait pas où tu vas chercher toutes ces informations, est-ce qu'il y a un téléphone dans ta cellule ? » Je leur répondais : « non, c'est de la lecture ». Il y avait une véritable bibliothèque dans ma cellule, j'ai sorti trois cartons de là-bas.
Quand tu écrivais dans le journal du Bordiot, tu écrivais sur quoi ?
Sur la culture kanak, l'échange de la coutume, la case dans la culture kanak, les liens, la représentation des cultures du Pacifique. Aussi sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, le développement durable.
Tu as organisé aussi des groupes de réflexion avec des prisonniers sur la communication non violente.
Oui, c'est ce que j'organisais en tant que bibliothécaire. Je recevais trois groupes : ceux du premier l'étage, du deuxième et du rez-de-chaussée. Je leur faisais des formations,. Certains hésitaient à venir, mais une fois que leurs copains étaient venus, c'était bon.
Sur la communication, j'ai beaucoup lu de livres de Thomas d’Ansembourg, des livres sur les neuro-sciences, sur le coaching, sur la psychologie, et beaucoup sur l'histoire du développement durable, tous les livres que je trouvais intéressants... Les livres changeaient d'étages. J'étais le seul mec qui échangeait des livres...
Comment s'est organisé le soutien autour de toi : ta famille, le Collectif Solidarité Kanaky 18, les personnes qui t’écrivaient, tes avocat.es ?
Le soutien autour de moi a été fondamental. Mon frère Jacky et ma sœur Odile ont été très présent.es pour organiser la mobilisation. Le Collectif Solidarité Kanaky 18 m’a soutenu avec une constance remarquable, aux côtés de mes avocat.es, notamment Maître François Roux, avec qui un lien fort s’est tissé. Et puis ma femme, ma famille.
Je tiens à remercier profondément toutes celles et tous ceux qui ont épaulé ma famille venue du pays, l'ont hébergée et accompagnée. J’ai aussi reçu un nombre incroyable de lettres, de la Corse jusqu’en Bretagne, de Belgique, du Canada et des Outre-mer. Je suis sorti de prison avec des sacs entiers remplis de courriers. Ces messages venaient de personnes que je ne connaissais pas, mais qui étaient connectées à l’injustice que je vivais. Merci à ces Françaises et Français fier.es de leur culture, qui ont vu en moi un frère, et m’ont soutenu sans me connaître.
Quelles sont les conditions matérielles dans lesquelles tu te trouves aujourd’hui ? Reçois-tu une aide de l’Etat ?
Je suis interdit de retour sur mon territoire, la Kanaky Nouvelle-Calédonie, donc loin de ma fille, de ma famille, de mon clan, de mes frères et sœurs. Et pourtant, je ne bénéficie d’aucune aide de l’Etat.
Personne ne m’a accompagné dans mes démarches administratives, ni pour mes soins. J’ai des problèmes de santé, notamment aux genoux : un ligament croisé rompu en détention, et d’autres douleurs dues à mon transfert. Aujourd’hui, je peux à peine rester debout sans souffrir.
Je suis sorti de prison sans ressources. Ma vie est en Kanaky. Je suis ici pour construire, pas pour survivre. J’ai besoin de partenaires pour lancer mes projets car je suis entrepreneur dans l’âme, et j’ai besoin de stabilité financière. Ici, tout s’achète, même les soins.
« J’aimerais bâtir des ponts entre Bourges et le Pacifique »
Tu sembles t’être attaché à Bourges, malgré les circonstances. Pourquoi ? Que souhaites-tu partager avec cette ville ?
Malgré les circonstances, Bourges a été un lieu d’apprentissage. En détention, j’ai travaillé à la bibliothèque. Grâce aux intervenants culturels et au SPIP, j’ai découvert l’histoire de la ville. J’ai beaucoup appris à travers ces riches échanges.
Bourges va être capitale européenne de la culture en 2028, et cette dimension culturelle m'inspire. J’aimerais bâtir des ponts entre Bourges et le Pacifique, en valorisant la culture kanak et celles des autres îles. Créer des échanges pour nos jeunesses respectives, faire dialoguer nos traditions, nos inspirations, nos rêves.
Que sais-tu de la situation actuelle en Kanaky ?
La situation est politiquement, socialement et économiquement instable. Il y a une grande tension dans le pays.
Un « accord » a été signé à Bougival le 12 juillet. Quel est ton avis ?
Oui, cet accord a été contesté par le FLNKS. Selon moi, un accord d’avenir ne peut pas se faire sans une véritable démocratie participative. Il doit être écrit par le peuple, avec le peuple. Les jeunes doivent y participer. La co-construction est la seule voie possible.
Le système politique calédonien est resté figé dans les années 80. La jeunesse, qu’elle soit de droite ou de gauche, a été mise de côté. Les mêmes leaders ont reproduit les mêmes schémas sans ouvrir les portes à la relève, ni faire les efforts nécessaires pour la paix.
Je suis admiratif de certains modèles, comme ceux des pays scandinaves. Il nous faut faire un entonnoir d’innovations sociales, politiques, environnementales et culturelles venues du monde entier, pour bâtir une Kanaky nouvelle.
« Aucun jeune Kanak n’oubliera le 13 mai 2024 »
Comment vois-tu l’avenir pour la Kanaky Nouvelle-Calédonie ? Et que souhaites-tu pour ton peuple ?
Je souhaite que mon peuple soit reconnu institutionnellement, que l’Etat respecte sa volonté d’être souverain. Aucun jeune Kanak n’oubliera le 13 mai 2024. Ce jour restera une blessure profonde, car il symbolise la manière dont le peuple premier a été discriminé et dénigré.
Je souhaite aussi que les autres communautés comprennent que nos anciens ont toujours laissé les portes ouvertes. Accueillir l’autre, dans notre culture, c’est l’honorer, car il peut apporter une richesse intellectuelle ou spirituelle.
Mais cette générosité doit aller dans les deux sens. Comme le disait Pierre Declercq – dont je vous encourage à relire les discours – le respect, la réciprocité et la justice sont les fondations de la paix.
Je crois que l’avenir se construira dans la multiculturalité, si et seulement si la reconnaissance du peuple kanak devient une réalité.
Tout être humain aspire à la liberté : financière, spirituelle, intellectuelle, physique. C’est cela qu’on nous refuse encore aujourd’hui. Voilà ce qu’on refuse à la jeunesse kanak, calédonienne, et océanienne.
Quels sont tes projets aujourd’hui ?
Associatifs : je souhaite renforcer les liens entre la Kanaky et la France, en commençant par le département du Cher, pour mettre en place des échanges culturels autour de l’agriculture traditionnelle, de l’artisanat et de l’entrepreneuriat.
Je souhaite que l’association Kâorë, dont je suis membre, puisse bénéficier de partenariats locaux et institutionnels en Hexagone, pour accompagner des jeunes de Saint-Louis et de l’île des Pins dans des projets d’insertion culturelle. Car si nous ne proposons rien à nos petits frères, c’est la prison qui les attend.
J’accompagne également l’ONG Itkel, qui regroupe des associations et porteurs de projets de tout le pays, engagés dans le développement durable et l’accompagnement des jeunes.
Projets professionnels : en détention, j’ai développé des outils de coaching et de thérapie adaptés aux réalités culturelles du Pacifique. Je suis formé en coaching et en accompagnement thérapeutique, et j’aimerais accompagner d’autres personnes dans leur développement personnel et entrepreneurial.
« Venez toucher, écouter, sentir ce que nous défendons »
Pour découvrir la Kanaky Nouvelle-Calédonie, quels livres, musiques ou films recommandes-tu ?
Je vous conseille d’écouter du Kaneka, cette musique engagée et enracinée dans nos luttes. Explorez aussi les musiques de Wallis-et-Futuna (Souamako), Tahiti (Angelo), les Marquises, Fidji, Vanuatu, Salomon, Samoa… Toute l’Océanie a des trésors à offrir.
Pour les films, je recommande de prendre contact avec le Centre Culturel Tjibaou à Nouméa et le Centre Culturel de Koné au Nord. Ils sont des mines d’or pour comprendre notre culture et nos combats.
Mais surtout : venez ! Venez toucher, écouter, sentir ce que nous défendons. Allez à la rencontre de nos tribus, de nos communes. Malheureusement, beaucoup de Calédoniens n’ont jamais quitté Nouméa. C’est dommage de vivre dans le Pacifique… comme si on vivait à New York.
Propos recueillis par Christiane Carlut et David Clary
Notes
- (1) Le troisième référendum s'est passé durant la période du Covid.
- (2) Lire notre rubrique historique (Re)découvrir.
- (3) Organisation environnementale du Grand Sud de la Nouvelle-Calédonie. Voir : https://oeil.nc/cdrn/index.php/acteur/view/45
- (4) Brenda Wanabo-Ipeze et Frédérique Muliava, également arrêtées dans le cadre de la révolte de mai 2024. Elles sont sorties de prison sous contrôle judiciaire dans en Hexagone le 10 juillet. https://la1ere.franceinfo.fr/on-a-reussi-incarcerees-dans-l-hexagone-les-independantistes-kanak-frederique-muliava-et-brenda-wanabo-ipeze-sortent-de-prison-1504850.html
Plus
Le lien vers le site présentant le projet de Guillaume Vama, entre Bourges et le Pacifique : https://tjungupacifika.wixsite.com/tjungu