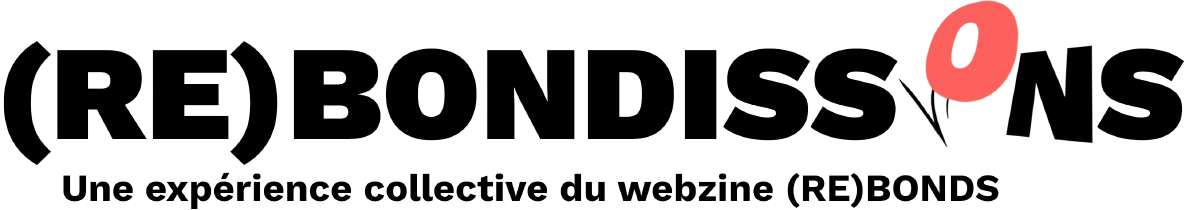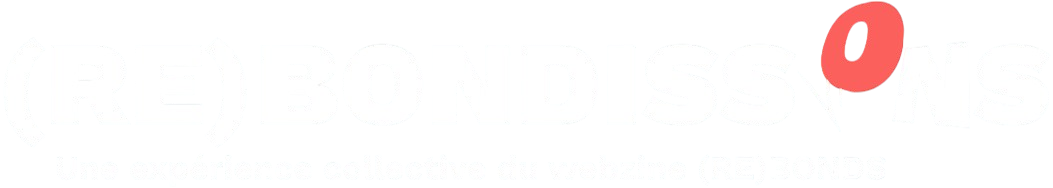La Horde présente « Dix questions sur l’antifascisme » à Bourges
Peux-tu présenter La Horde ? Comment et par qui a-t-elle été créée ?
Le collectif existe depuis l’été 2012.
Les fondateurs étaient déjà des militants, pour les trois quarts principalement dans l’antifascisme. A l’époque, les grands réseaux antifascistes n’existaient plus et il y avait un manque de visibilité des groupes présents sur le terrain.
On était un groupe de gens qui se connaissaient bien avec certains savoir-faire, par exemple en graphisme, pour la recherche antifasciste, Internet...
On a mis tout ça en commun pour proposer une boîte à outils au service des antifascistes, groupes ou individus.
Dès le début, on a cherché à mettre en valeur les actions des groupes antifascistes mais concernant l'information, cela a un peu évolué au fil du temps : au départ, on travaillait sur l’actualité en menant des enquêtes, puis petit à petit, on a plutôt développé des outils pédagogiques pour rappeler ce qu’est l’extrême droite et ce qu’est l’antifascisme.
Cette dimension pédagogique a trois axes : le matériel (1), le site Internet et les interventions, formations publiques ou semi-publiques mais toujours en lien avec des structures militantes, autonomes ou syndicales, par exemple.
Notre ligne, c’est de rendre les choses accessibles au plus grand nombre.
Comment définissez-vous le fascisme ?
A La Horde, on ne parle pas trop de fascisme même si ça nous arrive d’utiliser ce terme. C’est un mot qui nous gêne un petit peu et on explique pourquoi dans le livre.
La première raison, c’est qu’il n’existe pas de définition du fascisme, c’est-à-dire que même les historiens ne sont d’accord que sur une seule chose : on ne peut pas en donner une définition précise. Le fascisme mussolinien a plein de contradictions et n’est pas une doctrine à proprement parler, avec un ouvrage de référence comme a pu l’être le nazisme, par exemple. C’est un objet fluctuant.
Autre raison : comme il a une période historique précise, il peut y avoir un décalage entre ce qu’il a été réellement et ce qu’il pourrait devenir aujourd’hui.
Mais le vrai problème pour nous, c’est que dès les années 1920-1930, le mot « fascisme » a été utilisé à gauche – par les communistes d’abord, par les socialistes ensuite et par à peu près tout le monde enfin – comme une insulte. Etait fasciste tout ennemi politique, finalement. Le terme a aussi été dévalué puisque, aujourd’hui, l’extrême droite vous explique que les fascistes, ce sont les antifascistes. Quand on en arrive là, c’est que le mot est usé.
Donc, on préfère utiliser le terme extrême droite. L’antifascisme, c’est la lutte contre l’extrême droite et c’est la prise en compte des problèmes posés par l’extrême droite dans les luttes sociales.
Qu’est-ce qu’on entend par extrême droite ? Pour nous, ce sont des gens, qui politiquement, défendent une vision inégalitaire du monde et des rapports humains. La société doit reposer sur l’inégalité entre les êtres humains c’est-à-dire qu’il faut accepter que l’inégalité ne soit pas quelque chose qu’on subit, mais quelque chose qui est naturel et que c’est bien.
Ce sont des fondamentaux, ce ne sont pas des idées à la marge.
C’est une vision globale, qui ne se pense pas comme une idéologie mais comme la vérité. Ça, c’est un autre élément très important. L’extrême droite ne dit pas : « on pense ça, ce sont nos idées », elle dit « on pense ça parce que c’est la vérité ». Et l’idéologie serait ce qui aveugle les autres courants politiques.
A gauche, on est égalitaire, mais on sait que c’est par idéologie : on sait que défendre un projet de société avec des relations égalitaires entre les gens, c’est porté par des idées.
Alors que l’extrême droite dit : on sait comment c’est dans la nature, on sait ce que dieu veut, ce que le bon sens veut, et ce sont des rapports inégalitaires entre les gens.
On confond le fascisme avec beaucoup de choses : avec le racisme ou l’autoritarisme. Or l’autoritarisme, ce n’est pas spécifiquement d’extrême droite, ni de droite, ça peut être de gauche. C’est une manière de gouverner.
Bien sûr, comme l’extrême droite est persuadée de détenir la vérité, elle va vouloir l’imposer de manière autoritaire. Mais c’est une façon de mener le projet, ce n’est pas le projet lui même.

Y a-t-il une spécificité « à la française » ?
Dans le fascisme, il y a l’idée de proposer quelque chose pour le futur, quelque chose qui n’est jamais advenu, qui nous projette vers l’avant.
Alors qu’en France, l’extrême droite a le regard totalement tourné vers le passé parce que son origine même est dans les mouvements contre-révolutionnaires. Elle situe le déclin de la France à partir des Lumières avec la Révolution française, quand le concept d’égalitarisme a surgi. Avant les Lumières, personne ne contestait les inégalités. La Monarchie absolue, l’Église qui tient la société… ça représente l’âge d’or pour l’extrême droite.
Même si le nationalisme est de gauche puisque le concept émerge au moment de la Révolution française, très vite, il va être récupéré par l’extrême droite et va se construire avec les mouvements réactionnaires, contre-révolutionnaires. A la fin du XIXe siècle, Maurice Barrès va poser un certain nombre d’idées : le fait que la France est en déclin, le fait que pour s’ancrer dans l’histoire il faut s’ancrer dans un territoire, et Charles Maurras va compléter en introduisant le lien entre nationalisme, antisémitisme et projet contre-révolutionnaire.
Tout ça va se concrétiser au moment de Vichy, la seule fois dans l’Histoire où l’extrême droite est au pouvoir en France.
Ce qui est très récent, depuis une dizaine d’années, c’est une relation totalement inversée à l’antisémitisme. Le Front National puis le Rassemblement National tentent de dire : « on n’a rien contre les Juifs ». Tout simplement parce qu’une figure a remplacé celle des Juifs : celle des Musulmans. Ce n’est pas un retournement à 180 degrés : c’est un changement d’identification de l’incarnation de l’anti-France. Mais le mécanisme est le même : on désigne un peuple qui n’a pas vraiment de nation, qui voudrait maintenir l’Occident sous sa domination, de manière insidieuse en s’infiltrant dans la société. Pour les Juifs, via les médias par exemple ; pour les Musulmans, via l’immigration.
Mais l’antisémitisme n’a pas disparu à l’extrême droite, il est juste plus discret. Certains pensent que l’immigration culturelle et cultuelle serait organisée en sous-main par les Juifs… C’est vous dire si les démons sont toujours là...
L’important, c’est que la figure de l’anti-France puisse s’incarner par des symboles forts. A la fin du XIXe siècle, l’antisémitisme était très focalisé sur ce que mangeaient les Juifs, comment ils s’habillaient, la multiplication du nombre de synagogues, leur façon de parler… Ce sont les mêmes phénomènes pour les Musulmans aujourd’hui. Plus ils se voient, plus la thèse de l’invasion prend corps dans l’imaginaire.
Vous avez fait le choix de publier un livre dont le titre se concentre sur l’antifascisme, donc l’anti extrême droite. Pourquoi ce positionnement plutôt que d’écrire un livre sur l’extrême droite ?
On pensait initialement commencer par là. Mais il existe déjà beaucoup de livres sur l’extrême droite alors que sur l’antifascisme en France, très peu, ou alors simplement sous l'angle historique, mais des livres qui l’abordent sous plusieurs aspects, quasiment aucun. Ça nous semblait plus urgent.
A l’intérieur, il y a un chapitre intitulé « Qu’est-ce que l’extrême droite ? » donc on répond tout de même à cette question.
Mais on pense que l’antifascisme ne se définit pas seulement par rapport à l’extrême droite. Il a sa propre raison d’être et une définition plus complexe : c’est un mouvement d’auto-défense populaire, c’est un mouvement d’émancipation, c’est une façon de traiter l’information, c’est une contre-culture…
Comment l’avez-vous écrit ? A plusieurs mains ? Selon des spécialités ou regards particuliers : histoire, sociologie… ?
Il n’y a pas d’universitaires dans notre groupe. On le dit dans l’introduction : on l’a vraiment écrit à hauteur de militant, c’est-à-dire à partir de ce qu’on connaît.
Au départ, dans le plan, il n’y avait même pas les deux chapitres historiques : on pensait renvoyer les gens vers des ouvrages qui existent déjà. Mais finalement, on abordait beaucoup de sujets qui méritaient d’avoir des repères donc on a fait un « digest » le plus concis possible.
On s’est attardé sur une période où il y a peu d’ouvrages, l’antifascisme contemporain. C’est celui qu’on a vécu.
Une seule personne a écrit pour que ce soit fluide et qu’il n’y ait pas trop de styles qui se téléscopent, ce qui est parfois le cas dans les livres collectifs.
On a beaucoup discuté entre nous, on a été voir un certain nombre de personnes pour des questions spécifiques : la sécurité numérique ou le lien entre l’antifascisme et d’autres luttes. On a pu aussi lire des ouvrages et se mettre d’accord sur ce qu’on voulait en retenir, par exemple pour la partie « Ecologie et antifascisme ».
Quelles sont les caractéristiques de l’antifascisme en France ?
Jusqu’à présent, notre définition de l’antifascisme, ce n’est pas seulement la lutte contre l’extrême droite dans le sens où ce serait le problème numéro un et que si on arrivait à se débarrasser de l’extrême droite, nos problèmes seraient réglés. On ne pense pas du tout ça.
On a beaucoup de problèmes et parmi ces problèmes, l’extrême droite se pose en particulier à ceux qu’elle désigne comme boucs-émissaires ou qui portent un projet qui ne va pas dans son sens : des personnes impliquées dans les luttes sociales, d’émancipation, dans une organisation solidaire… En réalité, toutes celles qui ne sont pas d’extrême droite peuvent un jour se retrouver confrontées à elle !
Le travail de l’antifascisme, c’est d’alerter et de permettre d’être préparé : savoir ce qu’est l’extrême droite, voir ce qu’on peut faire pour s’y opposer sur le plan des idées et de manière pratique.
Si la lutte antifasciste peut être autonome, elle ne peut pas être indépendante au sens où elle ne peut être qu’associée à d’autres luttes sociales. C’est d’ailleurs pour ça que la plupart des militant·e·s antifascistes sont impliqué·e·s dans d’autres luttes.
Le projet d’extrême droite est un danger pour la société dans son ensemble. Notre combat n’a donc de sens qu’en lien avec le monde dans lequel on vit et en particulier en lien avec les luttes sociales.

Par rapport au moment particulier que nous vivons, quelle a été votre réaction aux résultats de l’extrême droite aux élections européennes d’abord, et à l’annonce de la dissolution ensuite ?
Comme tout le monde : on n’a pas été surpris des résultats du RN, c’était attendu ; mais aucun d’entre nous ne s’attendait à la dissolution.
On a bien compris le cynisme de Macron de vouloir mettre au pied du mur du pouvoir le RN, en espérant démontrer dans trois ans que le RN est incompétent et n’est pas celui qu’il prétend.
En fait, il arrive au RN ce qui lui était arrivé à lui. Mais ce qui risque de ne pas marcher cette fois, c’est que les gens n’avaient rien projeté de particulier sur Macron alors que le RN est pétri d’un imaginaire puissant.
Pour l’extrême droite, peu importe les faits : une chose n’a pas besoin de se produire pour être vraie, elle est vraie si elle est conforme à l’idée qu’on se fait du monde.
Les « fake news » d’extrême droite sont souvent des faits inventés ou tordus. Mais pas forcément avec l’intention de mentir. Plutôt portées par le fait que, comme leur vision est la seule qui est vraie, peu importe qu’untel n’ait pas vraiment dit ça ou que tel événement ne se soit pas vraiment passé comme ça, parce que ça aurait pu et ça aurait dû. Parce que c’est conforme à l’ordre des choses.
Les électeurs du RN qui disent « on n’a pas essayé » ou « c’est notre dernière chance » ne vont pas, simplement en examinant les faits, se rendre compte que cette dernière chance est une illusion. Sinon ça veut dire qu’ils n’auraient plus rien pour les sauver.
On l’a vu dans les villes dirigées par le RN : quand bien même l’extrême droite aurait une gestion identique à Macron ou avec peu de choses qui bougent – on voit qu’ils se renient déjà sur beaucoup de points – leurs électeurs auront besoin de se dire que, quand même, il s’est passé quelque chose et que ce n’est pas tout à fait pareil, pour ne pas renoncer à l’illusion de cette dernière chance.
Ce qui pourrait réellement faire changer les choses, c’est un mouvement social d’envergure. Quelle que soit la composition de l’Assemblée Nationale au lendemain des élections.
Le quotidien ne s’est jamais amélioré autrement que par les luttes sociales, quel que soit le gouvernement qui a été au pouvoir. Evidemment, un gouvernement RN, c’est le pire contexte pour lutter. Mais on a le sentiment qu’il y a une espèce de combativité qui est revenue de projet – contre-projet. Le fait de revenir à un clivage plus net politiquement donne de l’espoir, que ça puisse redonner du sens à la vision que les gens ont de la société dans laquelle ils veulent vivre.
C’est possible aussi qu’on doive faire vivre ce projet de société égalitaire, d’entraide, de justice dans un contexte hostile. Mais pour l’instant, ce n’est pas joué. Je ne pense pas qu’on aie basculé dans une société où tout le monde est égoïste, raciste… Il y a encore de l’espoir… un espoir qui ne sera pas dans l’attente mais dans l’action.
Sur le site du collectif La Horde, il est écrit que vous ne considérez pas le vote comme l’arme la plus efficace contre l’extrême droite. Pour autant, est-ce que ça peut être une arme intermédiaire et dans ce cas, est-ce que vous appelez à voter ou espérez que les gens iront voter le 30 juin et le 7 juillet ?
Pour nous, le vote est une démarche individuelle. Dans le collectif, il y a des gens qui votent, d’autres pas. On ne débat pas tellement entre nous sur ce sujet. On ne pense pas que ce soit ça qui prime. Même quand les votes sont favorables à notre « camp ». On l’a vu de façon frontale pour les plus anciens d’entre nous en 1981 : l’espoir immense de « Changer la vie » du programme d’union de la gauche… tout le monde y a cru : ce serait fini, l’exploitation, on allait vivre dans une autre société ! Et puis, au bout de deux ans, on a compris…
A partir de là, quand on est de gauche, ça douche. Et les années suivantes, ce désamour avec la gauche électoraliste s’est accentué. En fait, personne ne sait si c’est vraiment profitable d’avoir un gouvernement dit de gauche pour les luttes sociales. Réellement.
Les militants les plus jeunes chez nous, qui se sont formés politiquement au moment de la loi Travail, il ne faut pas leur parler de la gauche électoraliste, c’est même pas la peine !
C’est vrai qu’on n’appelle pas à voter. On pense surtout à l’après. Les gens qui votent à gauche défendent une vision de la société qui ne se mettra pas en place toute seule : elle se mettra en place avec les gens. Donc on dit : « il va falloir être acteur de ce changement ».
A l’extrême droite, c’est tout l’inverse. Le RN n’a pour ainsi dire plus de militants. Ils prétendent respecter les élections et c’est pour ça qu’ils n’organiseraient pas de manifestations, mais pas du tout. Quand il pouvait le faire dans les années 1990, le FN mettait des dizaines de milliers de gens dans la rue. Mais Marine Le Pen a anéanti l’appareil militant du RN pour pouvoir mieux le contrôler.
Désormais, tout se fait par délégation, c’est-à-dire par le vote. L’essentiel de ceux qui votent pour le RN sont dans l’attente d’un règlement par des personnes providentielles. Ce qui n’incite pas à l’action. Et d’ailleurs le RN le dit : « Ne vous inquiétez pas, on s’occupe de tout. Ce n’est pas la peine d’aller dans la rue crier votre racisme, restez bien tranquillement chez vous, ne créez pas de désordre. On fera ce que vous voulez. »
A l’inverse, nous pensons qu’il faut bousculer l’ordre social pour qu’une société égalitaire advienne. Et les élections ne bousculent pas l’ordre social.
Mais nous ne sommes pas dans une posture de dénigrement des gens qui votent.
La présentation à Bourges avait été décidée bien avant les élections. Mais elle tombe plutôt bien… Comment se déroule ce type de présentation ?
En général, on présente le collectif, ce qu’on entend par antifascisme et le projet du livre en vingt minutes. Après, on fait un échange avec la salle en essayant de ne pas parler seulement de l’extrême droite mais aussi de la manière de s’organiser, pour résister. Une résistance pour ne pas laisser le RN détricoter ce qui reste de protection sociale, de protection des salariés et au-delà, pour empêcher que l’inégalité soit inscrite dans la Constitution. Parce que c’est le projet de l’extrême droite. Par exemple, faire de la préférence nationale un principe, c’est un basculement. C’est ce sur quoi tout le reste pourrait s’appuyer, y compris sur un plan économique.
Certains mouvements disent : « regardez les résultats, rejoignez la lutte antifasciste ». Nous, on ne dit pas ça ! On dit : « Regardez les résultats. Le camp de l’égalitarisme, de la lutte sociale, de l’émancipation est en danger. Rejoignez les luttes égalitaires, solidaires et d’émancipation. »
Cette période remet au centre la question de l’extrême droite. Plus personne ne peut dire : « on verra plus tard ».
On a déjà vécu 2002, plein d’autres dates où les gens étaient submergés par le phénomène mais dès qu’ils avaient l’impression que c’était maîtrisé, ils ne s’en préoccupaient plus. Alors que nous pensons que c’est malheureusement une préoccupation constante.
Notre échec est de ne pas avoir su alerter suffisamment le corps social sur ce danger. En vingt ans, l’extrême droite s’est reconstruite de plein de façons différentes, dans l’activisme, sur Internet, sur le plan électoral. Alors que du côté de l’antifascisme, on n’a pas assez anticipé et su se renouveler.
Propos recueillis par Fanny Lancelin
Notes
- (1) Par exemple, le jeu « Antifa ! » à découvrir dans la rubrique (Ré)créations.
Plus
Paru le 15 septembre 2023 aux éditions Libertalia, « Dix questions sur l’antifascisme » fait partie de la collection « Dix questions » comprenant les thèmes de l’anarchisme, du féminisme, de l’antispécisme, du communisme, du syndicalisme ou encore de la grossophobie.
Il est en vente au prix de 10 euros mais est aussi accessible gratuitement au format PDF sur le site de la maison d’édition : https://editionslibertalia.com/catalogue/dix-questions/dix-questions-sur-l-antifascisme