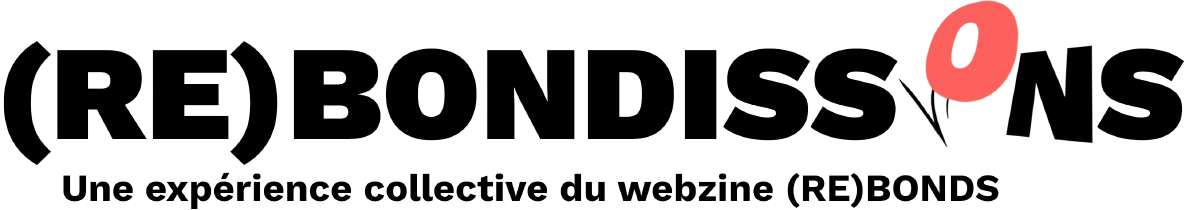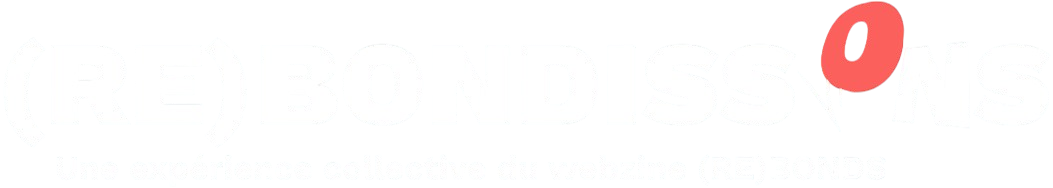L'histoire de Bourges Nord par ses habitant.e.s
Les témoins
Saadane Bensizerara - Arrive à la Chancellerie en 1967 à 8 ans, scolarité dans les quartiers Nord. Militant associatif depuis 1981, participe à la création du Centre associatif (1982) et de l’association El Qantara (1984). Animateur à la MJC Chancellerie (1982), chargé de la création de la Mission Locale pour les jeunes (1982). Intègre le Service jeunesse, l’équipe chargée du DSQ (1) des quartiers nord (1990). Service jeunesse (1997), chef de service en 2001. Centre Communal d’Action Sociale (2005) jusqu’à sa retraite (2021). Président d’Accueil et Promotion (2), vice-président du Centre associatif.
Jacques Caron, attaché de l’INSEE, statisticien à la Direction Départementale de l’Agriculture à Bourges, puis à Beauvais. Vit depuis 1972 à Evreux à La Madeleine, un quartier similaire à la Chancellerie. Poursuit ses engagements militants forgés à Bourges Nord, et comme élu adjoint au maire d’Evreux pendant quatre mandats. A écrit « Quartier brisé - Habitants spoliés » en 2010. Membre du collectif national Stop démolition.
Auguste Dorléans : éducateur puis directeur interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Ministère de la Justice). Conseiller technique sur les questions de prévention spécialisée et contre la toxicomanie. Président départemental du Secours Catholique (2003-2009), président du Foyer de jeunes Travailleurs - Tivoli Initiatives (2011-2012). Membre d'associations d'accueil et accompagnement de demandeurs d'asile.
Renée Effa : école des Métiers d'Art (1952). Elle épouse Pierre Effa, trois enfants. La famille arrive de Lorraine en 1964, suite à la nomination de Pierre à La Poste de Bourges. Renée vit depuis 61 ans dans le même immeuble à la Chancellerie.
Joëlle Peaudecerf : éducatrice de jeunes enfants et éducatrice spécialisée. S’engage à 18 ans à ATD Quart Monde (9 ans), puis à Emmaüs, et Solidarité Français Migrants. Choisit d’habiter Bourges Nord, en travaillant dans le social : éducatrice de prévention, directrice de halte-garderie en milieu semi-rural, éducatrice en milieu manouche à Vierzon. Fait partie de la Bibliothèque de rue, du Tourne-Livres, du Comité des habitants, du Centre associatif, de la Régie de Quartier. Donne aujourd’hui des cours de soutien en français à des personnes de l’immigration. Fait partie de l’habitat participatif La maison des Pourquoi Pas.
1964 – Arrivée de la famille Effa - Renée
On construit un terrain d'amitié dans un quartier.
Des gens arrivent au pouvoir qui n'en ont aucune conscience. Ils veulent tout transformer à leur idée, au lieu de consulter ceux qui vivent là et construisent. Des échanges culturels existaient déjà entre les étrangers qui arrivaient. A l'époque, personne n'avait de logement, français et étrangers se trouvaient dans la même situation, et cela a rassemblé les gens.

Renée et Pierre Effa arrivent à Bourges en 1964, venant de Lorraine, à l’époque du maire Raymond Boisdé (3). Il sont logés dans un immeuble tout neuf, rue Gustave-Eiffel. Les gens, autour d’eux, viennent d’un peu partout, tous sont de nouveaux arrivants. Si Renée est française, elle se sent comme les autres, portugais, espagnols, elle est une étrangère à Bourges. Face à ces arrivants, des interlocuteurs bien installés dans leurs fauteuils administratifs, qui pensent tout savoir et maîtriser du quartier. Renée se sent aussi méprisée que ses voisins. Ça crée une forme d’égalité, le fait qu’on vienne de partout. C’est pour ça que Renée aime bien ce quartier, qu’elle habite depuis plus de 60 ans, et qu’elle n’a pas envie d’en partir. C’est agaçant de voir à quel point les gens se trompent par rapport à ce qui ne leur ressemble pas. Quand on connaît les gens, leurs différences sont des richesses. C’est incroyable tout ce que ses voisins lui ont apporté. Accepter la différence avec les étrangers, c’est aussi accepter la différence avec ses enfants. Ceux qui ne peuvent pas comprendre ça perdent beaucoup, pour eux, leur famille, et aussi pour la société.
Les immeubles de la Chancellerie ont été construits très peu de temps avant l’arrivée des Effa. Les rues sont en chantier, pas d’espaces verts, juste de la ferraille, des cailloux et des grues. Les chantiers, ça va quand il ne pleut pas, mais quand c’est le cas, de la boue partout, qui colle aux semelles. Il faut aussi éviter les déchets du chantier, les bouts de fer et de verre, on ne peut pas vivre comme ça éternellement. Pour les constructeurs, ce sont des problèmes secondaires, il faut répondre aux gens qui frappent à la porte, et la question des espaces verts et du nettoyage des chantiers est reportée aux calendes grecques... Derrière l’immeuble des Effa, des prés, des vaches. Renée va chercher le lait à la ferme des Pressavois, un bidon dans une main, un enfant dans l’autre. Il faut faire la queue, beaucoup de gens fréquentent le lieu.
Cette année-là est menée l’« Opération Landau ». Les habitants commencent à nettoyer eux-mêmes autour de leurs immeubles. Comme les enfants n'ont aucun espace pour jouer, Renée et ses voisines vont chercher du sable sur les chantiers, le rapportent dans un landau au fond duquel elles ont posé du papier journal, devant leur immeuble. Les enfants ont maintenant un espace à eux, un grand rond entouré de bûches, le sable au milieu. Elles créent le premier espace de jeu des quartiers nord.
1965 – Accueil des rapatriés d'Algérie - Renée, Saadane
Pierre Effa s'investit dans l'accueil des rapatriés d'Algérie, Harkis et Pieds noirs. Il n’existe pas de logements pour les rapatriés, on les a rassemblés rue des Frères-Michelin. Saadane estime à une centaine le nombre de familles de Harkis dans le Cher à cette époque. Pierre va les accueillir à la gare, avec des membres de la paroisse Saint-Jean. Ils les aident à réaliser les démarches auprès de la mairie, remplir les dossiers, trouver des logements. Les familles sont dispersées dans les bâtiments de la SONACOTRA (4) et « des rapatrié.es », avenue du Général-de-Gaulle.
Cette année-là voit aussi la création d’Accueil et promotion par l’abbé Cothenet, qui s’occupe de l’accueil des étrangers, leur apporte une aide administrative et organise des cours du soir de français. Pierre Effa en est membre.
1965 – L'association des locataires - Jacques
En 1965 est créée l’Association des locataires, indépendante des grandes fédérations, qui structure, avec peu de moyens financiers, la vie du quartier : un garage loué par Pierre Effa sert de local, le montant des adhésions finance principalement le journal mensuel, « Cité-Flash », un document ronéotypé d'une quinzaine de pages. La rédaction du journal, sa distribution, les contacts pour le renouvellement des adhésions, mobilisent une trentaine de bénévoles. Dans le noyau des animateurs, Pierre Effa, qui est cadre aux PTT, Rémi Platet, contrôleur de la Mutualité Sociale Agricole, un inspecteur des douanes, un architecte, et Jacques Caron, attaché statisticien à la DDAF (5). Le Syndicat des locataires succédera en 1966 à l’Association, et réunira plus de 1.000 adhérents. Son objet est de veiller à la construction d'un cadre de vie convenable pour les habitants de la ZUP (6). Une quinzaine de militants distribuent des tracts et des journaux aux habitants pour les informer de l’existence de l’association.
L'Association des locataires est un groupe dans lequel coexistent une mixité assumée et la diversification des compétences. La philosophie est de s'inscrire dans la durée : pour que le quartier ait un avenir, il faut travailler avec les populations d’origine étrangère, destinées à rester. La même chose se déroule dans d'autres villes, jusqu’à la période dite « de rénovation », qui fut plutôt une période de destruction (des HLM). Et ces destructions, comme celle envisagée pour le Hameau, sont aussi celles de la mémoire.
Pierre explique que le problème des HLM n'est pas celui de la construction, mais que les gens viennent avec leurs propres problèmes. Les constructions n'étaient pas mauvaises, mais les difficultés des habitants n'étaient pas prises en compte, et encore moins résolues.
Un des objectifs de l’Association, puis du Syndicat, revendiqué par Pierre et expérimenté à la tour Jean-Rameau avant sa démolition : pour que les logements soient bien tenus, il faut un gardien pour 100 logements. En 2025, les quartiers nord, avec leurs 4.000 logements, ne disposeront plus que de deux gardiens !
1965 – Les journaux - Renée, Jacques
Le premier journal de l'Union des Locataires, « Echo de la Cité », paraît en 1965. Un deuxième journal, « Cité Flash », est créé en même temps que le Syndicat des locataires, en janvier 1966, qui le distribue à plus de 1.000 exemplaires.
« Cité Flash » aborde les problèmes des locataires : environnement, paiement des charges (électricité, entretien des communs), absence d'école maternelle (des co-voiturages sont organisés par les parents à tour de rôle pour emmener les enfants à l'école Chertier, rue Edouard-Vaillant), absence d’affichage pour la circulation, ce qui provoquera plusieurs accidents, dont deux mortels (ce que nous verrons plus loin). Tous ces problèmes sont rapportés par les habitants des quartiers en construction, lors de réunions qui ont lieu, d’abord aux domiciles des animateurs, puis dans le garage de Pierre. En hiver, un petit chauffage d’appoint, on a plutôt froid, mais on tient le coup quand même.
1965 – UAL (Union amicale des locataires) - Jacques
L’Union des locataires de la Chancellerie, affiliée à l’origine à la Confédération Générale du Logement (CGL) est créée vers 1965. Les nombreux problèmes sur les quartiers nord incitent les membres de l’Union à mener des actions dans des domaines divers, notamment ceux concernant l’absence d'école maternelle. Malgré les résultats obtenus - l'ouverture de deux classes - ces actions provoquent l'exclusion par la CGL du Cher, de trois membres de l’Union, dont Pierre Effa, au prétexte que ces actions n’ont rien à voir avec le logement. Ces exclusions sont suivies par celles de deux autres, dont Rémi Platet, qui ont la mauvaise idée d'approuver les actions entreprises. L’Union devient alors, en 1966, le Syndicat des Locataires, auquel se rattachent quelques 600 des 800 adhérents d’origine, et qui sera amené à répondre aux problèmes se posant dans les quartiers de l'aéroport, des Dumones, à Avaricum, aux Gibjoncs puis au Val d'Auron.

Dans un premier temps, faute de local, c'est dans un des garages souterrains de la place Cothenet, chauffé grâce à un poêle à gaz, que se retrouvent les premiers membres du Syndicat. Lors d'une grande réunion, l’idée est lancée de la création de deux nouvelles structures : le Comité des Habitants et la Régie de Quartier. Par la suite, le Syndicat prendra le nom d’Union Amicale des Locataires, qui correspond mieux à sa restructuration et aux diverses activités organisées pour répondre aux sollicitations des habitants.
En ses débuts, devenue autonome par rapport à la CGL, cette section de locataires (Moulon et Chancellerie), élargira son champ d'action à de multiples activités réclamées par les habitants, qui faisaient défaut dans ces quartiers neufs et jeunes, venus en majorité d'Afrique du nord. La mixité sociale et la bonne entente constituent un atout incomparable, qui favorise grandement l'organisation des différentes activités.
A suivre...
Textes : Christiane Carlut
Notes
- (1) Contrat de Développement Social des Quartiers.
- (2) L’association a pour objectif d’apporter un appui à toute personne d’origine étrangère dans le Cher, et plus largement à toute personne en situation d’exclusion, afin de favoriser son intégration et son insertion sociale et professionnelle.
- (3) Maire de Bourges de 1959 à 1977.
- (4) Société de logements sociaux créée par le ministère de l’Intérieur, soucieux de surveiller les Algériens présents en métropole durant la guerre d’Algérie. L’entreprise s’est imposée dans les années 1960 comme le laboratoire de l’habitat social, incontournable pour détruire les bidonvilles et réhabiliter les centres urbains, loger les ouvriers étrangers de l’industrie, des grands chantiers et des villes nouvelles. Voir : https://www.histoire-immigration.fr/actualites/loger-les-immigres-la-sonacotra-1956-2006.
- (5) Direction Départementale de l’Agriculture.
- (6) Zone d’Urbanisation Prioritaire : procédure administrative d'urbanisme opérationnel (1959/1967) permettant de répondre à la demande croissante de logements.